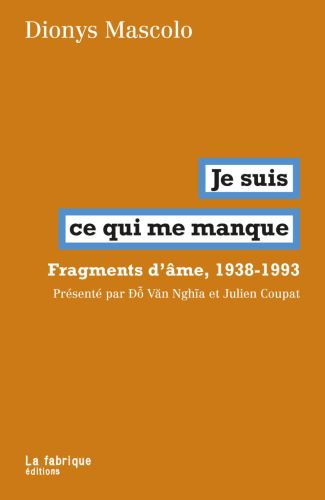C’est à travers Maurice Blanchot que nous avons découvert qu’une rencontre, non plutôt une découverte substantielle qui, depuis lors, anime et alimente notre vision du monde, intellectuellement, politiquement et humainement. En lui, nous nous redécouvrons tous les jours.
Je suis ce qui me manque. Fragment d’âme, 1938-1993 : les exercices spirituels de Dionys Mascolo
Les jeudis littéraires d’Aymen Hacen
À ce titre, nous vivons la parution de Je suis ce qui me manque. Fragment d’âme, 1938-1993, à La Fabrique éditions, comme un moment décisif, en ce sens qu’il est aussi rare qu’opportun, aussi inattendu que nécessaire.
Présenté par Đỗ Văn Nghĩa et Julien Coupat, qui en assurent la rédaction de la « note éditoriale » et la de la postface, intitulée « Si la lecture de Mascolo est possible », Je suis ce qui me manque est composé des seize textes ou chapitres suivants : « L’humanité qu’il fait », « Un art de vivre », « De l’amour », « Le monde me remonte », « “Moraliste”, en effet », « Le drame d’écrire », « Sur moi », « La muraille tranquille du malheur », « Thanatos, une appelante », « La corruption par l’espérance », « Misère intellectuelle », « “Tout dire” : il y a toujours quelque chose qu’on cachera », « À la lumière de l’ennui », « Vie de l’esprit », « L’exigence révolutionnaire » et « En venir à penser “nous” ».
Il s’agit d’une véritable aventure humaine, en et par fragments, car ce qui caractérise ce « journal », c’est avant tout sa vocation fragmentaire. À ce titre, le présent volume peut être lu de manière continue comme il peut se laisser découvrir par à-coups, de manière intermittente et discontinue. Cette remarque nous semble s’imposer dans la mesure où l’écriture de Dionys Mascolo, dense, exigeante, combative, ne ressemble à aucune autre. Sans doute est-ce pour cette raison que nous tenons l’auteur de Sur le sens et l’usage du mot « gauche » en haute estime.
Ainsi, le huitième fragment nous retient par sa pertinence : « Êtres sans profondeur, qui ne peuvent être ni fidèles, ni sincères ni menteurs, ni vrais ni faux, comme n’étant pas. » (pp. 9-10)
S’agit-il pour autant d’un jugement ou d’une quelconque forme de “moralisme”, alors que Dionys Mascolo déclare « “Moraliste”, en effet » ? Conscient de cet écueil, il écrit clairement : « “Moraliste” (Marg. M’en accuse). En effet. Au sens moderne, c’est être en constant éveil, dans le souci de dépister la morale cachée, honteuse, qui n’ose plus s’avouer, mais ne cesse pas de militer, coiffant des actes, paroles, attitudes ou pensées en apparence “libres”. C’est se conduire en ennemi rigoureux de toute morale. » (p. 61)
Cette pensée est loin d’être courante, comme on le dit d’une monnaie. C’est plutôt une devise rare, un long et sinueux chemin emprunté par un esprit courageux, intrépide et volontaire. Lire Mascolo, c’est oser affronter le danger, c’est avec lui vivre dangereusement, lui qui a vécu dans l’intimité de l’auteur du Gai savoir, auquel il a consacré de lumineuses pages et, bien sûr, l’essai intitulé Nietzsche, l’esprit moderne et l’Antéchrist.
Par ailleurs, depuis que nous pratiquons Dionys Mascolo, nous nous demandons s’il a bien lu et pratiqué Cioran. Or voilà que ce doute est enfin dissipé, non seulement à travers la forme fragmentaire des présentes pages de Je suis ce qui me manque. Fragment d’âme, 1938-1993, mais encore grâce à cette note : « Cioran, qui mérite vraiment le blâme de Valéry à Pascal, a cependant écrit (où ?) sur la musique : “ce refuge des âmes ulcérées par le bonheur”. »
Rappelons d’abord que ledit « blâme de Valéry à Pascal » est dans le volume Mélange et il concerne ce qu’il appelle « les pessimistes de la plume [qui] cherchent un beau noir. » Peut-être cela est-il vrai à propos de l’homme des Pensées, mais qu’en est-il de Cioran, que nous qualifierions volontiers de gai désespéré ou de gaiment désespéré ?
En effet, là où Cioran adopte une attitude de dandy désinvolte à la manière de Baudelaire, Mascolo opte pour l’action, la Résistance, la Révolution. C’est ce qui nous semble faire la différence entre les deux stylistes. Ce qui toutefois nous intrigue, c’est que ce fragment où il est question de Cioran et de la musique, en italiques dans le texte, a vu le jour en 1952 dans Syllogismes de l’amertume. Non datée, cette pensée de Mascolo nous fait poser des questions quant à l’organisation même du présent volume. Lire, ici, c’est relire, c’est relire encore, dans le but de comprendre, de savoir et de vivre avec Dionys Mascolo.
Aussi ces lignes et cette approche ne sont-elles qu’un premier abord de ce livre que nous tenons, déjà, pour un classique, tant il ouvre devant nous des voies pour la recherche à la fois intellectuelle et spirituelle, car Je suis ce qui me manque. Fragment d’âme, 1938-1993 ne nous a pas livré tous ses secrets, lesquels sont à dé-couvrir.
À suivre, donc…
Dionys Mascolo, Je suis ce qui me manque. Fragment d’âme, 1938-1993, présenté par Đỗ Văn Nghĩa et Julien Coupat, Paris, La Fabrique éditions, paru le 3 octobre 2025, 280 pages, ISBN : 9782358723077, 18,00€.