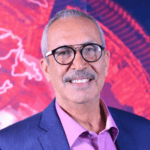Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2025, Romería représente un nouveau chapitre dans la carrière cinématographique de Carla Simón.
« Romería » de Carla Simón : le chemin de la mémoire
Après avoir touché le public avec Été 93 (2017) et Nos soleils (2022), la réalisatrice espagnole délaisse temporairement la Catalogne pour se rendre en Galice, la région natale de son père, et y explore un aspect plus intime et plus douloureux de son histoire personnelle. Ce troisième long métrage se distingue comme une œuvre mêlant mémoire et transmission, à l’intersection de l’intime et de la fiction.

La quête des origines à travers le prisme du souvenir
Au cœur de Romería, Marina, une jeune orpheline incarnée par la bouleversante Llúcia Garcia, entreprend un voyage à Vigo à la recherche de traces laissées par son père biologique, décédé du sida dans les années 1990. Ce retour aux sources la met face à une famille paternelle réticente à rouvrir les portes d’un passé marqué par les dépendances, le silence, et les stigmates. Dans ce tableau familial situé au début des années 2000, Carla Simón fait appel aux fantômes d’une époque et questionne ce que signifie « hériter » d’un passé que l’on n’a pas vécu, mais dont les non-dits dessinent l’identité.
Si Romería est inspiré par l’expérience personnelle de Simón — la perte de ses deux parents à un jeune âge, victimes de la crise du sida en Espagne — le film s’en détache en favorisant la fiction. « Le cinéma, dit Simón, me permet de créer des images qui n’existent pas. » Cette approche, loin de tout pathos, s’illustre par une mise en scène empreinte de pudeur et de justesse remarquables. Le récit, à la fois lumineux et mélancolique, ne cherche ni à idéaliser, ni à dramatiser : il capture plutôt les hésitations, les silences, les regards fuyants d’une famille blessée, mais toujours debout.
Le choix de filmer en Galice, sur les lieux mêmes où les parents de la réalisatrice vécurent leur amour, n’est pas fortuit. Vigo, avec ses ruelles anciennes et son front de mer industriel, devient un personnage à part entière. Simón y déploie un talent subtil pour l’observation, magnifié par une photographie sensible et une direction d’acteurs qui mêle professionnels et non-professionnels avec une harmonie rare. Cette alchimie apporte au film une vérité saisissante.

Par moments, Romería épouse le rythme de la fête populaire dont il tire son nom : un défilé joyeux, parfois chaotique, d’émotions, de souvenirs, de visages. Il y a dans cette marche vers la vérité une forme de guérison. Simón ne cherche pas à reconstituer le réel, mais à l’apprivoiser. Et c’est peut-être là que réside la plus grande force du film : dans sa capacité à transformer la douleur en récit, le manque en geste créateur.
Soutenu par de nombreux partenaires européens (Eurimages, RTVE, Movistar Plus+, Netflix, ZDF/ARTE…), Romería bénéficie d’une production ambitieuse (3,2 millions d’euros), au service d’un propos profondément humain. Tourné en espagnol, catalan, galicien et français, le film reflète également cette diversité identitaire que porte Simón en elle, et qu’elle partage ici avec une rare élégance.
Acclamé par les critiques enthousiastes — 4,5 étoiles pour l’International Cinephile Society, 4 pour The Guardian — Romería s’impose comme l’un des moments forts de cette 78e édition cannoise. Avec délicatesse, pertinence et émotion, Carla Simón signe une œuvre émouvante sur la mémoire familiale, le pardon, et l’importance de mettre des mots sur ce qui a été tu. Plus qu’un film : un chemin vers soi.