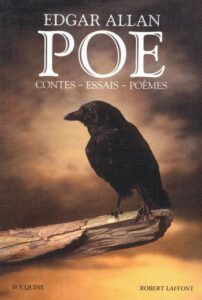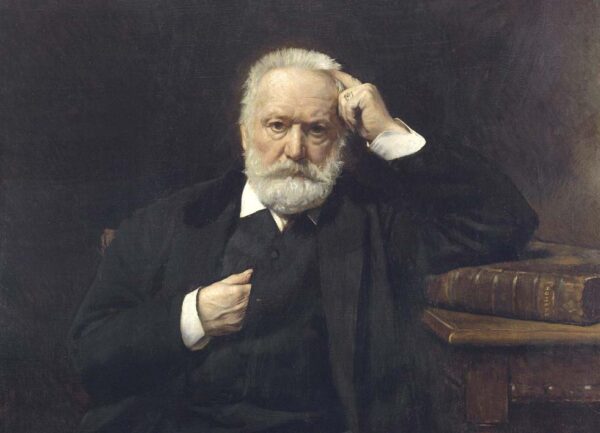Fariza Chemakh est une artiste pluridisciplinaire d’exception : comédienne inspirée, critique de théâtre, poétesse engagée, professeure passionnée et plume percutante. Figure lumineuse de la scène culturelle algérienne, elle conjugue avec talent l’art, la parole et l’action.
Fariza Chemakh, : « La poésie, pour moi, n’est pas une forme mais une vibration. »
POÈTES SUR TOUS LES FRONTS
Par Lazhari Labter
Elle porte un prénom de pierre précieuse. Rare comme la Jadeite qui prend différentes couleurs, cette pierre fine connue pour sa rareté et sa beauté, mais ce serait plutôt dans sa forme Jade impérial de couleur vert émeraude.
Des différentes significations de son prénom qui vient de l’arabe, de « dame très sélective et exigeante » à « celle qui se distingue des autres », en passant par la fleur « freesia », qui se décline en de nombreuses couleurs vives et gaies, la signification qui lui va le mieux est « celle qui se distingue des autres.
Pierre précieuse rare et freesia tout à la fois, Fariza est née de l’art, avec l’art et pour l’art. Les arts, devrait-on dire, avec toutes leurs expressions, leurs formes, leurs musiques, leurs mots et leurs couleurs. La culture aussi, qu’elle cultive avec amour comme on prend soin des freesias. Et la beauté et la créativité.
C’est qu’une existence pleine pour elle, c’est déjà un acte de création. Et son existence, hormis les contraintes et les aléas du quotidien dont chaque personne aimerait se passer, consacrée à ses passions, est pleine comme un vase toujours sur le point de déborder.
Comédienne née pour le théâtre qu’elle n’a pas choisi, mais qui a jeté son dévolu sur elle comme si c’était écrit dans la poussière des étoiles des premiers instants de l’univers. Le quatrième art qu’elle tient pour un souffle divin.
« Dans l’obscurité vibrante du théâtre, l’esprit dionysiaque s’éveille, déchaînant une symphonie où le chaos devient exaltation. La scène, sanctuaire des âmes audacieuses, se fait l’écho de mondes invisibles, de rêves fous, de vérités à demi-murmurées. Ici, tout est possible : les frontières s’effacent, les masques tombent, et la lumière jaillit de l’ombre dans une danse brûlante et infinie.
Le théâtre est une renaissance. Chaque mot, chaque geste est une offrande faite à l’univers, un fragment de l’essence humaine partagé sous le regard bienveillant du sacré. C’est une communion où les âmes s’enlacent, où l’artiste devient créateur de cosmos, tissant des fils d’espoir dans l’étoffe du mystère.
Porté par une énergie sauvage et lumineuse, le théâtre célèbre la beauté brute de l’imprévisible et l’éclat de l’intemporel. Dans cette ivresse créatrice, les limites s’effondrent pour laisser place à l’éternité. Dionysos lui-même semble murmurer à ceux qui osent rêver : « Ici, tout est vie, tout est feu, tout est sacré. » Telle est la magie du théâtre, un souffle divin qui embrase l’esprit et le cœur. »
Interprète, critique de théâtre, éducatrice-professeure, rédactrice d’une revue en ligne, conseillère culturelle à la direction de la culture et des arts de Tizi Ouzou, podcasteuse, poétesse et chanteuse à ses temps perdus, elle marie avec bonheur toutes les activités qu’elle aime et qu’elle pratique avec passion et avec bonheur.
Une passion qui l’a habitée dès l’enfance bien avant qu’elle ne lui donne un nom. Et un bonheur qu’elle partage avec générosité et dispense sans compter. A la grande joie de ses nombreux admirateurs qui réagissent et interagissent avec ses « coups de cœur » qui mettent du baume au cœur et… et ses « coups de gueule » salutaires.
Avec sa voix sublime et son jeu maîtrisé, elle fait chanter « les planches », elle qui les a chevillées au corps et qu’elle brûle à chacune de ses apparitions, faisant vibrer les salles où elle se produit, transmettant à des spectateurs ravis et éblouis des émotions et des vibrations, que ce soit sur scène ou à l’écran.
Mais celle qui cumule tous ces talents cultive aussi à merveille l’art de l’écriture qu’elle partage dans des textes qui rencontrent beaucoup de succès sur sa page Facebook. Des textes sublimes sur des sujets multiples, irrigués de poésie, de philosophie, de spiritualité. Des sujets « coup de poing », qui fâchent parfois les ennemis de la beauté et de la liberté, les conservateurs de tous bords et de tous poils qui préfèrent l’obscurité à la lumière, l’enfermement à l’ouverture, l’obscurantisme au progressisme, comme dans ce texte intitulé « La haine des femmes ou la faillite morale d’une société en crise » :
(…) « Dans les interstices d’une société en crise, où l’échec économique, le désœuvrement social, la perte de repères et la montée des frustrations ont creusé des gouffres d’identité, la femme est redevenue un bouc émissaire commode. Elle dérange. Elle agace. Elle effraie. Parce qu’elle ose. Parce qu’elle existe autrement que comme soumise ou silencieuse.
Et voilà que surgit, dans les coulisses de cette régression collective, une cohorte de justiciers autoproclamés, des prédicateurs, sans légitimité ni scrupule, armés de leur téléphone et d’un accès à Internet, qui vomissent quotidiennement sur les réseaux un flot d’insultes, de calomnies, de menaces, et de fatwas improvisées contre les femmes. L’insulte devient prêche. L’humiliation, un sermon. Le harcèlement, une vertu.
Qui leur a donné ce pouvoir ? Une société silencieuse. Une société complaisante. Une société parfois complice.
Car ces voix ne prospèrent pas dans le vide. Elles s’enracinent dans un terreau ancien, celui d’un patriarcat encore vivace, maquillé parfois en honneur ou en « protection ». Elles se nourrissent d’un système éducatif qui ne parle pas de l’égalité, d’un discours religieux confisqué par des obscurantistes, d’un vide juridique que les autorités tolèrent tant que le scandale ne dépasse pas un certain seuil. Elles se multiplient dans un pays où le corps de la femme reste un champ de bataille idéologique, entre ceux qui veulent l’enfermer et ceux qui veulent l’exhiber, sans jamais lui laisser la parole.
Ces hommes, souvent jeunes, frustrés, perdus dans une virilité mal assumée, s’arrogent le droit de dicter aux femmes comment marcher, comment parler, comment rire, comment aimer. Sous couvert de religion ou de morale, ils imposent leurs pulsions comme des lois. L’argument est toujours le même : « C’est à elle de ne pas provoquer ». Comme si le simple fait d’exister, d’être femme, était une provocation.
(…)
Il ne s’agit pas de défendre « les femmes » comme une cause abstraite. Il s’agit de défendre l’humain. La dignité. Le droit de penser, de choisir, de croire ou non, de vivre sans peur. Il s’agit de reconnaître que le combat contre la haine est un combat pour la survie morale d’une nation.
Et il est urgent. Car chaque jour de silence, chaque jour de tolérance envers ces discours, nous enfonce un peu plus dans la nuit. » lire ici
En vérité, Fariza Chemakh écrit pour nous amener à nous regarder dans le miroir. Nous regarder tels que nous sommes. Droit dans les yeux. Avec le secret espoir de faire notre examen de conscience, nous amender peut-être et peut-être de changer pour devenir meilleurs.
Elle écrit pour donner un écho à ce qu’elle ne peut hurler comme elle le dit dans un exergue au premier chapitre de son récit à paraître. Un récit écrit dans un style flamboyant, qui fera date. Un instant de grâce poétique. Un feu d’artifice littéraire comme seule elle sait en allumer dans les mots. Avec le feu volé au Ciel.
Lazhari Labter : J’aime bien commencer mes entretiens pour cette rubrique de « Souffle Inédit » avec la convocation d’un souvenir. Qu’évoque pour toi cette photo ?
Fariza Chemakh : Cette photo a été prise lors de la générale de la pièce Si Muh U M’hand, au Théâtre Régional Kateb Yacine de Tizi Ouzou. Je m’en souviens comme d’un moment d’intensité pure où l’art, l’amitié et la beauté se sont entremêlés. Ce qui m’a profondément marquée, c’est cette atmosphère de sincérité rayonnante, tout le monde était là pour l’autre, dans une joie désintéressée. Chacun offrait sa présence comme une lumière. C’était un moment de pure élévation, où l’on célébrait l’art, non comme un produit fini, mais comme une communion vivante. Et toi, cher ami, tu étais là, parmi ces belles âmes. Tu as été le témoin de cette harmonie rare où l’on ne cherchait pas à se distinguer, mais à se relier. Voilà pourquoi cette image, pour moi, n’est pas qu’un souvenir mais un éclat d’éternité.
L.L. : Après un baccalauréat en Lettres et Philosophie, une licence en Langue anglaise, spécialité Littérature et Civilisation anglaises, obtenus à Tizi Ouzou, en Kabylie, maîtrisant parfaitement quatre langues, le français, l’anglais, l’arabe et le tamazight, ta langue maternelle, tu aurais pu faire une carrière brillante dans l’enseignement secondaire ou universitaire, mais tu choisis les arts dramatiques et le métier de comédienne de théâtre et d’actrice de cinéma. D’où t’est venue cette passion et à quand remonte-t-elle ?
Fariza Chemakh : Cette passion n’a pas commencé, elle m’a habitée bien avant que je lui donne un nom. Dès l’enfance, je ressentais un besoin irrépressible de dire, de faire entendre une voix intérieure qui ne se contentait pas du silence. Très tôt, j’ai eu accès à la scène, d’abord par le chant, puis par le théâtre. Ces deux arts m’ont permis d’oser me dire, de sentir que j’avais le droit de parler, de vibrer, d’exister pleinement.
Je n’ai pas choisi le théâtre comme une orientation de carrière. C’est lui qui m’a choisie, ou plutôt, c’est en lui que j’ai reconnu ce que je cherchais sans le savoir, une manière de relier le corps, la voix, la pensée et l’imagination. C’est un lieu vital, une terre d’exil où je me retrouve. C’est par lui que je dialogue avec le monde.
Le jour où j’ai foulé les planches pour la première fois, j’ai su que je n’étais pas là par hasard. Ce n’était pas une décision rationnelle, non. C’était une évidence intérieure, une nécessité vitale. Là où d’autres voient le confort dans la stabilité, moi je cherche l’incandescence d’un espace de création, d’éveil, de présence. Le théâtre ne m’a pas offert une voie, il m’a offert un sens.
L.L. : Après des formations de comédienne et d’actrice, tu décroches en 2015 un Master en Arts dramatiques et Lettres anglaises à l’Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou. Mais dès 2011 et jusqu’à ce jour, tu enchaînes des rôles de comédienne dans de nombreuses pièces de théâtre et aussi d’actrice dans plusieurs films de télévision. J’imagine que tu as dû te battre pour t’imposer comme comédienne dans notre pays où ce n’est pas évident pour une femme d’être exposée publiquement, sous les feux des projecteurs
Fariza Chemakh : C’est une lutte silencieuse, constante, parfois invisible aux yeux des autres. Être femme et artiste chez nous, c’est évoluer dans un champ de contradictions. Il faut déjouer les regards qui jugent, les voix qui réduisent, les normes qui enferment. Mais paradoxalement, c’est dans cette adversité que je trouve ma force. Chaque obstacle est devenu un levier, chaque refus un élan. Je n’ai jamais cherché à plaire ou à correspondre. Je voulais être entière, habitée par mes choix, libre de mes gestes. Le théâtre m’a offert cette liberté rare, celle de me redéfinir chaque jour, dans chaque représentation, sous les yeux du monde, et parfois, malgré lui.
L.L. : Comédienne, interprète, critique de théâtre, éducatrice-professeure, rédactrice d’une revue en ligne, conseillère culturelle, tu es sur tous les fronts et avec ça, tu trouves le temps d’écrire, de partager des « podcasts » et publier des textes de réflexion sur la culture et les arts sur ta page Facebook. Qu’est-ce qui te motives à « jouer » tous ces rôles, à « danser » sur toutes les musiques ?
Fariza Chemakh : Je ne dirai pas tout ça à la fois. Cependant je crois que la vie n’est pas une ligne droite, mais une constellation. Chaque rôle que j’endosse éclaire un autre, chaque rôle que j’endosse ouvre la voie pour un autre. Je ne cloisonne pas. L’écriture nourrit la scène, la scène éclaire l’enseignement, l’écoute et l’observation forgent la critique. C’est ma manière d’habiter pleinement l’existence. Être sur tous les fronts, ce n’est pas me disperser, c’est me rassembler dans une dynamique d’exploration, de recherche et de découverte. Je me sens vivante quand je cherche, quand je transmets, quand je tends un pont entre le visible et l’invisible. Je « danse » sur toutes les musiques (au sens propre et figuré) parce que toutes les musiques me traversent, et que j’ai appris à ne pas m’excuser d’aimer trop, à ne pas m’excuser de vouloir faire trop, à ne pas m’excuser de vouloir offrir trop.
L.L. : Tu n’écris pas de la poésie, mais tous tes textes, philosophiques et spirituels à la fois, sont irrigués par la poésie, et parfois, comme si le besoin était plus fort, tu ne résistes pas à l’envie d’écrire sous forme de vers libres. Que représente la poésie pour toi ? Quel poète ou quelle poétesse aurais-tu aimé être et pourquoi ?
Fariza Chemakh : La poésie, pour moi, n’est pas une forme mais une vibration. C’est le souffle entre les mots. J’écris en prose, mais mes phrases cherchent toujours à danser, à dire autrement ce que la pensée peine à formuler. Même quand je ne cherche pas la poésie, elle s’invite, dans le rythme, l’image, l’élan. Parce qu’au fond, c’est ma langue naturelle, une langue de l’âme.
Et puis, si l’on revient au théâtre, mon autre respiration, on réalise que tous les grands dramaturges que nous considérons aujourd’hui comme des références, Sophocle, Euripide, Shakespeare… étaient avant tout des poètes. Leurs œuvres portaient cette densité lyrique, cette élévation du langage qui dépasse la simple narration. Aucun d’eux n’a écrit sans cette pulsation poétique, sans cette manière de dire le monde en le traversant par le vertige. Le théâtre, dans son essence, était poème, invocation, danse et chant sacré, souffle collectif. C’est peut-être pour cela que je ne sépare pas poésie et scène. Elles sont, pour moi, deux formes du même souffle.
J’aimerais dire Sylvia Plath, pour cette manière bouleversante qu’elle avait de sculpter la douleur dans des mots à la fois ciselés et viscéraux. Sa poésie est une déchirure lucide, une alchimie du chaos intérieur transformé en beauté brute. Elle écrivait avec une urgence qu’on sentait vitale, comme si chaque poème était une respiration arrachée à l’ombre.

Mais le tout premier poète qui m’a bouleversée, c’est Edgar Allan Poe. Non pas parce qu’il est gothique, bien que cette noirceur m’ait fascinée, mais parce qu’il m’a fait comprendre que la beauté peut être étrange, tordue, dérangeante… et pourtant vibrante. Il m’a ouvert à une forme de profondeur obscure, à cette beauté tragique qui ne cherche pas à plaire mais à dire vrai, même dans l’effroi. Il m’a appris qu’on pouvait écrire avec l’ombre, et qu’elle pouvait aussi être lumière.
L.L. : Tu accordes beaucoup d’importance à l’amour, à la beauté, à la spiritualité, à la poésie, aux arts et à la culture. Dans un de tes « posts » sur Facebook, tu écris : « L’amour de l’art est une source de joie et de stimulation pour l’esprit, une manière magique de s’évader de la réalité et de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. » La réalité est-elle donc décevante au point de vouloir s’en évader et que peut être ce « plus grand que soi » pour toi ?
Fariza Chemakh : La réalité est rude, rugueuse, parfois mutilante. Elle nous confronte à l’injustice, à la violence, à l’absurde. Mais je ne cherche pas à fuir la réalité, je cherche à l’habiter autrement. Ce « plus grand que soi », c’est peut-être cette dimension invisible où se tissent les liens de l’âme, ce lieu intérieur où l’art, la foi, la beauté et l’amour se rejoignent dans un silence lumineux. C’est là que je me ressource. Ce n’est pas un ailleurs, c’est un au-dedans plus vaste que le monde.
L.L. : Dans un post récent, tu écris : « Être une femme, c’est souvent naviguer entre les attentes et les contraintes imposées par la famille, la société, et le système en place. La condition féminine est marquée par des luttes constantes pour l’égalité et la reconnaissance. Les femmes sont fréquemment victimes de discriminations, de violences et d’injustices qui limitent leur liberté et leur potentiel.
Cependant, malgré ces défis, les femmes démontrent une résilience et une force incroyables. Leur capacité à surmonter les obstacles et à se battre pour leurs droits inspire et transforme le monde. La condition féminine est un miroir de notre société. Elle révèle les inégalités et les injustices, mais aussi les progrès et les espoirs. »
Que dirais-tu aux femmes algériennes toi qui a affronté tous les écueils de la vie et de la société pour arriver à t’imposer et à être ce que tu voulais et non ce qu’on voulait que tu sois.
Fariza Chemakh : Je leur dirais ceci : ne vous excusez jamais d’exister à votre manière. Le monde vous opposera mille raisons de vous taire, de vous plier, de rentrer dans des cases qui n’ont pas été dessinées pour vous. Résistez. Aimez-vous dans vos excès, vos failles, vos imperfections, vos désirs. La liberté ne se donne pas, elle se conquiert, lentement, douloureusement parfois, mais chaque pas vers elle est une victoire. On dit souvent « Soyez fortes », mais j’aime aussi dire « Soyez tendres, soyez furieuses, soyez belles, soyez multiples. » Et souvenez-vous « exister pleinement, c’est déjà un acte de création. Et un acte de courage. »
Deux textes inédits de Fariza Chemakh, extraits d’un récit à paraître.
Ce que fut ne dicte rien à ce qui sera
Entre les souffles croisés du jour et de la nuit, où le temps s’efface sans jamais s’oublier, j’erre en silence. Mon pied s’ancre aux ombres, mon regard s’illumine aux cendres pâles du couchant ; mais nul royaume ne me retient, nul destin ne me dicte la route que je grave aux confins du réel.
J’entends ce que fut, je devine ce qui sera, car sous l’onde qui court aux rives de l’invisible, mon nom s’inscrit, immuable et insoumis. Les fils du temps s’enlacent à mon souffle, fredonnant les sagas effacées, les serments égarés, les secrets tissés aux veines de l’éternité.
Ils disent que les astres connaissent la fin avant l’heure, que les âmes se plient aux lois qu’on leur impose, mais je ne suis ni ombre asservie ni lumière docile. Je suis l’orage qui ne s’implore pas, le passage qui ne s’entrave point, l’éclat qui ne ploie sous aucun règne.
Les oracles ont parlé, ils ont tissé leurs fables aux lèvres des rois, scellé leurs jugements dans l’éther mourant des mondes oubliés. Mais je ne courbe ni genoux ni raison devant l’écho d’un passé qui s’évertue à me lier.
Sous l’aube qui oscille, j’ai levé la main. Le vent s’est tu, les pierres ont frissonné. Car ce que l’on croit figé s’émiette sous le poids d’une volonté qui ne connaît pas d’entrave.
Que s’effacent les chaînes, que se brisent les lois immuables.
Car je marche entre les mondes, et nul ne réclamera ce qui est mien.
Et lorsque la dernière étoile tombera, ils comprendront.
Que ce qui fut ne dicte rien à ce qui sera.
Que ce qui s’enlace au néant se refonde à la lumière.
Et que ce nom murmuré aux fils du temps,
Ne se tait jamais.
Le dernier voyage / l’appel des astres
Ne scellez pas ce corps sous la pierre muette, ne le courbez pas sous l’enclave d’une terre qui ne connait ni mémoire ni rêve.
Qu’il s’efface en cendre, qu’il s’éparpille aux cimes ou les vents murmurent aux âmes anciennes.
Ça il est une loi que nul linceul ne peut contraindre, celle des âmes qui refusent la fin telle qu’on la leur impose.
Quand viendra l’heure ou l’ombre cherchera à me prendre, qu’on ne forge pas ma prison dans les entrailles d’un monde qui ne m’a pas compris.
Brulez ce que fut, laissez l’onde emporter ce qui reste.
Que les montagnes recueillent ce qui n’a jamais pu être contenu. Que les océans m’apprennent les gestes que la vie m’a refusé.
Peut-être alors, dans le frémissement d’une mer sans nom,
Dans le souffle d’une lumière que nul regard ne peut emprisonner,
Quelque chose s’éveillera, une mémoire qui ne ploie pas sous l’oubli,
Un retour aux confins du rêve qui n’a jamais cessé de m’appeler,
Ne pleurez pas, ne sculptez pas ma perte dans la pierre.
Ne donnez pas mon corps à l’obscurité.
Laissez-le rejoindre les lieux où il aurait dû naitre.
Là où les âmes libres retrouvent ce qu’on leur a arraché.
Là où l’éclat des cendres forge l’éternité.