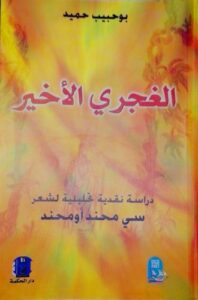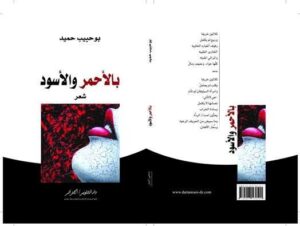Découvrez l’univers poétique de Hamid Bouhbib, poète engagé et intellectuel de renom, qui met sa plume au service des causes justes, notamment la cause palestinienne. À travers ses vers, il porte haut la voix des opprimés, offrant une poésie d’une rare intensité et profondément ancrée dans la résistance et l’amour de la Palestine.
Hamid Bouhbib : Poésie et Résistance au Service de Gaza
Hamid Bouhbib « La poésie est un acte de résistance à la barbarie des puissants. »
POÈTES SUR TOUS LES FRONTS
Par Lazhari Labter
Il n’aime pas être sous les feux des projecteurs, mais le feu intérieur qui brûle continuellement en lui incendie toute sa poésie. Lui qui pourtant mérite tous les éloges, c’est Hamid Bouhbib.
Le Docteur Hamid Bouhbib comme il n’aime pas aussi qu’on le qualifie pour ne pas être comparé à ces « douktours » qui pullulent en Algérie et ailleurs dans les pays arabes et qui n’ont pour nombre d’entre eux que le titre ronflant qu’ils aiment mettre en avant sur leur carte de visite ou sur les affiches des rencontres.
Bardé de diplôme, polyglotte, professeur universitaire, chercheur, spécialiste de la poésie populaire, écrivain, poète, traducteur, critique littéraire, membre de jurys dont celui du prestigieux Prix Littéraire Mohammed Dib du nom du grand romancier algérien, Hamid Bouhbib a pourtant de quoi être fier de son parcours qui est loin de toucher à sa fin.
Quand il n’est pas plongé dans des ouvrages ardus pour traiter de telle ou telle question complexe liée à l’anthropologie littéraire ou à l’art de la versification arabe, il écrit des poèmes. Et quels poèmes ! Des poèmes dignes des plus grands poètes arabes qui l’ont d’ailleurs nourri tels Mahmoud Darwich ou Samih Al-Qassim.
Poète engagé, poète de gauche comme il se doit, Hamid Bouhbib lève haut l’étendard de sa poésie qu’il met au service des causes justes et en particulier la cause palestinienne qu’il a faite sienne du plus loin qu’il se souvienne et à laquelle il a consacré son dernier recueil intitulé Pour Gaza et le jasmin.
Hamid Bouhbib pour qui la Palestine est une question d’amour et de passion ne peut concevoir la poésie que comme un acte de résistance de l’homme opprimé, un cri du « dur désir de durer » du Palestinien de Gaza et de Ramallah, debout, sous les balles et bombes, parmi les ruines, les oliviers, le thym, le feu d’une terre colonisée à libérer et d’une vie à vivre qu’il porte en lui, et les chants et les poèmes :
Je ne mourrai pas
tant que la vie ne me paie pas
le tribut des années passées
afin que je puisse me tenir devant les morts
pur
pieux
fier
et pouvoir déclarer enfin
qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil
et que l’humanité
a connu sa fin
à Gaza
un jour
où la lâcheté est devenue
un insigne.
Rencontre
Lazhari Labter : J’aime bien commencer mes entretiens pour cette rubrique de « Souffle Inédit » avec la convocation d’un souvenir. Qu’évoque pour toi cette photo ?
Hamid Bouhbib : Ah ce fameux Hirak (1) ! Une belle aventure collective, des moments d’intense engagement et même si je n’avais aucune illusion quant au grand changement rêvé, j’ai tout donné : omniprésent dans les marches, les conférences, les réunions de coordinations, les assemblées générales à l’université, etc.
Hélas, un mouvement horizontal, sans direction révolutionnaire, sans une vision globale, et sans les travailleurs, ne pouvait aboutir.
Aujourd’hui, quand je revois ces photos, une grande émotion me submerge, et je me dis : on aurait pu faire autrement… !
L. L. : Tu as eu l’insigne honneur d’avoir comme professeure la défunte Moudjahida et chercheuse dans le domaine du patrimoine culturel algérien, Roselyne Leïla Quraich (2) durant tes études de licence en littérature étrangère, puis en littérature américaine en 1987-1988 et qui a supervisé également ton mémoire de Master sur la poésie de Si Mohand Ou Mhand (3), aux côtés de son défunt compagnon, Ahmed Lamine (4), le spécialiste de la poésie populaire algérienne de Sidi Khaled (5) et de sa région. Que gardes-tu de ces deux grandes figures qui ont marqué la recherche dans le domaine du patrimoine populaire immatériel de l’Algérie ?
Hamid Bouhbib : En effet, ce sont deux monuments des études populaires en Algérie, et en partie, c’est grâce à eux que j’ai pu percer dans ce domaine.
Leila, en plus de son érudition dans le domaine de la littérature occidentale, était un exemple de rigueur méthodologique, sans oublier son courage et son amour pour notre pays : durant la décennie noire, elle habitait du coté de Triolet, dans un quartier à dominante islamiste, mais elle a continué à fréquenter l’église et refusé de s’exiler en France. Sa maison était un lieu de rencontre de nombreux poètes, écrivains, doctorants… je ne l’oublierai jamais.
Quant à Ahmed, il était pour moi un ami intime, un complice et un mentor en même temps… c’est lui qui m’a entrainé dans l’univers du Melhoun (6).
Je garderai de lui, le souvenir d’un homme élégant, perspicace et amoureux de la beauté, de la poésie et des rencontres bien arrosées.
L. L. : Tu as donné comme titre à ton dernier recueil de poésie Pour Gaza et le jasmin. Quel message veux-tu faire passer en associant ce « bout de terre » palestinien meurtri à cette fleur reine, qui ornent d’ailleurs tous les deux la belle couverture verte accrochés à une branche morte sous des fumées menaçantes ?
Hamid Bouhbib : Le jasmin dans sa symbolique, reste une fleur orientale qui évoque la douceur, la beauté fragile, et Gaza, aussi en quelque sorte est douce et fragile, et le sort ne l’a pas épargnée, d’un autre côté, il y a une tradition florale en Palestine qui sacralise la menthe, les fleurs d’oranger et la jasmin, symbole d’un raffinement des temps jadis.
L. L. : La Palestine est plus qu’une cause pour toi et tu y reviens sans cesse dans tes poèmes. Est-ce une blessure ou une douleur ou encore une écharde plantée dans ton cœur ?
Hamid Bouhbib : En plus d’être une cause juste, comme toutes les causes liées à la décolonisation, la Palestine pour moi est une histoire d’amour et de passion.
Depuis ma tendre enfance j’étais bercé par le folklore palestinien, via une émission diffusée quotidiennement par la Chaine Une de la radio nationale.
Plus tard, c’était la poésie de Darwich, de Samih Al-Qassim et des œuvres de Kanafani, d’Edward Al-Kharrat (7) qui m’ont définitivement conquis.
Alors, oui, la Palestine restera une écharde plantée dans mon cœur.
L. L. : Tu as consacré un ouvrage – le sujet de ton Master – au grand poète errant Si M’hand Ou M’hand sous le titre Le dernier bohémien – Étude critique et analytique de la poésie de Si Mohand Ou Mhand le célèbre poète populaire de la résistance et de l’amourpublié en 2007. Que représente pour toi ce poète en particulier et la poésie populaire en général à laquelle tu as consacré deux ouvrages fondamentaux intitulésIntroduction à la littérature populaire – Étude anthropologique publié en 2009 et Poésie orale kabyle : contexte, structures et fonctions : une approche anthropologique publié en 2013 ?Tu es connu pour ta rigueur et pour être très pointilleux sur les notions et les concepts en général et notamment ceux de « littérature orale », « texte oral » que tu considères comme un paradoxe. Peux-tu nous en dire plus sur cette question et sur la problématique du passage des concepts et des notions littéraires des langes latines à l’arabe qui renvoie à des significations différentes ou erronées ?
Hamid Bouhbib : Le terme « littérature » dans ses différentes racines étymologiques occidentales renvoie clairement à l’écriture. « Litteratura » est dérivé de « littera », signifiant « lettre » au sens de signe graphique. Ainsi, le mot « littérature » évoque à l’origine l’ensemble des écrits, puis, par extension, l’ensemble des œuvres écrites qui ont une valeur esthétique ou intellectuelle.
Donc, quand on dit littérature orale, on se retrouve, presque, face à un non-sens, chose qui n’a pas échappé aux spécialistes de l’oralité, comme Paul Zumthor (8), Walter J. Ong (9). C’est ce qui a poussé les chercheurs en ethnolitterature à forger un autre terme que je trouve plus cohérent, qui est oraliture… D’autres parlent même d’auralite, pour mieux souligner le double aspect : audio/oral.
En ce qui concerne la culture arabe, le mot Adab, ne renvoie pas exclusivement à l’écrit, puisque dans son origine, il englobait la poésie, la prose, la philosophie, et tout ce qui pouvait contribuer au raffinement de l’instruction des individus.
Et malgré cela, une autre problématique est venue s’imposer aux chercheurs, car l’évolution à la fois historique et intrinsèque de la langue arabe, a donné une diglossie jusque-là inconnue pour les arabophones de l’Arabie. Cette diglossie (arabe classique/arabe populaire) a évolué pour nous donner deux types de littératures : une littérature officielle dite Adab Fassih, et une littérature marginale dite Populaire… La difficulté aujourd’hui réside dans la définition même de la notion de « populaire » !
Est-ce qu’elle renvoie aux couches populaires indépendamment de la langue d’expression ! Ou est ce qu’elle désigne toutes les formes d’expression dialectales indépendamment de l’appartenance sociale de leurs créateurs.
Le passage de l’oralité à l’écriture, à été accompagne d’une ferveur presque maladive, qui donne l’illusion que l’oralité est une tare dont il faut se débarrasser, mais de nos jours, avec l’avènement de la numérisation, des livres audios, des chaines Youtube, on assiste à un regain d’intérêt pour l’oralité.
Et cela pourrait, à moyen terme, relancer le débat sur les notions : populaire ; mass media, oralité, auralité, écriture, etc.
L.L. : Poète, traducteur, enseignant chercheur, critique littéraire, collaborateur à de nombreuses revues comme Aleph (10) et Maarif (11), membre du jury pour la poésie du concours de l’Établissement Arts et Culture (12) et du Prix Littéraire Mohammed Dib (13) organisé par l’Association La Grande Maison de Tlemcen, tu es ce qu’on appelle un poète sur tous les fronts et un poète dans la Cité.
Hamid Bouhbib : Je n’ai aucune prétention là-dessus, mais je fais de mon mieux pour contribuer à l’évolution de la culture nationale en général, néanmoins je reste toujours un poète marginal. J’ai horreur de la foule et des feux de la rampe
L. L. : Tu as publié les recueils de poésie En rouge et en noir en 2016, Psalmodies de la solitude en 2017, Pour Gaza et le jasmin en 2025 sans compter les poèmes inédits que tu partages régulièrement sur ta page Facebook. Que représente pour toi la poésie dans un monde qui a perdu la boussole et qui court à sa perte à cause de la folie des puissants qui veulent faire de toute la planète et de tout ce qu’elle porte et supporte, humains, animaux et végétaux, des marchandises ?
Hamid Bouhbib : Par les temps qui courent, la poésie, celle qui m’interpelle, est un acte de résistance : résistance à la médiocrité du quotidien, résistance à la barbarie des puissants, résistance à la marchandisation imposée par le méga impérialisme et surtout résistance à la laideur sous toutes ses formes, qui tente de tout engloutir.
Un poème de Hamid Bouhbib traduit de l’arabe en français par Lazhari Labter.
Le pin est l’empreinte des dieux dans ces contrées assoiffées…
Tous les arbres aux alentours gémissent sous le soleil d’été
Et le pin prend de la hauteur
Indifférent aux saisons de sécheresse
Comme s’il avait été créé
Pour incarner la volonté de puissance
Qu’avait évoqué
Ce misérable philosophe…
Alors je me retrouve,
Chaque fois que je m’égare
Allongé sous son ombre
Vénérant sa résine
Et son parfum sauvage
Et fixant l’impossible…
Mais le pin mon cher
Meurt aussi,
Comme tous nos rêves d’enfant
Comme cet enfant
Qui habite au plus profond de mon cœur
Il se réfugie
Dans un coin de la mémoire des jours
Il pleure
Il essuie ses larmes et sa morve
Avec la manche de sa veste usée
Puis il s’endort
Épuisé par l’excès de tristesse et de solitude
Ensuite il se réveille indifférent
A la soif et aux missiles
Qui détruisent les histoires d’enfants…
L’enfant qui sommeille en moi
Descend maintenant jusqu’au fond de la vallée
Parce qu’il s’est souvenu
Que Grand-mère avait dit
Que la porte du monde d’en bas
Était dans cette vallée…
C’est pour cela que je n’attends pas son retour
Et je n’attends pas que les missiles
Cessent leur destruction…
Ce que j’attends à vrai dire…
Je n’ose pas le dire
Je crains pour vous
Si la destruction totale se produisait
Que vous disiez :
« Voilà ce qu’a fait de nous
Le poète du pin. »
- Hirak : Mouvement populaire algérien de manifestations hebdomadaires qui a eu lieu entre 2019 et 2021 en Algérie, réclamant le départ du président déchu Abdelaziz Bouteflika et le changement du système politique en place depuis 1962.
- Roselyne Leïla Quraich : La défunte Docteure était enseignante à l’université d’Alger aux côtés de son défunt compagnon Ahmed Lamine.
- Si Mohand Ou Mhand : Célèbre poète algérien né en Kabylie en 1848 et mort en 1905, auteur de poèmes en kabyle sur l’amour et l’exil, appelés Isefra.
- Ahmed Lamine : Le défunt Docteur, ancien enseignant de Lettres arabes à l’université d’Alger, spécialiste de la littérature populaire algérienne dont l’ouvrage le plus connu est La poésie populaire algérienne à Sîdî Ĥâled et sa région (wilaya de Biskra-Algérie) de 1850 à 1950, et ses relations avec le patrimoine culturel arabo-islamique.
- Sidi Khaled : Oasis de la région de Biskra (sud-est algérien) où a vécu la légendaire Hiziya (1855-1878) que le poème éponyme de Mohamed Ben Guittoun chanté par Abdelhamid Ababsa et Khelifi Ahmed a immortalisé.
- Melhoun : Poésie populaire.
- Mahmoud Darwich, Samih Al-Qassim, Ghassan Kanafani, Edward Al-Kharrat : Célèbres poètes et écrivains palestiniens et égyptien.
- Paul Zumthor : (1915-1995), philologue, romancier et poète suisse, spécialiste des poésies médiévales.
- Walter Jackson Ong : (1912-2003), éducateur, chercheur, et linguiste connu pour son travail sur le passage de la culture orale à la culture écrite notamment dans son ouvrage le plus connu Oralité et écriture : la technologie de la parole.
- Langues, Médias & société est une revue de Sciences du langage, sciences du texte et des Sciences de l’information et de la communication. Elle publie, en arabe, en français, en anglais et en tamazight
- Maarif est une revue scientifique internationale publiée par l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, en Algérie. Elle paraît deux fois par an avec des articles de recherche en droit, sciences économiques, littérature et langues, sciences et techniques des activités physiques et sportives, et sciences humaines et sociales. Les articles sont publiés en quatre langues : arabe, amazighe, anglais et français.
- L’Établissement Arts et Culture est un établissement culturel sous la tutelle de la wilaya d’Alger.
- Le Prix Littéraire Mohammed Dib du nom du célèbre romancier algérien est organisé par l’Association La Grande Maison de Tlemcen et distingue chaque deux ans trois romanciers dans les langues arabe, tamazight et française.