Né à Fano, en Italie, Alberto Fabio Ambrosio est professeur de théologie et de l’histoire des religions à la Luxembourg School of Religion & Society. Son intérêt majeur porte sur le religieux, notamment le soufisme.
Rencontre avec Alberto Fabio Ambrosio
Les jeudis littéraires d’Aymen Hacen
Auteur remarqué d’une thèse parue en 2010 aux éditions du CNRS, Vie d’un derviche tourneur. Doctrine et rituels du soufisme au xviie siècle, il a publié de nombreux ouvrages dont La Confrérie de la danse sacrée. Les derviches tourneurs, en 2014, chez Albin Michel.
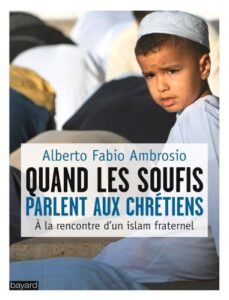
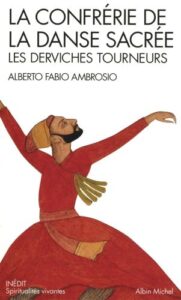
A.H : Vous appartenez à l’ordre des dominicains. Pourriez-vous nous expliquer sa spécificité et ce qui vous a amené à vous intéresser au soufisme musulman ?
Alberto Fabio Ambrosio : En effet, l’Ordre des Prêcheurs (Ordo Praedicatorum) est un ordre religieux fondé au Moyen Âge par un Espagnol, saint Dominique de Guzmàn, qui appartenait à la noblesse et qui avait d’abord été consacré comme chanoine. Il vivait retiré du monde, cependant, face aux hérésies qui s’emparaient de l’Europe, il comprit en voyageant qu’il fallait un ordre en mesure de prêcher la « bonne doctrine », c’est-à-dire la vérité de la foi chrétienne. Or, la foi chrétienne est très liée, voire fondée sur l’orthodoxie, alors que les historiens des religions définissent parfois l’islam comme une orthopraxie. Dans le christianisme, le fondement se trouve dans le Christ qui est la vie, la Vérité et la voie. Mais attention, le Christ est la Vérité, alors que des vérités, il y en a partout, pour le dire de manière simpliste. Or, Thomas d’Aquin, qui fut le second fondateur de l’Ordre, a appris à ses frères à regarder la vérité, et non pas qui la dit.
Ensuite, l’Ordre des Prêcheurs s’est vite installé au Moyen-Orient et au Maghreb. L’école de langues orientales fondée dès le Moyen Âge dans l’actuelle Tunisie fut fameuse. Aujourd’hui, les frères dominicains sont bien implantés au Caire avec l’Institut dominicain d’études orientales, à Istanbul avec le Dost-I (Dominican Study Institute Istanbul), ainsi qu’en Irak et au Pakistan, sans oublier l’École biblique de Jérusalem. On voit par-là que, pour un frère dominicain, il s’agit de rechercher la vérité où elle se trouve ; il faut étudier, se confronter, affronter la diversité des langues, des cultures et des civilisations. Voilà que, jeune frère dominicain très intéressé par la mystique chrétienne, je me suis tourné vers la mystique musulmane pour voir, comparer, apprendre et constater s’il y avait de la vérité. Eh bien sûr, il y en a… Mon intérêt pour le soufisme n’a rien d’étrange dans l’Ordre, peut-être un peu plus rare, mais je me suis situé dans une tradition.
A.H : Votre spécialité est en soi une spécialité, à savoir le soufisme ottoman. Qu’est-ce qui caractérise cette expérience spirituelle des autres, sachant que vous avez beaucoup travaillé sur les grands soufis musulmans, dont Ibn’Arabī et Rûmî ?
Alberto Fabio Ambrosio : Vous avez parfaitement raison. Après des études de langues et littératures orientales – turques en particulier –, j’ai dû faire un choix. Mon ordre m’a demandé – un peu sur une suggestion de ma part, à vrai dire – de partir pour Istanbul, l’ancienne Constantinople et l’antique Byzance. On ne peut pas bien connaître toutes les langues ; donc après avoir fait de l’arabe, du persan et de l’ottoman, j’ai jeté mon dévolu sur le turc, que je parle assez bien, même dix ans après avoir quitté la Turquie pour retrouver la France et mon poste d’enseignement au Luxembourg.
Le soufisme incarne pour moi la recherche d’une forme de perfection, bien sûr conçue au sein de l’islam, mais avec une visée universaliste dans une certaine mesure. Ibn’Arabī, que je connais beaucoup moins que d’autres penseurs, m’a paru trop philosophe, comme peut l’être un maître Eckhart. Je pense qu’il faut déjà appartenir à la tradition soufie pour le comprendre parfaitement. En revanche, je me sens très proche de Rûmî, et surtout de la « spiritualité » qu’il a inspirée. Je vais vous faire un aveu : plus je m’éloigne de l’étude de cette spécialité (car ces cinq dernières années, j’ai beaucoup travaillé sur mode, vêtement et religion), et plus je m’en rapproche spirituellement. Je vois et je constate à quel point un autre enseignement spirituel peut résonner dans un être (en moi, dans le cas présent), et inutile de se poser la question de la conversion ou des frontières des religions. Chaque religion a des frontières bien nettes, c’est sûr. Vouloir les annuler, c’est comme vouloir gommer les frontières d’un pays… On voit les dommages et les effets nuisibles que cela induit. Or, on ne peut pas faire de l’irénisme en disant que toute tradition est valable, égale à l’autre. Ce discours est celui d’une nouvelle spiritualité qui veut se mettre en place, quasiment d’une nouvelle religion issue des démocraties libérales, et soit. Mais en fait, le déni de quelque chose de « naturel », c’est-à-dire la reconnaissance des frontières dans les religions, amène toujours son contraire. Voilà donc que tout en étant chrétien, catholique et très lié à ma tradition, je pense qu’il y a mille manières d’être réceptif, de faire parler l’ « autre ». Au risque de scandaliser le lecteur, l’athée aussi est source d’inspiration, car il dit la dimension d’absence de la croyance, toujours possible dans un homme ou une femme. Or, pourquoi ne pas laisser parler en nous les différentes dimensions, tout en demeurant ce que nous sommes intimement ?
A.H : Votre thèse a été traduite et publiée en arabe en 2015 par la sœur dominicaine Louisette Mouawad. Aujourd’hui, l’enseignante-chercheuse tunisienne Meriem Dziri s’apprête à publier dans cette langue La Confrérie de la danse sacrée. Les derviches tourneurs. Il semble que vos travaux commencent à trouver des échos favorables dans le monde arabe et musulman. Qu’en pensez-vous ?
Alberto Fabio Ambrosio : J’en suis ravi, et vous savez pourquoi ? Eh bien, par moments, j’ai pensé que le travail de vingt ans de ma vie trouvait pour seul écho quelques lecteurs par-ci par-là dans le monde, et je dis bien « dans le monde ». C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je me suis mis à explorer d’autres champs et domaines. Mais cela veut dire que lorsqu’on prend en considération la spiritualité de l’autre avec sérieux et responsabilité, on finit par en récolter les fruits. En effet, tous mes travaux sont le fruit d’un labeur exigeant, mais aussi d’une manière d’être au monde : celle d’un chercheur qui est, avant tout, un frère dominicain. Plus d’une fois, on m’a fait sentir que mon regard portait un « biais » — surtout dans les milieux qui se croient indemnes de toute subjectivité. Pourtant, c’est précisément depuis cette place assumée, à la croisée de la foi et du savoir, que je cherche à comprendre la profondeur spirituelle des cultures. C’est tout le problème de la science moderne, qui se pense objective. La méthode est objective, mais pas tout à fait le reste. C’est difficile à avaler pour un chercheur ou une chercheuse qui se pense purement dans l’objectivité. Or, à l’école de Marc Bloch, je pense que même l’histoire a ses biais. Ces dix dernières années, j’ai enseigné et fait de la recherche à la Luxembourg School of Religion & Society, à Luxembourg. Avec son fondateur et directeur, Jean Ehret, nous avons beaucoup travaillé à prendre conscience de l’importance de la réflexivité moderne. Si je ne sais pas qui je suis ni d’où je parle, puis-je encore prétendre à l’objectivité de ma recherche ?
A.H : Vous écrivez en français, mais votre langue maternelle est l’italien. Vous pratiquez également plusieurs autres langues. Comment vivez-vous votre plurilinguisme ? Est-il nécessaire pour les travaux que vous menez ?
Alberto Fabio Ambrosio : Merci pour cette question qui me fait du bien. J’ai découvert seulement récemment le petit essai de Nancy Houston Nord perdu. Il faudrait l’étudier à l’école et au lycée, pour sa réflexion sur le statut d’« étranger », où l’on a plus et moins à la fois. Je suis et reste « étranger » en France comme au Luxembourg, et ce n’est pas une question de langue. Le français, je le maîtrise de mieux en mieux. Mais à quel prix ? Celui d’avoir dû oublier parfois ma culture d’origine. Demandez à tous ceux qui font cette expérience en profondeur, le résultat est étonnant. Cela donne une richesse inouïe et en même temps, elle vous invite à une humilité extrême. Vous ne pouvez rien revendiquer de la culture qui vous accueille et pourtant vous la connaissez, et dans votre culture d’origine, vous n’avez plus l’autorité de quelqu’un qui n’a jamais quitté le territoire. Donc oui, le décentrement auquel le plurilinguisme vous habitue est une forme raffinée de prise de distance d’abord avec soi-même, et ensuite avec tout, y compris la foi.

A.H : Peut-on écrire sur Ibn’Arabī, Rûmî et les soufis sans tomber amoureux d’eux ?
Alberto Fabio Ambrosio : Il semble que dans le domaine islamologique des études soufies, bon nombre de spécialistes occidentaux se soient finalement convertis. Cela se comprend parfaitement, car on ne peut pas vraiment travailler sur de si belles perspectives sans être fasciné par celles-ci. Moi, vous l’avez compris, je n’ai aucune envie de me convertir et je n’en ai jamais eu envie. Cependant, je pense qu’étudier Rûmî, et surtout les rituels et la doctrine des derviches tourneurs, m’a aidé à découvrir un autre monde intérieur qui m’est fort utile par moments.
A.H : Le monde, déjà rempli de ténèbres, s’est sauvagement obscurci depuis le 7 octobre 2023. Le monde dit « civilisé » a l’air de sombrer dans la barbarie et l’injustice, car ceux-là qui soutiennent l’Ukraine contre Vladimir Poutine soutiennent aussi Benjamin Netanyahou contre la Palestine et le Liban. Outre le « deux poids, deux mesures », il y a un véritable problème politique et éthique. Comment l’homme de religion et chercheur chevronné aborde-t-il cette actualité brûlante ? De quels outils disposons-nous pour y faire face ?
Alberto Fabio Ambrosio : C’est une très bonne question et je me la pose constamment. Je vous réponds avec « ma » vérité. Cela fait des années que je me prépare à vivre des temps obscurs. Les prémices étaient là depuis bien longtemps. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Alors cela fait déjà un moment que j’ai choisi trois figures pour faire face : Etty Hillesum, juive proche du christianisme morte dans les camps, Dietrich Bonhoeffer, théologien protestant mort lui aussi dans les camps, et enfin sainte Thérèse Bénédicte de La Croix, autrement dit Édith Stein, juive devenue carmélite après sa conversion, morte dans les camps. Tous trois partagent un lieu commun qui représente pour moi un phare dans les temps obscurs : savoir se montrer lucide dans ces moments.
Aujourd’hui, les guerres en cours sont avant tout idéologiques. D’où la difficulté, même à distance des épicentres, d’en parler de manière posée. Au contraire de tout ce que l’on pense, nous sommes déjà tous et toutes un peu muselés par les idéologies, surtout en Europe, mais pas parce qu’on assiste à l’essor des extrêmes droites, comme on peut l’entendre. Non, les idéologies sont là bien avant et au-delà même des partis. Ceux-ci ne font que les chevaucher. Or, l’homme de religion (ou de foi plutôt) que je suis est une sentinelle, car il a le devoir d’essayer de « comprendre » plus que la moyenne grâce à sa lucidité et à son calme. Je dépense beaucoup d’énergie à rester dans une forme de lucidité « neutre » sans prendre de positions nettes, car celles-ci font le jeu de la guerre. Mais je ne suis qu’un simple religieux. Les guerres ne sont pas arrêtées par une forme d’irénisme, qui peut trouver son lieu naturel là où il y a déjà toutes les conditions suffisantes de vie économique et politique pour décréter trop facilement la paix. Le chercheur qui est en moi ne fait que donner les moyens au religieux de rester lucide, en effectuant des recherches, en écoutant toutes les positions et en recueillant toutes les raisons. Oui, le combat des idéologies a définitivement arrêté l’idée de dialogue et d’écoute. Nous sommes entrés dans une phase sombre qui donne l’illusion de se parler et de s’entendre, mais la vérité est qu’une certaine humanité n’a qu’un désir : faire la guerre.
A.H : Si vous deviez tout recommencer, quels choix feriez-vous ? Si vous deviez incarner ou vous réincarner en un mot, en un arbre ou en un animal, lequel seriez-vous chaque fois ? Enfin, si un seul de vos textes devait être traduit dans d’autres langues, en arabe par exemple, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?
Alberto Fabio Ambrosio : Moi qui avais peur des chiens, depuis la pandémie, je suis de plus en plus proche de certains d’entre eux, les golden retrievers en particulier. J’aimerais être un golden retriever dressé pour conduire des aveugles, par exemple à la messe. Près de mon couvent de Paris habite un couple avec un bébé adorable qui vient à la messe avec un retriever dressé pour guider les malvoyants. Je trouve que ces chiens transmettent tendresse et amitié. Et j’aimerais aussi être une rose, un autre symbole sur lequel j’ai commencé à écrire et à donner des conférences.
Tous mes livres ont une spécificité. Il faudra du temps pour qu’on les lise véritablement. Quand les soufis parlent aux chrétiens est une forme de manifeste. D’ailleurs, je crois que c’est mon dernier vrai livre sur le soufisme et sa proximité avec le christianisme.















