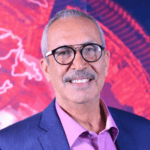Née dans un village rural, Samia Gamal s’élève par son art, sa volonté et ses rêves. Elle transforme la danse orientale et le cinéma égyptien, laissant une empreinte durable, douce et affirmée.
Samia Gamal : « Papillon du cinéma » et icône de la danse orientale
Par Monia Boulila
Née le 5 mars 1924 à Wana, dans le gouvernorat de Beni Suef, sous le nom de Zeinab Ibrahim Mahfouz, Samia Gamal grandit dans une Égypte rurale marquée par la pauvreté. Comme tout conte moderne, son père se remarie avec une marâtre qui la maltraite jour et nuit. Adolescente au sourire solaire, elle est promise par sa belle-mère à l’homme le plus riche du village, qui pourrait être son grand-père.
Zeinab prend alors son acte de naissance en main et défend sa vie devant le juge du village, refusant cette union : à 14 ans, elle est protégée par la loi qui interdit les mariages forcés. Elle rentre chez elle fière de son acte, mais subit la colère de sa belle-mère, qui la frappe violemment. La jeune fille endure cet enfer quotidien, soutenant son père jusqu’à sa mort subite. À 15 ans, sans raison de rester dans cette campagne rugueuse, elle quitte son village pour Le Caire, emmenant avec elle sa demi-sœur.
Très vite, fascinée par la vie urbaine et les spectacles, elle découvre les cabarets et cafés où se produisent des artistes de renom. C’est ainsi qu’elle croise la route de Badia Masabni, grande figure du cabaret cairote, qui l’accueille dans sa troupe et lui donne un nom de scène : Samia Gamal. Dès lors, Zeinab devient Samia, et la scène devient sa seconde maison, où, par sa détermination et son talent, elle allait révolutionner la danse orientale.

Ascension, âge d’or et Rayonnement international
Formée auprès de Badia Masabni, Samia Gamal développe un style personnel, souple et inventif, mêlant danses traditionnelles égyptiennes et influences occidentales et latino-américaines. Elle introduit le voile comme élément chorégraphique et danse parfois pieds nus, symbole de liberté et d’authenticité. Parallèlement à sa carrière de danseuse, elle se distingue au cinéma, apparaissant dans plus de 50 films et devenant une figure emblématique de l’âge d’or du cinéma égyptien. Parmi ses rôles les plus notables :
- Afrita Hanem (1949) : comédie musicale égyptienne réalisée par Henry Barakat, où elle joue Kahramana.
- Akher Kedba (1950) : comédie musicale égyptienne produite par Farid al-Atrash, où elle partage l’écran avec ce dernier.
- Ali Baba et les 40 voleurs (1954) : comédie française réalisée par Jacques Becker, où elle interprète Morgiane aux côtés de Fernandel.
- Le Monstre (1954) : thriller égyptien réalisé par Salah Abou Seif, aux côtés d’Anwar Wagdi.
- Sigara wa Kass (1955) : mélodrame égyptien réalisé par Niazi Mostafa, dans lequel elle incarne Hoda.
Ces films lui permettent de populariser le raqs sharqi auprès d’un large public et d’affirmer sa présence à l’écran, consolidant sa réputation de danseuse et d’icône culturelle. Dans les années 1950, elle se produit dans des lieux prestigieux tels que le cabaret The Latin Quarter à New York et à Deauville, devant le roi Farouk d’Égypte, et entreprend des tournées en Europe et aux États-Unis, soutenue par le ministère égyptien de la Culture. Au début des années 1980, malgré des difficultés financières, elle reprend la scène avec le chanteur et acteur Samir Sabry, confirmant son statut d’icône internationale et poursuivant la diffusion universelle de la danse orientale.
Vie privée
Sa relation avec Farid al-Atrash marque les esprits. Le musicien, figure majeure du monde arabe, éprouve pour elle une profonde affection. Leur complicité artistique est indéniable : ils tournent ensemble plusieurs films et partagent une passion commune pour la musique et la danse. L’amour que Farid lui portait resta sans écho : Samia, fidèle à son indépendance et à son art, choisit de ne pas lier sa vie à la sienne.
Elle épouse ensuite Rochdi Abaza dans les années 1960. Leur mariage dure près de deux décennies. Rochdi a déjà une fille, Kismet, née d’une précédente union avec une Américaine. L’enfant, âgée de trois ans au moment du mariage, grandit auprès de son père et de Samia, qui l’élève avec tendresse. Leur foyer demeure serein et respecté, jusqu’à leur séparation. Samia, restée sans enfants, poursuit sa carrière entre cinéma, cabaret et tournées à l’étranger.
Héritage et influence
L’influence de Samia Gamal dépasse les frontières de l’Égypte. Sa fusion des styles oriental et occidental a inspiré des générations de danseuses dans le monde entier. Des artistes comme Dalilah, qui organisa des tournées en Égypte pour des danseuses américaines, se sont nourries de son style et ont contribué à faire connaître la danse orientale à l’international.
Samia Gamal s’éteint le 1er décembre 1994 au Caire, laissant l’image d’une femme libre, exigeante et fidèle à son art. Partie de la pauvreté rurale pour atteindre la reconnaissance mondiale, elle a modernisé la danse orientale tout en conservant sa dignité et son ancrage culturel. Par sa grâce et sa présence scénique, elle a offert à cet art un visage universel, mêlant puissance et douceur, et continue d’inspirer celles et ceux qui cherchent à faire vivre ce langage du corps et de la liberté.
Son héritage perdure, et à travers chaque mouvement, chaque geste, Samia Gamal continue de célébrer la liberté, la beauté et la force de la danse orientale.
Bibliographie
Sources françaises et anglophones
- Egypt Today, « Samia Gamal: Barefooted Belly Dancer », Angy Essam, 5 décembre 2017.
- Divas Arabes – La diva aux pieds nus : Samia Gamal, Institut du Monde Arabe.
- Ahram Online, « Remembering Samia Gamal: Egypt’s ‘official belly dancer’ ».
- Encyclopaedia Britannica, entrée « Samia Gamal ».
- Serpentine Galleries, article sur les danseuses égyptiennes et l’héritage visuel du cinéma arabe.
Sources arabes
- جريدة اليوم السابع (Youm7) : « حكاية فراشة الشاشة سامية جمال ».
- نجوم إف إم (Nogoum FM) : portrait biographique et témoignages sur sa vie avec رشدي أباظة.
- مبتدا (Mobtada) : dossier sur sa carrière et sa relation avec فريد الأطرش.
- المصري اليوم : archives culturelles sur les grandes actrices égyptiennes de l’âge d’or.