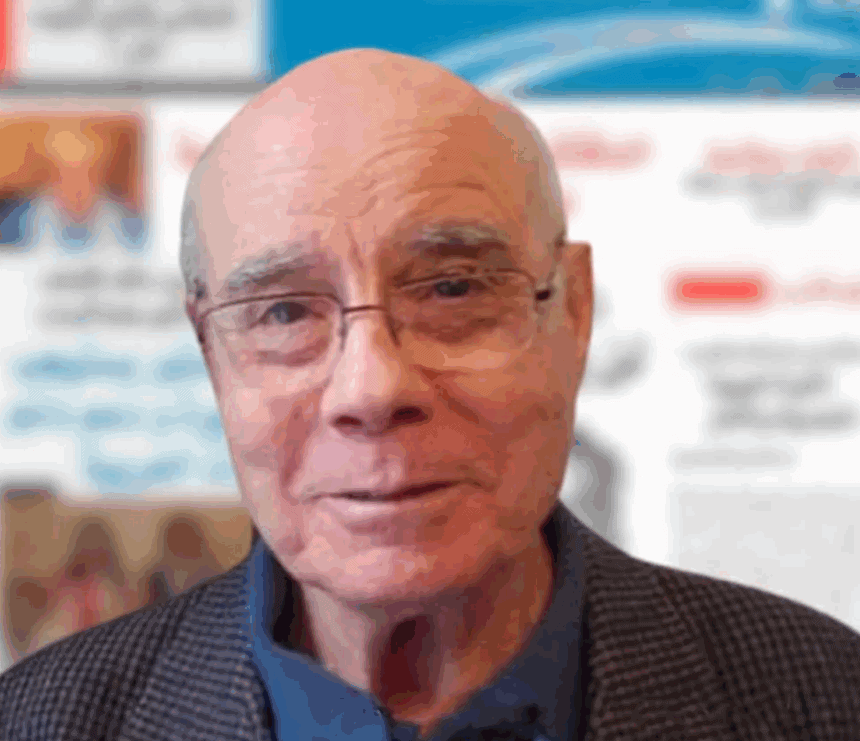À 85 ans, Hichem Skik revient sur son parcours de linguiste, de militant politique et de journaliste, et partage sa vision de la Révolution tunisienne et des enjeux contemporains.
Hichem Skik : combat pour la liberté, la démocratie et la parole
Les jeudis littéraires d’Aymen Hacen
Né le 2 août 1940 à Tunis, Hichem Skik a été hercheur en linguistique au CERES (Centre d’Études et de Recherches Économiques et Sociales et a enseigné la linguistique générale, la linguistique française et la traduction à l’Université, (d’abord à Tunis, puis à la Manouba). Militant politique et syndical, il a été Membre du Bureau politique du Parti Communiste Tunisien, ensuite du Mouvement Ettajdid puis du Parti Al Massar et Directeur de la Rédaction du journal Attariq Aljadid. Actuellement Président du Forum Mountada Ettajdid et Directeur de collection aux éditions Nirvana, il vient de publier (à l’occasion de son 85e anniversaire) un volume intitulé Écrits pour la liberté et le progrès, préfacé par l’ancien ministre et actuel Président de l’Académie tunisienne Beït El Hikma, M. Mahmoud Ben Romdhane.
A.H : Ce volume, Écrits pour la liberté et le progrès, réunissant des textes publiés entre 2001 et 2024 et composé de deux grandes parties : « Écrits pour la liberté et le changement démocratique (2001-1er janvier 2010) » et « La Révolution, la transition démocratique… (22 janvier 2011-2024) », témoigne d’une grande implication dans les affaires nationales et internationales, politiques et géopolitiques.
Pouvez-vous nous relater votre formation et comment ces intérêts, aussi passionnés que passionnants, ont-ils occupé votre vie ?
Hichem Skik : Concernant mes études, j’ai fréquenté plusieurs « écoles primaires franco-arabes », au gré des changements d’affectation de mon père, instituteur puis professeur-adjoint dans un lycée. La dernière de ces écoles était l’annexe du Collège Sadiki.
Après de études secondaires au Collège Sadiki Khaznadar (qui deviendra après l’indépendance de la Tunisie le Lycée Khaznadar), je suis parti en France pour des études en langue et littératures françaises à la Faculté des Lettres de Montpellier.
Après avoir obtenu ma licence, j’ai rejoint Paris pour y préparer l’Agrégation de français.
À cette époque, il fallait, pour pouvoir passer le concours, avoir effectué un stage dans un lycée et obtenu un « Diplôme d’Etudes Supérieures (D.E.S.). J’ai effectué mon stage au Lycée Charlemagne à Paris et j’ai soutenu un mémoire de DES de littérature comparée intitulé « Le thème du ‘jaloux’ dans la poésie andalouse et la poésie des troubadours ».
N’ayant pas réussi au concours d’agrégation cette année-là, j’ai décidé de ne pas m’y présenter l’année suivante, comme le font la majorité des candidats à ce concours, très sélectif et auquel très peu réussissaient du premier coup. C’est que je venais de découvrir une discipline toute nouvelle pour moi, et qui venait de connaître un renouvellement profond, tant aux États-Unis qu’en Europe, et surtout en France, parallèlement au développement du structuralisme dans les sciences humaines et sociales. Je veux parler de la linguistique, en particulier la linguistique structurale, dont le « ponte » était André Martinet.
En suivant les séminaires de Martinet à l’École Pratique des Hautes Etudes, je me suis passionné pour cette discipline et pour son approche d’une grande rigueur scientifique (dans l’analyse phonologique, notamment), et, en même temps, prenant largement en compte la dimension sociale des phénomènes de langue ― approche qui a donné lieu au développement spectaculaire d’un champ particulier de la linguistique, la sociolinguistique.
J’ai donc préparé, sous la direction d’André Martinet, une thèse de « Doctorat en linguistique générale et appliquée » et, rentré en Tunisie, j’ai, comme vous le rappelez en préambule, intégré le CÉRES, un centre de recherches qui avait été créé quelques années auparavant, et qui a permis un développement remarquable de la recherche en sciences sociales dans notre pays. Et par un hasard tout aussi remarquable, ce Centre a vu la création en son sein, dès le départ, une section de linguistique et ce, grâce à un précurseur : mon ami Salah Garmadi, qui était aussi arabisant, traducteur, poète et écrivain. J’y ai mené des recherches sociolinguistiques sur le bilinguisme (il est à noter que, à cause de mes opinions politiques, les autorités ont refusé mon recrutement au CÉRES. J’y ai donc travaillé quatre ans sans recevoir le moindre salaire !)
En 1980, j’ai rejoint le département de français à la Faculté des lettres de Tunis puis celle de la Manouba (qui venait d’être construite dans un endroit isolé de la périphérie de Tunis, dans le but essentiel d’éloigner du centre de la Capitale les étudiants, leur agitation, leurs grèves, leurs manifestations contre le pouvoir …)
J’y ai enseigné ― ainsi qu’à l’École Normale Supérieure ― et pendant une quarantaine d’années la langue française, la traduction et, surtout, la linguistique générale et la sociolinguistique.
Maintenant, concernant le volet politique et syndical de mes activités, je peux dire que j’ai baigné, dès mon enfance, dans un milieu familial assez politisé : mon père a été, avec d’autres instituteurs tunisiens, à l’origine de la création, en 1936, du premier syndicat d’instituteurs purement tunisien, dont il a été le premier Secrétaire général (pour deux mandats).
Je pense que j’ai dû subir aussi l’influence de ma mère, très attentive, elle aussi, à la chose publique : elle ne ratait pas les infos de 20 heures à la radio puis à la télé ; il lui est arrivé même de participer à des manifestations politiques, auxquelles elle m’amenait. Plus tard, le 18 janvier 1952, j’ai pris part ― probablement par mimétisme vis-à-vis de nos aînés du Collège Sadiki ― à une grande manifestation patriotique organisée dans le cadre de la vague de protestations à la suite de l’arrestation des dirigeants nationalistes, communiste et syndicalistes. Partie de Sadiki vers le siège de l’UGTT (qui était située, à cette époque, dans la Médina de Tunis), notre manifestation a été accueillie par Farhat Hached, qui nous a harangués du haut du balcon de la Centrale syndicale. L’année suivante-exactement le 5 décembre 1952- j’ai vécu avec émotion la manifestation des élèves du Collège Khaznadar pour protester contre l’assassinat de Farhat Hached par les forces coloniales.
Sur le plan intellectuel, le cours de philo au lycée a joué un rôle décisif ― pour moi comme pour de nombreuses générations d’élèves tunisiens ― dans le sens de l’ouverture de nos esprits sur le monde (ceci avant la réforme catastrophique des années 70 qui a pratiquement vidé son enseignement de tout esprit critique et de toute ouverture sur le monde, sous prétexte d’arabisation !). Ensuite, en France, mes lectures, ma participation aux activités de l’UGET, mon contact avec les luttes démocratiques menées par des organisations françaises (UNEF, PCF, CGT…) contre la guerre en Algérie m’ont rapproché des idées de gauche et de l’action militante. Mon premier contact avec le Parti communiste tunisien date de l’été 1962. Le Parti a été interdit quelques mois plus tard, ce qui m’a encouragé à faire le pas d’y adhérer immédiatement. J’y milite depuis, participant à ses luttes, dans la clandestinité (cela m’a valu d’être arrêté, jugé et condamné à de la prison ferme) puis après sa re-légalisation, et accompagnant ses évolutions et ses mutations (et y contribuant à différents niveaux de responsabilité) de PCT à « Mouvement Ettajdid » à « Parti al Massar démocratique et social ».
Et c’est à ce titre que m’a été confiée ― en plus de mes responsabilités politiques comme membre du Bureau politique ― la direction de la rédaction du journal Attariq Aljadid, avant et après la Révolution…
A.H : Vous semblez croire dur comme fer en la Révolution de 2011, alors que beaucoup de voix se mettent à y douter. Pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez ?
Hichem Skik : J’ai ― je dirais « nous » ― avons vécu la Révolution comme un tournant historique qui a vu le peuple tunisien reprendre son rôle d’acteur de son propre destin, rôle dont il a été dépossédé depuis l’indépendance.
Bien évidemment, et comme toutes les révolutions, le déroulement de la nôtre, tout au long de ces vingt-quatre ans, n’a pas été un long fleuve tranquille, loin s’en faut ! Un processus complexe, chaotique, parfois dramatique, laissant craindre un échec total et le risque d’un retour en arrière : mainmise des partisans de l’Islam politique sur les rouages de l’État, avec la complicité de deux partis laïcs, actes terroristes sanglants visant la stabilité du pays et l’expérience démocratique, ingérences étrangères, manque d’expérience et erreurs des partis politiques et de la société civile etc. tout ceci sur fond d’une grave crise économique, aggravée par la crise du monde capitaliste, notre principal partenaire économique… Nous avons parfois craint de tomber dans un chaos institutionnel, économique et social, ce qui a été mis à profit pour nous mener vers la dérive autoritaire que nous vivons en ce moment…
Mais, malgré toutes ces difficultés, on a pu constater que la société trouvait chaque fois en elle-même les ressorts suffisants pour se relever, trouver des solutions et avancer de nouveau (toujours cahin-caha, il faut l’avouer !)… C’est pour cela que je continue à avoir confiance dans la capacité de notre peuple et de ses élites à traverser les crises et à aller de l’avant pour réaliser ou parachever les objectifs de la Révolution : « Pain, Liberté, Dignité nationale ».
Malgré toutes les tentatives actuelles de noircir le tableau de la période écoulée depuis 2011, on ne doit quand même pas oublier que l’Islam politique a été contraint de quitter le pouvoir sans voir atteint ses objectifs de contrôle des rouages de l’État, d’ « islamisation » de la société, de remise en cause de ses acquis progressistes tels que les droits des femmes, le terrorisme nous a portés des coups douloureux, mais il a été vaincu et pratiquement éradiqué, les libertés acquises depuis 2011 sont certes menacées sérieusement ces jours-ci, mais je crois fermement qu’elles ne pourront plus être durablement remises en cause…
Donc, les difficultés politiques et économiques sont grandes, voire dangereuses, mais je reste raisonnablement optimiste quant à notre capacité de les surmonter.
A.H : Dans sa préface, M. Mahmoud Ben Romdhane écrit à votre propos : « Il appartient, avec Ahmed Brahim et Jounaïdi Abdeljaouad, à un trio que j’ai connu de près, voire de très près, depuis 2001. Ils sont unis, solidaires par leur histoire commune, chacun ayant son lieu de déploiement préféré : Jounaïdi pour les combats syndicaux et les luttes sociales ; Hichem pour le journal, la société civile et les droits humains ; Ahmed pour les apparitions publiques et les campagnes électorales difficiles (un tribun battant non démagogue). Ce trio est le trio emblématique du combat démocratique, progressiste et moderniste de la société tunisienne depuis le milieu des années 1960. » (p. 11)
Avec la disparition de Sid’Ahmed Brahim le 14 avril 2016, quid de ce constat ?
Hichem Skik : Nous sommes, en effet, avec Rchid Mcharek, les plus anciens parmi les militants qui ont connu à la fois le PCT clandestin, le retour à la légalité, la formation du Mouvement Ettajdid puis du Parti Al Massar. Ahmed Brahim, qui m’était très proche, nous a, malheureusement, quittés trop tôt, à un moment où il était au summum de sa maturité politique et commençait à jouer un rôle très positif dans le passage d’Al Massar d’un parti d’opposition à un parti capable d’assumer des responsabilités dans la conduite des affaires d’un pays en pleine transition démocratique. Je suis convaincu que s’il avait été avec nous, beaucoup de choses se seraient passées autrement, au sein du Parti comme dans le pays.
A.H : Francisant de formation, vous avez écrit de nombreux articles et plusieurs volumes en langue arabe. Ainsi, nous semble-t-il, vous passez naturellement du français à l’arabe. Pourriez-vous nous expliquer votre démarche ?
Hichem Skik : Comme la plupart des enfants de ma génération (et plus particulièrement les garçons, plus scolarisés alors que les filles) j’ai été scolarisé dès l’école primaire dans le système de l’enseignement dit « franco-arabe » d’inspiration sadikienne, institué par les autorités du Protectorat. Ce système était fondé sur un bilinguisme intégral qui, certes, faisait la part belle à la langue française-qui était à la fois enseignée comme langue, mais qui était aussi la langue dans laquelle étaient enseignées la plupart des autres matières ― en particulier les matières scientifiques ― mais où la langue arabe était réellement valorisée comme langue d’enracinement dans la culture nationale, d’essence arabo-musulmane.
Mon père, formé lui-même à l’Ecole normale d’Instituteurs, elle aussi franco-arabe, était ce qu’on appelait « un instituteur bilingue », enseignant à la fois l’arabe et le français. Il lisait quotidiennement le journal La Presse, nous achetait des livres en arabe et des livres en français etc. Plus tard, j’ai fait des études supérieures en langue et françaises, mais j’ai aussi choisi, comme je l’ai mentionné, de mener une recherche pour le DES portant à la fois sur la littérature arabe et celle des poètes occitans… Ces facteurs conjugués m’ont permis d’avoir très tôt, et pendant toute ma vie, un rapport pratiquement aussi intime avec chacune des deux langues.
Concernant le journal Attariq Aljadid, il paraissait initialement en langue arabe, exclusivement. Lorsque j’en ai pris la direction, j’ai proposé ―et défendu ―l’idée d’en faire un journal bilingue, parce que nombreux étaient les Tunisiens qui lisaient plus facilement le français que l’arabe et aussi pour ne pas se priver de la contribution au journal de nombreuses compétences s’exprimant plus facilement en français.
C’est donc tout naturellement que, le journal devenu bilingue, je rédigeais mes articles tantôt en arabe, tantôt en français, selon le sujet traité, le public visé, l’inspiration du moment…
A.H : Le monde, déjà ténébreux, s’est sauvagement obscurci depuis le 7 octobre 2023. Le monde dit « civilisé » a l’air de sombrer dans la barbarie et l’injustice car ceux-là qui soutiennent l’Ukraine contre Vladimir Poutine soutiennent Benjamin Netanyahou contre la Palestine, le Liban, l’Iran et aujourd’hui le Yémen. Outre le deux poids deux mesures, il y a un véritable problème politique et éthique. Comment vivez-vous cette actualité brûlante ? De quels outils disposons-nous pour y faire face ?
Hichem Skik : Je vous avoue que je vis cette actualité avec beaucoup de douleur et d’inquiétude pour l’avenir.
Il y a, en effet, et comme vous le dites si justement, un « ensauvagement » général du monde.
On avait cru, pendant ces quatre-vingt années où on n’avait pas connu de guerre mondiale, que l’humanité avait tiré les leçons des errements du passé et des conséquences catastrophiques d’un monde où régnaient la loi du plus fort et les appétits les plus voraces des grandes puissances. La paix que nous vivions (une paix relative, car il y avait de nombreuses guerres régionales à travers le monde) nous donnait l’illusion que le monde s’était définitivement assagi. La libération des pays qui étaient sous le joug colonial confortait cette impression que l’ère de l’asservissement d’un peuple par un autre peuple était révolue et que tous les peuples pouvaient aspirer à ce que leur droit à la dignité et à la souveraineté fût respecté comme un droit reconnu par tous et consigné dans de multiples chartes et traités internationaux.
Même les dernières séquelles de l’ère coloniale nous semblaient devoir ne pas échapper ― à terme ― à cette évolution historique. Je veux parler de la question palestinienne.
Or, ce que nous vivons, surtout ces deux dernières années, ce n’est pas seulement le prolongement d’une situation coloniale anachronique, ce n’est plus seulement la privation d’un peuple de sa terre et de sa souveraineté : non ! C’est bien plus grave ! C’est le retour des pires formes prises par des régimes responsables de la dernière guerre : le nazisme, le nettoyage ethnique, la tentative de faire disparaître tout un peuple afin d’usurper sa terre et ses ressources.
Le plus insupportable, c’est de voir que cette atroce politique de terreur, de génocide est directement et sans honte soutenue par des pays dans lesquels se sont le plus développées-et, croyions-nous, définitivement enracinées- les nouvelles valeurs de liberté, de droits de l’homme, de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes…
Il s’avère que ces pays ― ou plutôt les gouvernements qui les dirigent et les puissances d’argent qu’ils représentent ― ne croient, en fait, qu’à leurs intérêts et que leur attachement à la démocratie est purement formel et déclaratif et s’adapte sans vergogne aux pires situations de violation flagrante de la démocratie et des droits humains.
Ce comportement pousse certains- par réaction épidermique ou par calcul politique ou idéologique- à renier ces valeurs humaines, sous prétexte que ce sont de pures inventions de ces puissances pour habiller et masquer leurs entreprises criminelles aux dépens des peuples.
Personnellement, je reste convaincu que le respect des droits humains, la reconnaissance des droits des peuples, de l’égalité totale entre les humains, quels que soient leur sexe, la couleur de leur peau, leurs croyances etc. constituent des conquêtes précieuses de l’humanité sur le chemin de sa libération des carcans des anciennes croyances et systèmes qui asservissaient l’être humain. Lutter pour obtenir ces droits et les élargir reste un objectif éminemment noble qui mérite tous les sacrifices. Ceux qui manipulent ces valeurs, les instrumentalisent pour des fins inavouables, les appliquent selon le principe de « deux poids deux mesures » … ceux-là ont trahi ces principes, ils doivent être dénoncés et combattus.
Je reste convaincu que les peuples réussiront à combattre ces dérives. J’aime à croire que les dirigeants d’Israël et leurs complices occidentaux finiront par être jugés et très sévèrement condamnés comme étant de grands criminels.
Je suis, en particulier, certain que le grand peuple palestinien, qui fait en ce moment preuve d’une capacité de lutte, de résistance et de résilience admirables, finira par obtenir son droit naturel à la souveraineté, à la dignité et à la paix.
A.H : En vous réitérant nos meilleurs vœux de santé et de prospérité à l’occasion de votre 85e anniversaire, nous voudrions vous poser ces questions : si vous deviez tout recommencer, quels choix feriez-vous ? Si vous deviez vous incarner ou vous réincarner en un mot, en un arbre, en un animal, lequel seriez-vous à chaque fois ? Enfin, si un seul de vos textes devait être traduit dans d’autres langues, en arabe par exemple, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?
Hichem Skik : Oh ! Merci beaucoup pour vos vœux ! Trop difficile de répondre à vos questions !
Je vais essayer quand même, puisque c’est un jeu.
Si je devais recommencer ma vie ? Je ne me vois sincèrement pas faire, pour l’essentiel, des choix très différents de ceux que j’ai faits ou que les circonstances m’ont poussé à faire !
Si je devais me réincarner, j’aimerais bien que ce soit en un jasmin : une plante vivace, souple, résistant aux difficultés et une plante que je trouve altruiste, offrant généreusement ses fleurs et ses senteurs au passant.
Quel texte j’aimerais voir traduire ?
Difficile ! J’en vois peut-être vois trois, qui représentent tous les trois des cris du cœur :
― Celui intitulé « Sidi Bouzid : un cri de détresse, auquel il faudra ouvrir toutes grandes nos oreilles ! ». Un texte écrit le 1 janvier 2011, sous l’émotion suscitée en moi par la nouvelle du jeune homme qui venait de s’immoler par le feu et dont le geste a été un catalyseur de la révolte de la jeunesse tunisienne contre une situation qui les condamnait au désespoir. La révolte ne s’était pas encore transformée en révolution, mais le texte affirmait « ce qui s’est passé, ce qui se passe encore aujourd’hui et ce qui se passera, n’en doutons pas, demain, tout cela nécessite ni plus ni moins qu’une remise en question totale de l’ensemble d’un système qui est en train de mener notre pays à l’impasse ». Treize jours plus tard, le 14 janvier 2011, Ben Ali prenait la fuite, ouvrant la voie à ce que je persiste à appeler ― malgré la controverse sur cette appellation ― la Révolution tunisienne
― Celui intitulé « Tunisien, Tajdidien et fier de l’être ». Un texte écrit deux mois environ après les événements du 14 janvier 2011 : le titre donne une idée du contenu…
― Le troisième est celui intitulé « Le frère manquant ». C’est le texte d’une interview que j’ai accordée à la talentueuse journaliste au journal La Presse, Héla Lahbib, au cours de la cérémonie que nous avions organisée à l’occasion du 40e jour du décès d’Ahmed Brahim. J’y exprimais toute la considération et l’amitié que j’éprouvais pour notre cher disparu et tout le vide que laissait en moi son départ prématuré.