Dans La Marraine amoureuse, Benoît Marbot met en scène le soldat Anatole, un volontaire de 1914 en permission, et Clémence, une bourgeoise des beaux quartiers parisiens.
La Marraine amoureuse : du comique de tranchée à l’émotion vraie
Par Rodolphe Ragu
Dans La Marraine amoureuse, Benoît Marbot met en scène le soldat Anatole, un volontaire de 1914 en permission, et Clémence, une bourgeoise des beaux quartiers parisiens. Opposition des sexes, de styles et des classes sociales : l’auteur exploite tout le potentiel d’humour dont regorge ce genre de situations, sans négliger la fibre sentimentale.
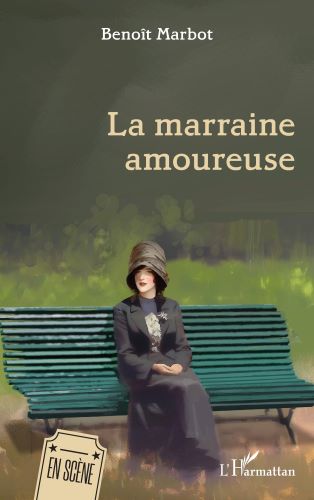
Clémence et Anatole : la guerre, le désir et les bons mots
Assis dans mon café préféré, à côté du théâtre du Châtelet, je commence à lire La Marraine amoureuse, de Benoît Marbot. Rapidement, je souris, puis je mets à rire franchement, entre deux tables occupées par d’autres clients. « Votre livre a l’air plein d’humour ? » me dit-on. C’est le cas en effet. La Marraine amoureuse est en effet une pièce très efficace pour remuer les zygomatiques du lecteur. Benoît Marbot, auteur d’une vingtaine d’œuvres, maîtrise très bien tous les ressorts du comique et les techniques, qui pour être séculaires, n’ont rien perdu de leur efficacité.
Deux personnages sont en scène : Anatole Langeron et Clémence Boliveau. Nous sommes en 1915 et Anatole, un jeune poilu, qui bénéfice d’une permission, rencontre sa marraine de guerre (une « marraine de guerre » est la correspondante épistolière d’un soldat sur le front, qui essaie par ses lettres de le soutenir dans son sacrifice pour la patrie). Seulement voilà, Anatole, qui n’a encore jamais connu les plaisirs de la chair, n’a pas traversé à rebours les champs dévastés de la Marne pour se contenter de câlins et de petits mignotages sur un banc, au jardin du Luxembourg. Et s’il consent à l’idée de mourir pour son pays, il n’est tout de même pas prêt à accepter l’idée de mourir puceau. Anatole le sans-grade est donc assez direct dans son approche tactique : – Clémence : Où vouliez-vous passer la nuit ? – Anatole : chez vous ! – Chez moi ? – Avec vous. – L’idée ne vous est pas venue que je pourrais vous refuser mon lit ? – Je peux dormir n’importe où. Clémence est nettement plus âgée que son jeune soupirant. Issue de la bourgeoisie parisienne, elle tient beaucoup au respect des convenances – elle est veuve de guerre – et à un langage approprié. Ce qui n’est pas le cas d’Anatole, qui a dérobé sans barguigner la montre d’un camarade, mort dans les tranchées, et qui s’exprime naturellement en argot pour justifier son acte : « Je n’allais pas me dégraisser pour une tocante. » Clémence, sans être insensible au charme de son correspondant, ne se laisse pas faire et repart à la drague un peu lourde et maladroite d’Anatole en lui conseillant d’aller « essayer son talent sur les professionnelles ». Mais elle n’est en fait pas aussi prude qu’elle le laisse croire. Elle accepte sans le dire de passer la nuit avec lui. – Anatole : Nous pouvons coucher ensemble sans nous accoupler. – Clémence : Et sans nous toucher. – Nous ne sommes pas des bêtes. – La guerre n’autorise pas tout… Le lecteur comprend que leur insistance à nous persuader qu’il ne va rien se passer entre eux fonctionne en fait comme la dénégation d’un malade sur le divan d’un psychanalyste. C’est efficace. On le voit : l’opposition fonctionne à plein entre deux personnages que tout oppose par la mécanique du comique de contraste. Et le comique de répétition, soutenu par des jeux de mots, donne aussi sa pleine mesure.
Du comique à l’émotion
Anatole Langeron et Clémence Boliveau vont se retrouver tous les ans jusqu’à la fin de la guerre : leur relation évolue et ils doivent affronter les problèmes que rencontrent tous les couples. La question sociale affleure au moment où Anatole prend littéralement du galon, car Clémence demeure une bourgeoise et Anatole, un prolétaire. Il continue à s’exprimer dans un immeuble haussmannien comme dans la boue des tranchées et surtout parle d’égal à égal avec les domestiques, ce qui est shocking pour Clémence, qui aime à se moquer de son maladroit amoureux et de son manque d’éducation.
L’atmosphère, drôle, légère au début, devient plus grave au fil des actes de cette courte pièce. Une tension, émouvante et empreinte d’onirisme s’installe même dans les derniers moments du dialogue pour une fin qui joue clairement sur la corde sensible. Il y aura des choix à faire pour la mise en scène, qui insistera sur le comique ou sur l’émotion et le sentiment, ou bien conciliera les deux tendances.
Un auteur au beau parcours
Benoît Marbot a publié sa pièce aux éditions L’Harmattan (c’est aussi le cas de quelques-unes de ses pièces précédentes). Chacun sait comment fonctionne le processus de publication dans la maison fondée par Denis Pryen et Robert Ageneau : c’est le système du compte d’auteur. En gros, l’auteur achète les cinq cents premiers ouvrages à son éditeur, qui rentre ainsi dans ses frais. De même, chacun sait que L’Harmattan est souvent l’unique solution pour les auteurs qui ont essuyé les refus des autres maisons d’édition. Et il faut reconnaître que ces refus sont souvent justifiés. Mais des statistiques, il ne faut pas toujours en dériver une règle absolue. La Marraine amoureuse est une bonne pièce de théâtre (elle a été retenue dans la sélection du concours « Vivons les mots »), qui aurait mérité l’attention des maisons d’édition qui ont pignon sur rue, à savoir un plan de communication et un service après-vente pour mettre en valeur le talent de Benoît Marbot. Sa prochaine pièce recevra d’ailleurs l’honneur d’être créée au Français. Que puis-je ajouter de plus ?















