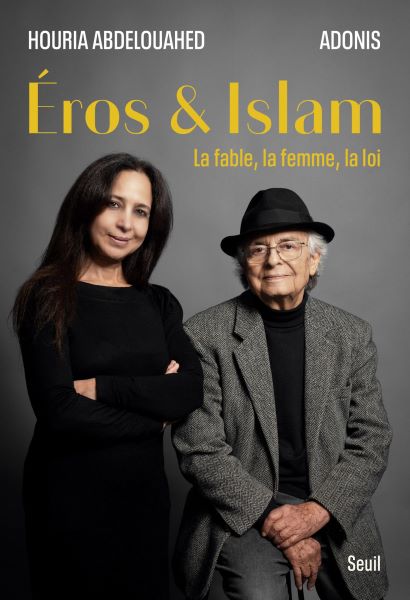Professeure, psychanalyste et traductrice, Houria Abdelouahed explore la condition féminine, la pensée critique et la poésie arabe aux côtés d’Adonis, dans un dialogue unique entre littérature et psychanalyse.
Entretien avec Houria Abdelouahed :
« Je préfère dire que je suis une héritière des Lumières »
Les jeudis littéraires d’Aymen Hacen
Houria Abdelouahed : entre psychanalyse, écriture et dialogue avec Adonis
Professeure des Universités (Université Sorbonne Paris Nord), psychanalyste, traductrice de l’arabe vers le français, Houria Abdelouahed est l’autrice de nombreux ouvrages sur la condition féminine dans le Monde arabe et l’islam, dont Figures du féminin en islam (PUF, 2012), Les femmes du prophète (Seuil, 2016), Nashwat al-jasad (Ravissement du corps. Beyrouth, 2020) et Face à la destruction. Psychanalyse en temps de guerre (Éditions des Femmes, 2022).
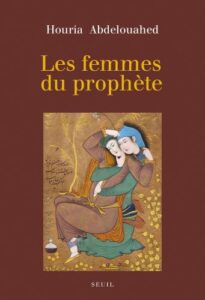
Avec Adonis, dont elle a traduit, aux éditions du Seuil, la trilogie Al-Kitâb (Le Livre, 2007, 2013 et 2015), elle a publié Diwân de la poésie arabe classique (Gallimard, coll. « Poésie », 2009), ainsi que quatre volumes d’entretiens : Le regard d’Orphée, Fayard, 2009 ; Violence et Islam, en 2015, Prophétie et Pouvoir, en 2019, et, en mars 2025, Éros & Islam aux éditions du Seuil.
A.H : Votre relation avec le grand poète Adonis est des plus passionnantes. Plusieurs volumes réalisés ensemble, entre traduction et dialogues. Pouvez-vous nous en raconter l’histoire, la genèse et l’évolution ?
Houria Abdelouahed : Jeune lycéenne, j’ai entendu parler d’Adonis comme l’auteur du Thâbit wal-mutahawwil (Le fixe et le mouvant). Des années plus tard, lors du premier congrès de psychanalyse de langue arabe qui eut lieu à Beyrouth (2004), organisé par Adnan Houbballah (et qui avait pour titre : Al-nafs ‘inda al-’arab (L’âme chez les arabes), Mustapha Safouan m’a parlé d’Al-Kitâb (Le Livre) d’Adonis en disant : « C’est un livre révolutionnaire ». J’ai, ensuite, écouté la conférence d’Adonis sur le manque de subjectivité dans la culture salafiste.
Cette conférence me plongea dans une grande perplexité. Adonis parlait de la subjectivité, de la langue, la parole, la psyché, la nomination… thèmes auxquels j’étais familière dans la discipline qui était la mienne, la psychanalyse. Toutefois, sa parole de poète était pétrie d’une pensée de déconstruction qui faisait chanceler mes acquis théoriques, notamment autour de la religion. Je me suis présentée après sa conférence et lui ai fait part de mon désir de lui communiquer quelques-uns de mes articles sur la langue, l’image et le féminin. Ce que je fis dès mon retour à Paris où je me procurai Al-Kitâb. Avec une rapidité exemplaire, Adonis lut les articles et me proposa de traduire avec lui le Dîwân de la poésie arabe classique. C’est ainsi que commença notre collaboration.
Mais ma rencontre avec Adonis reste liée à l’évènement d’Al-Kitâb, livre époustouflant et unique dans le monde de la poésie. L’étonnement devant la structure et la pluralité des formes qui le traversent, et qui posent la question de : « comment le lire ? », s’accompagnait pour moi d’un sentiment d’inquiétante étrangeté.
J’étais interpellée personnellement et en tant qu’analyste : Le poète, guidé par sa pulsion d’exhumer, reconstruisant l’histoire des arabes, restitue la part de vérité historique : un legs ensanglanté qui demeurait dans le déni ou les îlots blancs de la mémoire collective. Le narrateur devient le processus de remémoration dans son lien indissoluble à la construction. Raconter, depuis ce lieu de révolte et de construction permet de psychiser, d’historiser, en transmuant le non accepté en un événement advenant à soi-même et aux autres. Rompant avec le déni, le poète qui ― dans la narrativité ― enterre les morts, « fixent une place aux vivants », comme le dit Michel de Certeau. Aujourd’hui, je pense que ces thèmes qui constituent la trame d’Al-Kitâb sont très présents dans Le regard d’Orphée et les trois volumes de Violence et islam et constituent le projet d’une interrogation-analyse-écriture et perlaboration : le passé est repris dans une démarche de déconstruction et de défétichisation nécessaire afin qu’une historisation soit enfin possible.
A.H : Éros & Islam est saisissant à bien des égards, à commencer par la manière dont vous interpelez votre interlocuteur : « L’idée de terminer nos entretiens par une réflexion sur Éros s’est imposée car nous avons constaté que l’Arabie ― qui avait connu à l’époque préislamique des odes sublimes sur l’amour ― devint le lieu d’une Révélation où la seule évocation du vocable est réservée à l’amour entre Dieu et ses sujets croyants. »
S’en suit, une réponse d’Adonis basée sur le Coran, puis vous relancez avec Camus et Le Mythe de Sisyphe, etc. Or, Éros & Islam, comme Violence et Islam et Prophétie et Pouvoir, contient une vraie table des matières, ce qui signifie qu’il existe un ordre et un acheminement. Est-ce bien le cas ? Autrement dit, avez-vous conçu un plan avec Adonis ou bien c’est après coup que vous avez défini les titres et les sous-titres ?
Houria Abdelouahed : Il faudrait d’abord rappeler que Violence et islam est sorti en même temps que le troisième volume d’Al-Kitâb. René de Ceccatty – qui est notre éditeur- nous a demandé un entretien ou un texte afin d’accompagner la publication d’Al-Kitâb 3. Violence et islam s’est imposé : Nous étions en 2015. Et face aux attentats en France et la barbarie de Daesh, il fallait une réflexion sur les assises pulsionnelles de l’islam et de la culture musulmane et donc une déconstruction de l’histoire légende. Il est vrai que le monde arabo-musulman est sous-analysé, comme le disait J. Berque.
Les intellectuels de cette contrée du monde n’osent pas interroger un corpus dont la fétichisation empêche une véritable réflexion sur les conséquences de l’absence du meurtre du fondateur en islam, l’absence d’une société civile, la confiscation des libertés et l’échec du Printemps arabe. Interroger équivaudrait à regarder Méduse en face.
Pour chaque livre, il fallait lire et relire les ouvrages de référence, réétudier les textes coranique et du fiqh. On ne peut que déplorer l’immense fossé qui sépare la mystique, la philosophie, la poésie et le corpus du fiqh qui forclôt toutes les possibilités d’interprétation et condamne jusqu’à l’ombre de la pensée. Nous avons, donc, soulevé les conséquences d’un tel empêchement de la pensée : l’archaïsme, la non égalité des individus devant le droit, l’assujettissement des femmes à des règles tribales, la confiscation des libertés, l’inexistence d’une société civile …
Comme pour chaque livre, on a une idée des sujets qui seront traités, mais le livre s’écrit en quelque sorte.
Adonis est un poète. Et comme dit Freud : Les poètes parviennent à dire en un éclair ce que les analystes peinent pendant des années à construire. D’où, en général, la difficulté d’un échange entre un poète et une analyste. Dans notre cas, le dialogue n’a jamais cessé. Et il y a une telle amitié et une telle complicité de pensée que ce travail a été possible.
Éros et islam commence effectivement par cette question qu’on ne pouvait éluder : l’absence d’amour dans un Texte fondateur révélé dans l’Arabie des Mu’allaqât qui rendent hommage à la femme et à l’amour.
Pour réfuter le vocable de jâhiliya (période d’erreur et de paganisme), il fallait rappeler les héritages mésopotamien, égyptien et grec, relire la poésie préislamique et également les œuvres de toux ceux qui ont été bannis par l’islam orthodoxe.
René de Ceccatty ― que je remercie d’avoir publié les trois volumes ―, lisait le texte au fur et à mesure de son avancée. C’est ainsi que le dernier chapitre sur le sémitisme et l’antisémitisme transcende la vision politique pour s’inscrire dans une dimension philosophique et anthropologique.
A.H : « L’Occident exploite ce qui existe déjà, à savoir la faille. D’où vient la faille ? Nous avons vu le chaos qui est né du printemps arabe : la régression chaotique d’un pays qui était lumineux à l’époque abbasside et qui avait amorcé une avancée extraordinaire au XXe siècle. La ville de Mossoul, qui vit naître le grand musicien Ibrahim al-Mawsili, est devenue le fief de Daech et vit aujourd’hui comme au Moyen Âge ; la Syrie est brisée alors qu’elle était le pays qui n’avait aucune dette internationale ; la Tunisie peine à se relever ; la Libye a vu renaître l’esclavage. Les peuples regrettent, aujourd’hui, leurs anciens dictateurs comme s’il n’y avait pas d’alternative dans le monde arabe », dites-vous dans la dernière partie intitulée « Sykes-Picot : le nouveau califat ottoman et la complexité du présent ».
Ce que vous dites est certes vrai, mais ni la Révolution française ni aucune autre n’a abouti du jour au lendemain. L’exemple de la Tunisie est significatif avec ce qu’Adonis lui-même reconnaît comme une prouesse qui tient toujours grâce à l’esprit éclairé de Bourguiba. Que pensez-vous de ce modèle et pensez-vous qu’il soit pérenne, d’autant plus qu’il existe un témoignage poignant du roi Hassan II à ce propos ?
Houria Abdelouahed : Dans Al-harâfîsh, traduit par La chanson des gueux, Naguib Mahfouz s’interroge sur la succession des despotes. Et il conclut : « Leur force vient de notre faiblesse. »
Ce livre pose la question de la faille au sein de la structure sociétale et politique.
Les trois volumes de Violence et islam s’attellent à soulever la question du despotisme et celle de l’interdit de pensée au sein des sociétés arabo-musulmanes, structurellement différentes des sociétés occidentales.
On ne peut comparer le printemps arabe à la révolution française ― venue après le siècle des Lumières et la révolution industrielle en Angleterre ― car l’histoire est différente, la structure sociale est différente, le poids du religieux n’est pas le même. En outre, nos pays sont objet de convoitise car regorgent de richesses nécessaires au fonctionnement de l’économie occidentale. Et pour finir, j’ajoute que le monde arabo-musulman comprend plusieurs pays qui diffèrent les uns des autres. La structure sociale du Liban diffère de celle du Maroc ou de l’Algérie.
Comment se fait-il que l’appel à la démocratie se soit transformé en chaos et guerres confessionnelles. Dès le début du Printemps arabe, on a assisté au cataclysme de l’émergence des forces les plus obscures, y compris en Tunisie. La Révolution française n’a pas vu naître Daesh, Nosra et les innombrables factions islamistes. Ce sont ces assises pulsionnelles de la religion qui méritent un travail de pensée.
A.H : Vous êtes psychanalyste. Comment peut-on l’être, alors que, dans certaines contrées du Monde arabe, même la psychiatrie est mal perçue ? Sérieusement, quel rôle la psychanalyse peut-elle jouer pour sauver le peu qu’il reste de la civilisation arabo-musulmane ?
Houria Abdelouahed : La psychanalyse est une science humaine a-religieuse. Elle s’attelle à comprendre les profondeurs effrayantes et à nous éclairer sur les contrées sauvages, primitives et archaïques de la psyché.
La psychanalyse peine à faire son entrée dans les pays arabo-musulmans. Car le poids du religieux et de la tradition est très important. Le psychanalyste se heurte à la dimension politique et religieuse collective qui court-circuite le travail analytique sur la réalité psychique de chacun.
A.H : Le monde, déjà ténébreux, s’est sauvagement obscurci depuis le 7 octobre 2023. Le monde dit « civilisé » a l’air de sombrer dans la barbarie et l’injustice car ceux-là qui soutiennent l’Ukraine contre Vladimir Poutine soutiennent Benjamin Netanyahou contre la Palestine et le Liban. Comment la psychanalyste et la femme de lettres, et avant tout la femme, aborde-t-elle cette actualité brûlante ? De quels outils disposons-nous pour y faire face ?
Houria Abdelouahed : « Les temps sont sombres », disait Freud dans les années 30. Un échange de lettres entre Einstein et Freud montre que la dualité pulsionnelle (Éros et Thanatos) est aussi vieille que le monde. Aujourd’hui, les belligérants possèdent des armes plus sophistiquées, plus destructrices qui pourraient précipiter l’humanité vers le néant. Ceci étant, on ne peut supprimer la pulsion, seulement l’éduquer ou la sublimer.
L’Occident a toujours adopté la géométrie variable.
Je ne suis ni politicienne ni politologue. Mais je constate en effet que la mobilisation contre l’extermination des innocents à Gaza et les attaques de la Cisjordanie où le Hamas est inexistant ne mobilisent pas l’opinion internationale comme il le fallait. Nous avons les images sur les destructions, l’acharnement de l’armée de Netanyahu contre les civiles, des jeunes enfants squelettiques… la cruauté qui s’abat sur Gaza est inimaginable, comme l’est la réaction des pays voisins : les pays du Golfe, la Jordanie et l’Égypte.
A.H : Dionys Mascolo, qui était si proche de Marguerite Duras, de Robert Antelme et d’Edgar Morin, écrit : « Sont également de gauche en effet ― peuvent être dits et sont dits également de gauche des hommes qui n’ont rien en commun : aucun goût, sentiment, idée, exigence, refus, attirance ou répulsion, habitude ou parti pris… Ils ont cependant en commun d’être de gauche, sans doute possible, et sans avoir rien en commun. On se plaint quelquefois que la gauche soit “déchirée”. Il est dans la nature de la gauche d’être déchirée. Cela n’est nullement vrai de la droite, malgré ce qu’une logique trop naïve donnerait à penser. C’est que la droite est faite d’acceptation, et que l’acceptation est toujours l’acceptation de ce qui est, l’état des choses, tandis que la gauche est faite de refus, et que tout refus, par définition, manque de cette assise irremplaçable et merveilleuse (qui peut même apparaître proprement miraculeuse aux yeux d’un certain type d’homme, le penseur, pour peu qu’il soit favorisé de la fatigue): l’évidence et la fermeté de ce qui est. »
En partant de cette thèse, seriez-vous une femme de gauche ? Si oui, en quoi cela consiste-t-il exactement ?
Houria Abdelouahed : Compte tenu de la confusion généralisée et de ce que la gauche est devenue, je préfère dire que je suis une héritière des Lumières touchée par les logiques de l’exclusion, le fascisme qui gagne du terrain, le recul des valeurs universalistes et les ravages du système néo-libéral.
A.H : Si vous deviez tout recommencer, quels choix feriez-vous ? Si vous deviez incarner ou vous réincarner en un mot, en un arbre, en un animal, lequel seriez-vous à chaque fois ? Enfin, si un seul de vos textes ou livres devait être traduit en d’autres langues, en arabe par exemple, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?
Houria Abdelouahed : S’il était possible à un humain de réaliser ce que seul le rêve permet, j’aurais aimé être la compagne de celui qui dit : « La féminité circule dans le monde » ; « l’humanité n’est pas la virilité » et « Vain tout lieu qui n’accepte pas le féminin ». Être la compagne d’Ibn Arabi avec mon esprit d’aujourd’hui.
Les femmes du prophète (publié par René de Ceccatty dont je suis la débitrice) m’est très cher. Un cri de femme qui dit : « Je suis comme toutes ces femmes : j’ai un lourd héritage et une soif de liberté. »