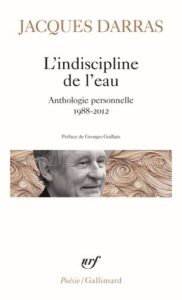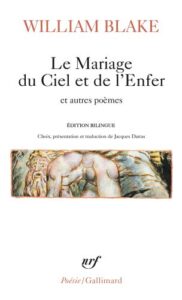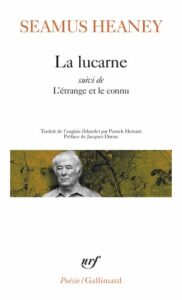Entretien avec Jacques Darras : « Je me sens totalement original »
Les jeudis littéraires d’Aymen Hacen
Poète, essayiste et traducteur, Jacques Darras est né le 11 décembre 1939 en Picardie maritime, à Bernay-en-Ponthieu, près de la Manche, dans une famille d’instituteurs. Khâgneux au Lycée Henri IV à Paris, élève de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, agrégé d’anglais, assistant à l’Université de Picardie où il occupera le poste de doyen de 1984 à 1999, il y fera toute sa carrière jusqu’en 2005.
Depuis la parution de Sommières, publié chez Pierre Oswald en 1973, Jacques Darras ne cesse d’écrire et de publier des chants au long souffle, aux accents aquatiques, fluviaux et marins, avec un cycle poétique dédié à La Maye (de 1988 à 2012), et ce en passant par des œuvres comme Moi j’aime la Belgique (Gallimard, « L’Arbalète », 2001), et jusqu’à Je m’approche de la fin, paru en janvier 2025 dans la collection « Blanche » chez Gallimard. (Cf. Souffle inédit)
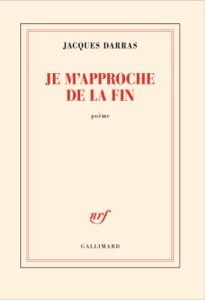
Remerciement
Cher jacques, vous avez lu l’article que j’ai consacré à votre dernier-né dans Souffle inédit, et telle a été votre réponse : « Plaisir de vous retrouver, cher Aymen, après toutes ces années, avec une très belle lecture de mon dernier livre Je m’approche de la fin. Très belle, c’est à dire très juste et très attentive. Je vous en remercie très sincèrement. Je l’imprime et je la garde. »
Rencontre
Je voudrais maintenant en savoir plus sur les motivations de cet hymne qui pourrait s’apparenter à un chant du cygne. Est-ce bien le cas ? Songez-vous à la fin comme à la mort ?
Jacques Darras : Oui, cher Aymen, je songe à la fin en tant que mort. Ma fin, ma mort. Je défie quiconque de ne pas y avoir songé au moins une fois. L’une des faces d’une telle réflexion est celle de la durée de l’existence rapportée à son interruption. Je désirerais tout à la fois durer mais sais aussi que cela n’est pas possible, voire pas souhaitable. Quel paradoxe, quelle contradiction ! Il est par ailleurs sûr que, outre mon âge, qui s’accroît sans que je puisse rien faire d’autre que veiller à ma condition mentale et physique ― heureusement le poème me tient comme une passion indémodable ! ―, j’ai subi des accidents qui m’ont alerté directement sur ma propre mortalité. En 2010, puis en 2018 et plus récemment en 2023, j’ai connu plusieurs alertes cardiaques, dont celle que je narre dans mon poème, que la médecine moderne a su transformer en survie. Le pacemaker que je transporte, comme bien d’autres personnes, j’imagine, est de qualité exceptionnelle. Te voici un cyborg, se moquent mes proches. Un homme augmenté. Je te rassure, le transhumanisme n’est pas ma philosophie, quoique je croie l’avenir de l’humanité littéralement insondable. En lien, en particulier, avec l’exploration de l’Espace. Lequel suscite d’ailleurs, au-delà des conflits actuels, mon intense curiosité. Je me vois autrement dit en perpétuel explorateur, suivant en cela le conseil de T.S Eliot « Old men ought to be explorers ».
A.H : Cinq exergues ouvrent Je m’approche de la fin. Si nous comprenons votre attachement aux poètes anglophones, Shakespeare, Eliot et Thomas, nous aimerions savoir ce qui vous retient chez Marina Tsvetaïeva et Abdellatif Laâbi.
Jacques Darras : Marina Tsvetaïeva, je l’ai lue avec voracité, il y a plusieurs années et ne suis pas loin de la considérer comme le plus grand poète de la littérature russe. Le poème de la fin, en particulier et le Poème de l’air m’ont retenu d’emblée. Concernant ce dernier j’ai eu la chance de connaître et de travailler avec la grande spécialiste et traductrice Véronique Lossky, enseignante à la Sorbonne Paris IV. Véronique a commencé par m’avouer qu’elle ne comprenait pas réellement la signification du Poème de l’air. Nous l’avons lu ensemble, avons fait un commentaire vers à vers, mot à mot. Je lui ai demandé ensuite d’enregistrer elle-même sa propre lecture du poème. J’ai écouté, j’ai essayé, j’ai tâtonné, j’ai supputé et finalement je crois avoir compris le sens. J’ai traduit Marina à l’oreille, créant une version assez originale pour la voir finalement figurer dans le petit Poésie/Gallimard, à elle consacré par Zéno Bianu. Fierté, assurément ! Fierté et modestie d’avoir contribué à ma façon à cet éloge métaphysique de l’aviation porté par une Parisienne ― Marina vit alors à Paris ― comme on porterait un bouquet de fleurs vers un héros venant d’accomplir un exploit, en l’occurrence Lindbergh arrivant au Bourget après sa traversée de l’Atlantique. Métaphysique, disais-je, le poème de Marina monte vers une rareté d’air, presque une asphyxie, comme par pressentiment de sa propre fin par pendaison. Poète tragique, elle, prise dans le tourbillon de la guerre entre Blancs et Rouges, au lendemain de la Révolution d’Octobre.
Abdellatif, j’ai croisé son chemin à plusieurs reprises, admirant son énorme courage de poète emprisonné, donc de lutteur pour la liberté, donc de poète tout court. D’Abdellatif j’aime en particulier l’humour, sa façon de ramener toute forme d’envol excessif (Marina ?) sur terre, son lyrisme cassé en quelque sorte. Mon respect pour ses épreuves m’empêche par ailleurs de totalement l’approcher. J’ai choisi ici son vers par ironie envers ma propre démarche.
A.H : Grand traducteur de l’anglais vers le français ― Walt Whitman, Coleridge, William Blake, Ted Hughes ―, sans oublier les préfaces que vous avez données aux Nouvelles complètes de Conrad, auteur auquel vous avez consacré votre thèse, et bien sûr à La Lucarne de Seamus Heaney et à Sugar d’Éric Sarner, vous êtes, pour ainsi dire, une référence dans le domaine anglo-saxon en France. Comment travaillez-vous, comment vivez-vous ce bilinguisme et avez-vous été, comme certains, tenté de changer de langue ?
Jacques Darras : J’ai d’abord suivi un parcours classique, licence de latin, licence de grec et me dirigeais vers une carrière d’humaniste à l’ancienne quand m’a rattrapé la langue anglaise, pratiquée par ma jeune épouse, plus en phase avec mon goût du dynamisme et de la modernité. Sans compter que l’ENS Ulm me pressait de me décider sur la voie que j’allais suivre, ayant « gâché » deux autres années vaines sous la direction du philosophe Althusser dont je repoussais d’instinct le « Marxisme scientifique » à la différence de mes condisciples Rancière, Milner et Balibar. Disons que j’étais plus fait pour la poésie, non conceptuelle par définition. Donc l’anglais a été, comme je dis moqueusement, ma « légion étrangère ». J’avais d’emblée du retard, n’ayant qu’une connaissance moyenne à modérée de mon nouveau sujet. Retard que je rattrapai en trois ans de travail acharné, plus qu’acharné même. J’ai appris l’anglais par la poésie et grâce à la poésie, devenant du même coup un spécialiste dans ce domaine assez peu exploré jusqu’alors. Mon premier « exploit » fut la traduction du poète du Yorkshire Basil Bunting que Michel Deguy publia dans le n°7 de sa revue Po&sie dans le même temps que Grasset publiait ma nouvelle traduction d’Under the Volcano du romancier britannique Malcolm Lowry. Je continuai sur ma lancée tout en me méfiant de l’étiquette « traducteur » qu’on s’apprêtait à me coller sur le dos, réservant ma poésie de longue haleine (épique ?) aux années 1988. J’avais alors 48 ans et accomplis près de deux carrières avant de me lancer dans la troisième, ma propre poésie. Avouons que le sommet de ma relation avec l’anglais fut atteint lors des conférences prononcées sur la BBC en 1989, pour fêter le bicentenaire de la Révolution française. Je fus le premier Français et Européen à recevoir cet honneur. Mon anglais ne fut jamais aussi bon qu’à cette époque-là, assurément. Depuis j’ai fait passer une langue devant l’autre, le français devant l’anglais, reléguant cette dernière loin en arrière, la tenant pour ainsi dire au chaud pour le cas où elle pourrait ou devrait à nouveau servir. Je suis progressivement parvenu, je crois, à m’établir comme poète français reconnu, avec le temps et avec la patience qui caractérise mes compatriotes picards. Pour dire vrai, je me sens totalement original, Français certes mais avant tout Européen. J’ai acquis les lettres de noblesse qu’il fallait pour cela. Sans vanité aucune, je précise. De la fierté, simplement.
A.H : Dionys Mascolo, qui était si proche de Marguerite Duras, de Robert Antelme et d’Edgar Morin, écrit : « Sont également de gauche en effet ― peuvent être dits et sont dits également de gauche des hommes qui n’ont rien en commun : aucun goût, sentiment, idée, exigence, refus, attirance ou répulsion, habitude ou parti pris… Ils ont cependant en commun d’être de gauche, sans doute possible, et sans avoir rien en commun. On se plaint quelquefois que la gauche soit “déchirée”. Il est dans la nature de la gauche d’être déchirée. Cela n’est nullement vrai de la droite, malgré ce qu’une logique trop naïve donnerait à penser. C’est que la droite est faite d’acceptation, et que l’acceptation est toujours l’acceptation de ce qui est, l’état des choses, tandis que la gauche est faite de refus, et que tout refus, par définition, manque de cette assise irremplaçable et merveilleuse (qui peut même apparaître proprement miraculeuse aux yeux d’un certain type d’homme, le penseur, pour peu qu’il soit favorisé de la fatigue): l’évidence et la fermeté de ce qui est. »
En partant de cette thèse, seriez-vous un homme résolument de gauche ? Si oui, en quoi cela consiste-t-il exactement ?
Jacques Darras : Je me suis fait politiquement, comme littérairement, « contre ». Contre la gauche marxiste communiste dont étaient plus moins imprégnés mes parents instituteurs. Plus tard contre le gauchisme maoïste des années 70 dont se firent les hérauts mes camardes de l’ENS. Dans les deux cas, je crois, a joué ma modération paysanne instinctive. Je ne fus jamais de droite pour autant, si l’on veut bien considérer que le gaullisme ne fut pas de droite. De Gaulle conduisit la résistance contre le Nazisme et mit fin à la Guerre d’Algérie. Cela m’allait très bien, cela me suffisait amplement. Je détestai la guerre froide, dans mon enfance, et détestai la guerre d’Algérie où mes jeunes amis paysans allaient se faire absurdement tuer dans le djebel. Moi l’étudiant j’eus la chance de bénéficier d’un sursis. Donc de traverser cette époque sans dommage personnel. Après De Gaulle je ne me reconnus plus dans aucun parti. La situation politique française actuelle me chagrine. Ma position serait plutôt celle d’un social-démocrate mais je suis avant tout et surtout un Européen d’âme et de cœur. J’ai modestement apporté ma pierre à l’Europe en tant que poète. J’aimerais voir plus d’enthousiasme constructeur de l’Europe chez les hommes politiques.
A.H : Le monde, déjà ténébreux, s’est sauvagement obscurci depuis le 7 octobre 2023. Le monde dit « civilisé » a l’air de sombrer dans la barbarie et l’injustice car ceux-là qui soutiennent l’Ukraine contre Vladimir Poutine soutiennent Benjamin Netanyahou contre la Palestine et le Liban. Outre le deux poids deux mesures, il y a un véritable problème politique et éthique. Comment le poète-traducteur et avant lui l’homme aborde-t-il cette actualité brûlante ? De quels outils disposons-nous pour y faire face ?
Jacques Darras : La guerre en Ukraine est monstrueuse. Ne l’est pas moins la guerre au Moyen-Orient. En Ukraine le monstre est Poutine. Clairement, sans ambiguïté. Je n’arrive pas imaginer qu’un homme, lui seul, puisse décider de la mort de 600 000 soldats par simple désir de puissance, par volonté d’annexer une terre. Je trouve d’ailleurs que la manière dont les esprits, les journalistes en particulier, réhabilitent le mot « empire » est non seulement une paresse intellectuelle mais induit une dangereuse accoutumance. Pas d’empire qui tienne, nous avons devant nous l’entrée de la « mafia » en politique.
Pour Gaza, la monstruosité est d’abord celle du Hamas, à ne surtout pas oublier ni minimiser. Crime monstrueux contre des Israéliens innocents, souvent pacifistes d’ailleurs. Crime monstrueux contre le peuple gazaoui par appel automatique à la vengeance israélienne, elle-même monstrueuse par son ampleur. Nous avons affaire à des monstres, au retour des monstres. Moi, l’enfant de 1939, ne puis qu’observer cette scène avec l’effroi innocent du gamin de 5 ans que j’étais lors de la Seconde Guerre Mondiale. Quand les hommes cesseront-ils d’être des monstres ? La politique peut-elle à elle seule calmer les émotions négatives ? Il faut le croire, faute de quoi s’enchaîneront les monstruosités. Appel aux hommes modérés ! Sauf à prolonger un interminable conflit biblique jusque dans la nuit des temps, un partage des terres semble seul envisageable. Aura-t-il jamais lieu ? Moi, homme du Nord au sang-froid, regarde de loin ces passions belliqueuses méditerranéennes. Oui, Aymen, le déchirement est un principe en politique mais moi, homme de gauche modérée, scandinave de cœur, suis partisan du consensus. Vous ne pouvez pas nier, par exemple, le déchirement entre chiites et sunnites. Vous ne pouvez pas nier le déchirement entre religion et laïcité. Le Christianisme a mis vingt siècles de combat jusqu’à la Loi de 1905. Resterait-il encore sept siècles avant que la Loi de l’État l’emporte sur la charia ? Moi le fils d’instituteurs, élevé à la Laïcité, je me déclare laïc et religieux, tout à la fois. Tout à la foi.
A.H : Si vous deviez tout recommencer, quels choix feriez-vous ? Si vous deviez vous incarner ou vous réincarner en un mot, en un arbre, en un animal, lequel seriez-vous à chaque fois ? Enfin, si un seul de vos textes devait être traduit dans d’autres langues, en arabe par exemple, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?
Jacques Darras : Désolé, Aymen, je me réincarnerais en Jacques Darras. Pas en Picardie, pas en France. Au Yémen, par exemple ou en Ouzbékistan. Qu’est-ce que ça donnerait avec mon tempérament de poète fougueux ? Je courrais un grand risque, assurément. Pour ce qui est de la traduction en arabe, mes 5 lettres à Hélène (Cf. l’Indiscipline de l’eau, Poésie/Gallimard 2016) ont été traduites par l’enseignante de théâtre damascène, rencontrée à Damas en 2006, la délicieuse Hanan Kassab-Hassan. Il est évident que les autres poèmes de L’indiscipline de l’eau restent ouverts à la traduction.