Dans ce poème vibrant, Éric Sarner rend hommage à Anton Tchekhov, mort en 1904 à Badenweiler, en Forêt-Noire. L’écrivain et poète français revisite ce dernier instant où le grand dramaturge russe, sans connaître un mot d’allemand, prononce « Ich sterbe » — « Je meurs ». Un texte méditatif sur la langue, la mort, et la beauté fugitive de la vie.
Ich sterbe : Éric Sarner écrit la mort d’Anton Tchekhov
À Anton Tchekhov
Poème d’Éric Sarner
C’est un homme qui meurt en allemand,
Ich sterbe,
des mots allemands.
C’est Anton Tchekhov, le poète russe, immense,
qui meurt en allemand, le 15 juillet 1904,
à Badenweiler, en Forêt-Noire,
l’été 1904,
hier, tout à l’heure, ou bien là,
Me muero
I’m dying
Ou rien,
Mourant muet,
pour ne pas déranger ou peut-être par distraction,
et qui pense dans la langue des yeux
ou celle qui se dit à l’oreille.
Tchekhov ne sait pas l’allemand,
Pourquoi meurt-il en allemand ?
Dans quelle langue meurt-on ?
Quand on s’en va, c’est sûr,
s’endormir
Et que l’on se rappelle
combien la journée fut belle,
si doucement belle,
divinement belle,
bien belle,
joyeuse
et gaie
et tout…
Le docteur Tchekhov,
Ce n’est guère plus qu’un n’importe qui,
Un immense n’importe qui.
Je pars crever là-bas ! a dit le docteur.
En Forêt-Noire.
À deux, trois heures la nuit,
il y a toujours quelqu’un pour perdre la terre.
Y a-t-il des bruissements d’abeilles ?
Certainement, il va faire jour, tout à l’heure.
Roseau brisé dans l’indifférence des forêts…
Non, pas de singeries, fla-fla.
Mes mains moites.
Est-ce une chance de ne rien comprendre ?
Les battements du cœur.
Olga, ne mets pas de glace sur un cœur vide.
Vingt ans de sang craché, vomi.
Quarante-quatre ans en tout… Mais la vie ne se compte pas…
Pas plus que la surface d’un domaine, cher Lopakhine,
vile machine à calculer… Il en faut, sans doute qu’il en faut.
Prison. Mère inépuisable.
Ça sent l’eau de Cologne…
Et les cerises marinées. Un peu.
On se gave de raisins secs.
On mange, on boit, que fait-on d’autre ?
On attend. Caillou coupant.
Et le sucre a encore augmenté. Manque d’amour. Quelle honte !
Des coups de poing dans le dos. Sale histoire ! Sale histoire !
Quelle honte ! Quelle farce !
Des coups de hache ?
Des flots de lumière.
Il faudrait aller très haut. Tout au fond de très haut.
Mais ça n’existe pas.
Olga, Chaliapine à côté avec des harengs.
Ne te fâche pas.
Trop de mots.
Plus fort la musique ?
Non. Non !
Cerveau de Kant, cerveau de mouche.
Le charme de la couleur blanche.
C’est l’été ?
C’est hiver, automne, printemps, tout.
Trop de mots.
Il avale lentement une coupe de champagne
que lui tend le Dr. Schwörer.
Il se redresse sur le lit, s’assied.
Ich sterbe —
il a articulé bien proprement cela :
Ich sterbe.
De sterben, un verbe actif qui discute au minimum,
Ich sterbe.
Et puis, Tchekhov a toujours aimé mettre les gens à l’aise.
Il sait ce qu’il en est de nous, de mourir…
Mais non, bien sûr, il n’en sait rien en réalité.
Dire je meurs dans une langue inconnue,
est-ce dire : non, je ne meurs pas ?
Ou bien c’est un jeu :
la mort est un désastre,
mais mourir une chose intéressante, peut-être.
Voilà,
Il se laisse glisser sur le côté gauche.
Il fait toujours nuit.
Il glisse.
Il fait nuit.
Il fait rien.
Tout reste.
Éric Sarner
Poète, écrivain et journaliste, Éric Sarner est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages et de nombreux poèmes publiés en revues.
Parmi ses derniers recueils : Simples merveilles (Tarabuste, 2020), Solitude des mots (Tarabuste, 2018), Cœur chronique (Castor Astral, 2013, Prix Max Jacob 2014).
Documentariste, il a réalisé une vingtaine de films culturels et poétiques, dont Sénac, Jean, Algérien, poète (2010) et Le Ravissement de Palmyre (2015).
En 2021, trois de ses recueils ont été réunis dans la prestigieuse collection Poésie/Gallimard sous le titre Sugar et autres poèmes.












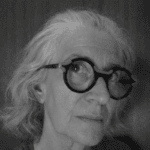




Merci pour cet écrit, que j’ai beaucoup apprécié !
Oui les langues nous habitent, même si beaucoup nous échappent, certaines nous apportent des mots nous marquent plus que d’autres, mystérieusement.
Parfois même, ces mots ne sont pas clairement traduisibles à travers nos frontières … (En ex.: « Heimweh » en D., « φιλότιμο » en Gr.)