Entretien avec René de Ceccatty
Les jeudis littéraires d’Aymen Hacen
Centenaire de Pier Paolo Pasolini
5 mars 1922-5 mars 2022
« Les poètes n’étaient à éliminer que dans les dictatures »
Entretien avec René de Ceccatty
Né à Tunis en 1952, René de Ceccatty est l’auteur de nombreux romans parmi lesquels L’Or et la Poussière (1986), Babel des Mers (1987), L’Accompagnement (1994), Aimer (1996), L’Éloignement (2000), L’Hôte invisible (2007), Enfance, dernier chapitre (2017), parus aux éditions Gallimard ; Fiction douce (2002) et Une fin (2004) aux éditions du Seuil; Objet d’amour (2015) chez Flammarion et Le Soldat indien aux éditions du Canoë (2022). Traducteur du japonais et de l’italien, il a consacré plusieurs essais à la littérature italienne (Sibilla Aleramo, Pétrarque, Alberto Moravia, Elsa Morante). Il a également publié un recueil d’entretiens avec Adriana Asti, Se souvenir et oublier (Portaparole, 2011) et de nombreux essais dont Un renoncement (Flammarion, 2013) et Mes Argentins de Paris (Séguier, 2014). Enfin, il est l’auteur de pièces de théâtre et de livrets de comédies musicales. Dans la collection « Folio Biographies », il a publié Maria Callas en 2009. C’est le principal traducteur français de Pasolini auquel il a par ailleurs consacré l’essai Avec Pier Paolo Pasolini (Rocher, 2022). René de Ceccatty est éditeur aux éditions du Seuil.
Rencontre…
Aymen Hacen : Commençons par Pasolini dont nous célébrons le centenaire de la naissance le 5 mars 2022. À cette occasion sont réédités la biographie que vous lui avez consacrée chez Gallimard, ainsi que Descriptions de descriptions (éd. Manifeste !), traduits et préfacés par vous, dans une version augmentée et Pasolini par Pasolini, entretiens avec Jon Halliday, que vous avez traduits et postfacés (Seuil) et le recueil de vos articles et conférences, republié sous le titre Avec Pier Paolo Pasolini (Le Rocher). Mais, n’oublions pas vos précédentes traductions des Sonnets (« Poésie »/Gallimard, 2012), Pétrole (« Du monde entier », Gallimard, 1995), Actes impurs suivi d’Amado mio (Gallimard, 1984), L’Odeur de l’Inde (Denoël, 1984), Adulte ? Jamais (« Points »/ Seuil, 2013) ou encore Le Christ selon Pasolini (Bayard, 2018).

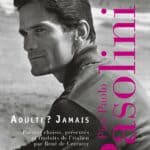
Pourriez-vous nous raconter votre passion pour Pasolini ? Qu’est-ce qui justifie cette flamme qui dure depuis presqu’un demi-siècle ?
René de Ceccatty : Sans doute, le jeune âge auquel j’ai découvert Pasolini et j’ai voulu correspondre avec lui (dix-sept ans) explique-t-il en partie la ténacité de cette passion littéraire à travers toute ma vie. Mon activité de traducteur, d’éditeur et de critique a bien entendu resserré les liens et leur a donné une forme durable et profonde. J’ai souvent raconté ma stupeur en voyant le film Théorème en 1969 et en lisant le roman de même titre, car j’y retrouvais des thèmes et même une forme poétique qui rejoignaient un livre que j’écrivais alors et dont j’ai envoyé à Pasolini le manuscrit. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais, comme il m’a répondu en me donnant son adresse, dans la banlieue résidentielle de Rome, j’ai tenté, alors que j’étais étudiant à Pérouse, de lui rendre visite, en frappant à sa porte. Il était absent, alors en repérage pour un film. Il m’a téléphoné plus tard, mais j’étais moi-même reparti d’Italie.Toutefois, en dehors de ces détails biographiques, sur lesquels j’ai souvent écrit, ce qui compte est la force de la personnalité de cet artiste prométhéen qui pour moi est la résurgence d’un type de créateur qui existait à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance (disons Dante, Michel-Ange, Léonard de Vinci). Pasolini est l’incarnation même du poète total qui a absorbé l’immensité de la tradition artistique et spirituelle italienne et a donné à ses propres novations une forme révolutionnaire, tant dans ses poèmes, que dans ses textes narratifs, ses essais critiques et théoriques et son cinéma. C’est un artiste des mots et des images, dont l’esthétique et les visions politiques s’entremêlent. Croiser un tel personnage n’est pas anodin. Le fait que j’aie voulu le rencontrer et ne l’aie pas rencontré « en chair et en os », mais seulement à travers des lettres échangées et son œuvre a intensifié mon dialogue avec elle, avec lui. Le traduire, à une période où le nom de Pasolini n’était plus doté ou pas encore doté d’une totale luminosité ni d’une évidente nécessité, n’a pas été facile. Les éditeurs étaient réticents. Mais c’est une grande joie de voir que son prestige n’a cessé de grandir et que rares sont ceux qui contestent son génie, son courage, sa nature de grand artiste polymorphe qui a anticipé sur son temps.
Aymen Hacen : « Une ordalie », texte écrit en novembre 2021, revient sur l’assassinat de Pasolini. Qu’en est-il pour vous, d’autant plus que, en 2017, a paru Pédé, c’est tout. Pétrole ou les dessous cachés du meurtre de Pasolini, de Carla Benedetti et Giovanni Giovannetti (éditions Mimésis, 2017), qui plaide en faveur d’un réel complot dans le but d’assassiner le poète-cinéaste. Qu’en pensez-vous ?
René de Ceccatty : Dans ce chapitre additionnel qui résume de nombreuses interventions que j’ai faites depuis une vingtaine d’années sur ce sujet, sans être en mesure de fournir moi-même aucune preuve, je dis clairement ma conviction que les indices (depuis la toute première enquête d’Oriana Fallaci, dans l’Europeo, parue une quinzaine de jours après l’assassinat, jusqu’aux recherches récentes et systématiques faites par des documentaristes, des avocats, des magistrats) suffisent à écarter définitivement la thèse d’un simple crime sexuel ou crapuleux, et l’idée tout d’abord avancée que Pasolini a été assassiné par une adolescent prostitué occasionnel, à la suite d’une rencontre vénale d’un soir qui aurait mal tourné. Pino Pelosi s’est tout d’abord accusé comme unique meurtrier, puis s’est rétracté (une fois libéré) en donnant une tout autre version, qui était, à vrai dire, celle qu’avaient soutenue d’emblée les partisans d’un complot politique : à savoir qu’il avait été commandité pour attirer Pasolini (qu’il connaissait depuis quelques mois) dans un piège (sous prétexte de lui restituer des bobines volées de Salò, film qui était cependant terminé mais dont certaines scènes filmées avaient été en effet volées). Et des complices sont intervenus qui ont transformé ce qui ne devait être qu’une intimidation en massacre. La complexité de la situation vient du fait que les sicaires et les commanditaires étaient probablement séparés par plusieurs intermédiaires qui ne se connaissaient pas entre eux et ne connaissaient pas les autres intervenants de ce qu’il faut bien appeler un complot, et que les raisons de cet assassinat étaient multiples, liées à des articles de Pasolini et probablement à son roman Pétrole. Au centre des mobiles, se trouvaient assurément les recherches que Pasolini avait faites sur trois sujets extraordinairement sensibles politiquement : le meurtre d’Enrico Mattei, le patron de la société nationale d’hydrocarbures, en 1962, l’attentat du 12 décembre 1969 (de la Piazza Fontana) et la tentative du coup d’État Borghese, en 1970. Tous les livres portant depuis une dizaine d’années sur cet assassinat développent ces points, de manière plus ou moins explicite ou convaincante. J’ai longtemps résisté à cette thèse (faute d’éléments probants) parce que je pensais que les poètes n’étaient à éliminer que dans les dictatures. Or l’Italie n’était pas une dictature en 1975. Mais, comme l’a prouvé le livre de Rosetta Loy, L’Italie entre chien et loup, les années de plomb (1970-1980) ont été d’une confusion catastrophique, où il était très difficile de démêler le terrorisme d’État du terrorisme de groupuscules d’extrême gauche et d’extrême droite. Et donc le climat était propice à l’élimination d’intellectuels trop curieux, qui dénonçaient les manipulations d’informations, de la part du pouvoir exécutif ou policier. De nombreux magistrats courageux et même quelques commissaires avaient été ainsi éliminés. Moravia lui-même avait dû fuir Rome et se réfugier à Venise, car les menaces devenaient trop précises et il sentait sa vie en danger. Et Moravia était infiniment moins engagé dans ses articles que ne l’était Pasolini. Et surtout moins haï par toute une branche politique.
Aymen Hacen : Quel avenir pour l’œuvre de Pasolini ? Cent ans après sa naissance et 47 ans après sa mort, trouvez-vous qu’il a la reconnaissance ou la fortune qu’il mérite ?
René de Ceccatty : Sa gloire et l’intérêt qu’il suscite chez les universitaires, les étudiants, les cinéphiles, les lecteurs de poésie n’ont cessé de croître en Italie et dans le reste du monde. Et sans aucun doute, en particulier en France. Longtemps le cinéaste a occulté le poète. Puis le polémiste a occulté le cinéaste et le poète, mais on a lu constamment Les Lettres luthériennes et surtout Les écrits corsaires. Maintenant c’est le poète qui apparaît pleinement et donne un sens à l’ensemble de son œuvre. Mais ce qui reste à évaluer pleinement, selon moi, c’est son roman Pétrole, qui est un chef-d’œuvre (sur tous les plans, narratif, poétique, analytique, documentaire) comme l’histoire littéraire italienne en a peu produit. Pétrole est une somme que je compare souvent à Un captif amoureux de Jean Genet, et à la Tentation de Saint-Antoine de Flaubert. Et, bien entendu, à la Divine Comédie qui est une référence assumée. La mort mystérieuse et sacrificielle de Pasolini (comparée à celle de Jean Sénac ou à celle de Caravage et de Winckelmann) a jeté une ombre particulière sur la totalité de la vie et sur l’ensemble de l’œuvre. C’est un danger pour la sérénité des analyses, mais une chance pour le mythe, peut-on dire, si bien que Pasolini devient une sorte d’icône poétique, comme Arthur Rimbaud ou Emily Dickinson. Son homosexualité qui a souvent été l’occasion d’insultes, de persécution et de mépris de son vivant devient au contraire, avec l’évolution des mœurs, en Italie, mais surtout dans le reste du monde, et les combats de toutes les nouvelles générations pour la liberté d’orientation sexuelle, une marque de courage et un élément en sa faveur, si bien que Pasolini, en avance sur son temps, apparaît pour beaucoup de jeunes lecteurs comme un interlocuteur essentiel.
Connaitre René de Ceccatty
Aymen Hacen : Auteur, traducteur et éditeur, comment travaillez-vous ? Vous arrive-t-il que ces trois activités empiètent les unes sur les autres ?
René de Ceccatty : Ces trois activités sont pour moi intrinsèquement liées. J’y mets la même passion, et même si parfois mon amour-propre d’auteur souffre un peu de ce que la partie la plus « personnelle » de mon travail soit éclipsée par mes traductions et mon activité critique ou éditoriale, je n’attache pas moins d’importance à mes traductions de l’italien et du japonais qu’à mes propres livres, et je suis très fier d’avoir sorti de l’ombre certains grands écrivains dont j’ai été ou le traducteur ou l’éditeur. Selon l’urgence du moment, l’une de ces parts de mon travail prend le pas sur les autres, mais je n’en ressens pas de frustration. C’est une question d’organisation, c’est-à-dire, en réalité de désorganisation. Il faut être souple et disponible, ne jamais se rendre prisonnier d’un emploi du temps. Il ne faut pas que la discipline et la régularité (toutefois nécessaires) soient un carcan ou une grille trop rigide. Je lis rapidement les manuscrits qui me sont soumis, je ne porte pas nécessairement de jugement littéraire, car je sais que l’édition et la critique ne sont pas une science, mais sont profondément subjectives et dépendantes des limites de celui qui les exerce, je n’hésite pas beaucoup pour savoir si je peux avoir un rôle dans leur publication et si je pense que ce sont des textes qui m’apparaissent comme nécessaires et pouvant être partagés par d’autres lecteurs. Mais souvent, je n’ai pas les mains totalement libres et l’on n’écoute pas toujours mon opinion. Je suis assez souvent en conflit avec les autres lecteurs et la hiérarchie éditoriale. Je tiens à ne pas perdre de temps avec ceux qui ne peuvent pas me comprendre, que ce soient des auteurs ou d’autres éditeurs. Mais je sais, dans certains cas, insister pour aider les auteurs auxquels je crois et pour lesquels je pense pouvoir être un intermédiaire efficace. Récemment, j’ai traduit la déportée juive hongroise italophone Edith Bruck. J’ai cru immédiatement en ce grand écrivain, et un succès gigantesque a suivi. Ce sont des moments importants. Non pas que j’en tire une stupide vanité, mais parce que cela donne un sens profond à mon travail. Traduire des poèmes ou de grands stylistes est une immense responsabilité, et exige pas mal d’humilité, quoi qu’on pense. Le travail d’éditeur aussi, car il est voué à être oublié avec le temps. J’ai en horreur les éditeurs qui prétendent que leur intervention est essentielle au résultat d’un livre. C’est une pure imposture. Le seul rôle de l’éditeur est d’être, dans le meilleur des cas, à la bonne place et au bon moment, avec le juste pouvoir, pour servir de tremplin. Et je le dis d’autant plus volontiers que j’ai tenu ce rôle, sans doute déterminant, pour plusieurs auteurs. Et que certains éditeurs ont joué ce rôle pour moi (Hector Bianciotti, Elisabeth Gille, « pour citer les plus importants » Colette Lambrichs, Joaquim Vital et Michel Waldberg). Comme auteur, je n’oublie pas que je suis éditeur. Et c’est la raison pour laquelle mon dernier livre, refusé par mon éditeur habituel (le groupe Gallimard), lassé de mes faibles ventes, je n’ai pas voulu le proposer à la maison pour laquelle je travaille comme éditeur (le Seuil). Car, étant donné mes fonctions éditoriales, j’aurais bénéficié d’un traitement de faveur par rapport à des auteurs que parfois je suis contraint de refuser pour des raisons économiques. Comment leur aurais-je expliqué que je préfère « me publier » plutôt que de les publier ? En cela, on peut dire que mon travail d’éditeur a eu des conséquences (plutôt négatives) sur mon statut d’auteur…
Aymen Hacen : Né en Tunisie quatre ans avant son indépendance, pourriez-vous nous raconter votre histoire de famille ? Qu’avez-vous gardé de votre terre natale et quel rôle joue-t-elle dans votre œuvre littéraire ?
René de Ceccatty : Du côté de mon père, la famille Pavans de Ceccatty est arrivée à Sfax en 1903. Mon arrière-grand-père, Alphonse, était le directeur de la Dépêche sfaxienne. Son fils cadet, mon grand-père Valbert, qui était musicien, l’a rejoint une fois ses études terminées au conservatoire, a renoncé à sa vocation (en refusant le poste d’instrumentiste qu’on lui offrait à Boston aux États-Unis) et s’est installé comme négociant en machines-outils agricoles, puis en laine, puis en toiles et corderies industrielles. Sa mère était poète et romancière, Marguerite de Ceccatty. Elle a publié de nombreux recueils au début du XXe siècle et participait à la vie artistique à Sfax, avant de s’enfuir avec un acrobate de cirque. Mon père était profondément artiste (peintre et pianiste), mais a travaillé avec son père, à la fin de la guerre qu’il a passée, très jeune, dans l’armée française, mais aux États-Unis, dans l’aéronavale. Il a décidé de quitter la Tunisie en janvier 1958, parce que, officier de réserve, il commençait à être mobilisé pour des incidents de frontière avec l’Algérie. Nous l’avons suivi à Montpellier, de l’autre côté de la Méditerranée et dans un climat heureusement aussi clément, mon frère, ma mère et moi, en juillet de cette même année. Du côté de ma mère, c’est un mélange de colons et de Tunisiens. Puisque mon arrière-grand-mère est arrivée en Algérie (au Télagh) en 1884, l’auberge familiale de Valence d’Albi ayant brûlé. Elle a épousé un garde forestier corse qui faisait son service militaire en Algérie et leur fille, ma grand-mère, a épousé un Tunisien, naturalisé français parce que fonctionnaire de mairie (il était receveur municipal à Mateur), Hamida Fréah, et en partie d’origine italienne (par sa mère). Ma mère et ses deux sœurs ont été élevées dans la tradition catholique. Mon grand-père était agnostique, et n’a pas donné de prénom musulman à ses trois filles, qui ont appris l’arabe au lycée, mais ne l’ont jamais maîtrisé dans la vie courante. En revanche, leur mère, ma grand-mère, parlait bien arabe, car, travaillant à l’état-civil, elle devait recevoir des déclarations de naissance et de décès de Tunisiens qui ne parlaient pas, pour certains d’entre eux, français. Je n’ai pas connu mon grand-père Hamida, qui est mort en 1934, quand ma mère avait dix ans. J’ai étudié l’arabe à l’école franco-arabe de Mégrine-Coteaux, où nous vivions. Mais je ne l’ai appris qu’au cours préparatoire et je l’ai oublié, ne l’ayant pas pratiqué et ne l’ayant pas réappris, alors que j’ai appris jeune l’italien, et plus tard l’anglais et le japonais. Mais les six premières années de mon enfance ont eu, comme je le raconte de Enfance, dernier chapitre et dans Le Soldat indien, un rôle absolument déterminant, et pas seulement pour les raisons habituelles de sensations, de couleurs, d’odeurs, de climat, de végétation, de sons, d’aliments, etc. J’ai gardé un souvenir très précis de ces années-là. La première fois que je suis revenu, avec mon frère, et une proche amie, en Tunisie, c’était en juillet-août 1972. J’avais vingt ans. J’ai pu retrouver sans aucun problème l’emplacement des trois maisons familiales à Mégrine et de celle de La Cagna. Et la structure de la ville de Tunis m’était encore connue. La maison de mes parents, celle de ma grand-mère maternelle, celle de mes arrière-grands-parents maternels et celle de mes grands-parents paternels, je n’ai eu aucune difficulté à les localiser. L’emplacement géographique était demeuré assez présent pour que je retrouve le chemin, le plan intérieur des maisons était également gravé dans ma mémoire. Mais sans aucun doute, ces premières années ont aussi déterminé mon rapport à toutes les cultures étrangères qui ont tant d’importance dans ma vie et mon activité. Que la plupart de mes plus proches amis soient d’origine étrangère n’est évidemment pas un hasard : japonais, italien, argentin, polonais, algérien, libanais, chinois, allemand, marocain, brésilien, roumain, canadien, belge, américain et tunisien. Sans compter les Martiniquais… J’ai longtemps vécu avec un ami japonais avec qui j’ai fait de nombreuses traductions, et je vis avec un ami algérien que j’ai épousé. Il a des enfants et une petite-fille qui sont ma famille. Mes parents avaient un regard très critique sur la colonisation française, et je leur suis infiniment reconnaissant de ne nous avoir jamais donné l’esprit « pied-noir ». Ils m’ont enseigné le respect de l’altérité et la conviction que l’humanité est universelle. Je m’intéresse beaucoup à la littérature arabe francophone, algérienne, marocaine, tunisienne, libanaise. Rabah Belamri était un grand ami, je l’ai édité. Et comme vous le savez, je publie Adonis et Houria Abdelouahed. J’ai travaillé au théâtre avec Claudia Cardinale, elle aussi, profondément attachée à son enfance tunisienne. Nous sommes restés amis parce que l’origine tunisienne est pour elle, entre autres, une garantie d’amitié durable et sincère et de complicité. La dernière fois que je suis venu en Tunisie, ainsi que je le raconte dans Le soldat indien, j’ai découvert que le cimetière chrétien de Mégrine, sur la route de Sidi-Rézig, avait été profané : les tombes sont ouvertes, les cercueils eux-mêmes le sont. C’était une vision d’horreur. J’étais en train de réfléchir à la suite à donner à une entreprise autobiographique qui comptait deux premiers titres, Enfance, dernier chapitre et Mes années japonaises. Et plutôt que de raconter la suite de ma vie (que de toute façon j’ai racontée par épisodes dans la série des cinq livres d’Aimer et dans L’Hôte invisible et Raphaël et Raphaël), j’ai voulu comprendre ce qu’était l’oubli des morts. Non pas l’oubli du passé en général, mais celui des individus morts. Un cimetière est un lieu sacré voué à la mémoire, une enceinte qui par là échappe au temps, aux environnements toujours changeants du présent. Ce cimetière avait probablement été profané par des islamistes, je ne pense pas que cela ait été l’œuvre de simples vandales. Il faut plus que du vandalisme pour profaner une tombe. Et j’étais tombé, en écrivant Enfance, dernier chapitre (livre qui évoque la mort de ma mère et mon enfance) sur un ancêtre, Léopold, qui avait vécu au XVIIIe siècle en Inde et dont on ne m’avait jamais parlé. J’ai réuni ces deux idées, de la profanation des tombes et de l’oubli d’un ancêtre. L’oubli de son existence, pourtant peu banale, était une forme de profanation familiale. Ce livre est donc vraiment né en Tunisie, porté par la Tunisie, où je me trouvais pour des raisons professionnelles ennuyeuses (un colloque sur la francophonie avec de pénibles relents de colonialisme). Mais c’était à ma propre disparition que j’assistais. Je m’étais rendu compte que la bibliothèque du lieu institutionnel français où avait lieu le congrès n’avait aucun de mes livres. J’étais du reste parfaitement transparent pour les organisateurs qui étaient de simples apparatchiks du gouvernement français, en déplacement dans d’anciennes colonies. Cette expérience de mon inexistence dans la terre où je suis né et à laquelle je continuais à être attaché m’a épouvanté. Le livre est parti de cette épouvante que je n’aurais probablement jamais éprouvée avec autant d’intensité ailleurs que dans mon pays natal, où mes parents s’étaient connus, aimés et mariés, et avaient vécu leur propre enfance. La bibliothèque de mes parents était pleine de livres d’écrivains tunisiens et algériens francophones. Le professeur de ma mère avait été Jean Amrouche. La culture maghrébine était pour eux essentielle et l’est demeurée pour moi, d’autant plus que je travaille aux éditions du Seuil, où elle a été abondamment publiée. La Tunisie n’appartient donc pas seulement à ma vie personnelle parce que j’y suis né, que j’y ai appris à lire et à écrire, que mon grand-père était tunisien, mais parce que la littérature tunisienne et un certain type de vie quotidienne faisaient partie intégrante de la culture familiale. Mon père a peint les paysages tunisiens et ses tableaux sont chez moi et chez mon frère.
Le traducteur
Aymen Hacen : Vous traduisez notamment de l’italien (Moravia, Pasolini, Bonaviri, Leopardi, Pétrarque, Umberto Saba, Dante) et du japonais (Kenzaburô Ôé, Kôbô Abé, Yukio Mishima, Natsumé Sôseki, Junichirô Tanizaki). Passez-nous le mot, mais comment faites-vous pour vous retrouver entre ces deux langues si différentes l’une de l’autre ?
René de Ceccatty : Mes relations avec la langue italienne et avec la langue japonaise sont certes liées à des hasards, à des circulations géographiques et historiques, mais surtout à une histoire très intime, très personnelle. L’italien, cela n’a rien d’étonnant pour un enfant né en Tunisie, où la présence italienne était très forte. Ma mère travaillait, et m’a confié à une Sicilienne qui habitait dans une maisonnette construite pour elle dans notre jardin, avec son frère qui était handicapé mental. Resté seul avec eux, j’entendais parler italien à moins de cinq ans. C’était une langue affective liée à ce rapport que j’avais avec Ignazina. Lorsque nous avons quitté le pays, elle est restée à Tunis. Et j’ai voulu lui écrire. Pour cela, j’ai appris seul la grammaire et le vocabulaire de base italiens. J’avais douze ans. Puis j’ai découvert Pasolini et là je me suis rendu compte que j’avais acquis seul une certaine maîtrise que je n’ai cessé d’approfondir en lisant des poètes, des écrivains. J’ai eu, en hypokhâgne et en khâgne, deux professeurs de littérature italienne remarquables, Mesdames Weber et Michaud. Et peu à peu c’est devenu ma deuxième langue d’autant plus aimée qu’elle n’avait pas été tout d’abord acquise dans le cadre scolaire. Ce n’est que dans le supérieur que j’ai voulu étudier plus sérieusement la littérature, la grammaire, le lexique. Mais c’était au départ une affaire personnelle. L’acquisition du japonais a d’abord été due au hasard d’une nomination comme coopérant au Japon, quand j’avais fini mes études de philosophie, en tant que volontaire du service national actif (non militaire). Et ma fascination pour cette culture a été immédiate et renforcée par la rencontre d’un de mes étudiants avec qui j’ai vécu une quinzaine d’années, au Japon, en Angleterre et en France, et avec qui j’ai travaillé pendant une trentaine d’années. J’ai vu et compris le Japon à travers lui. Et ce n’est que très récemment, que j’ai osé commencer à traduire seul un livre japonais. J’en suis à mon quatrième. Je n’avais pas cru la chose possible, mais j’avais appris plus de choses que je ne croyais. Évidemment, je traduis beaucoup plus lentement en japonais qu’en italien, et seul qu’avec lui. Mais la langue ne m’est plus étrangère et même si je suis incapable de converser en japonais comme je le fais en italien, la littérature japonaise m’est aussi familière que l’est la littérature italienne. Je dis souvent que ces deux cultures ont en commun une présence très forte du passé patrimonial et esthétique (architectures, jardins, lieux de culte) et un rapport à la vie quotidienne (familiale, alimentaire, esthétique) assez analogue. La centralisation de la langue et de la culture est également artificielle dans les deux civilisations, qui sont en réalité décentralisées et régionalisées (présence forte des dialectes, dans les deux cas). Et je ne suis pas le seul à avoir ce double tropisme. Je connais au moins trois traducteurs qui sont dans la même configuration… En tous les cas, ce que je peux dire, c’est que tous les auteurs que j’ai traduits, du japonais et de l’italien, ont eu pour moi une très grande importance et que les traduire est une expérience d’écriture capitale pour moi. Bien sûr, c’est évident pour Pasolini (par la quantité de livres de lui que j’ai traduits) ou pour Dante (par la difficulté et l’importance de son œuvre), mais je peux citer d’innombrables autres auteurs (Sôseki et Kenzaburô Ôé, bien sûr, ou Moravia, Bonaviri, Leopardi, et tant d’autres), qui ont marqué mon rapport au monde, m’ont influencé aussi dans mes propres textes. Je traduis en ce moment Hayashi Fumiko, après avoir traduit seul un septième livre de Sôseki. Et Edith Bruck appartient désormais à ma vie.
Collaboration
Aymen Hacen : Vous collaborez aux Lettres françaises, une publication historique liée à la Résistance et à la Gauche. Pouvons-nous parler dans votre cas d’un choix volontairement politique ?
René de Ceccatty : C’est sur l’insistance amicale de Jean Ristat et de Franck Delorieux que je suis devenu depuis plus de dix ans un collaborateur régulier de cette revue qui était publiée, quand j’ai commencé à y écrire, comme un supplément de L’Humanité, donc un organe communiste. J’avais été un critique très engagé au Monde des Livres. Ce sont François Bott, Nicole Zand, Hector Bianciotti et surtout Josyane Savigneau qui m’ont incité à les rejoindre. J’y ai beaucoup écrit, pendant vingt-trois ans, avec une totale liberté. Quand Josyane a quitté le journal, j’en ai été évincé non sans humiliations par la nouvelle équipe. Découragé, je pensais arrêter toute critique quand Jean Ristat (que je connaissais depuis longtemps et avec qui des liens s’étaient renoués grâce à notre amie commune Silvia Baron Supervielle) qui déjà avait fait appel à moi pour des collaborations ponctuelles m’a ouvert ses pages. Et cela a été et demeure encore un grand bonheur. Nous le payons cher, si l’on peut dire… puisque nous sommes tous bénévoles et que le journal est peu, sinon pas distribué en kiosques. Il n’apparaît même plus sur Internet. Seuls les abonnés le lisent. L’environnement politique est certes d’un humanisme de gauche, mais nous n’avons pas le sentiment d’un combat idéologique. Le rédacteur en chef, Jean-Pierre Han, nous laisse une totale liberté d’expression, sans censure ni pression, ce que je n’ai jamais trouvé ailleurs. On vient de m’accueillir comme collaborateur extérieur dans le journal italien La Repubblica, mais dès mon quatrième article, j’ai senti des résistances. Et cela me bloque. J’ai écrit aussi avec une parfaite liberté dans les années 1990 dans Il Messaggero, le quotidien romain. Mais cette liberté n’est liée qu’à la confiance de personne à personne. Il faut, pour cela, un interlocuteur de grande envergure intellectuelle, un esprit libre qui accueille des esprits libres, une vraie amitié intellectuelle. Et c’est rare. Ni « amitié » ni « intellectuel » ne sont des termes qui conviennent pour parler de la plupart des suppléments littéraires en général opportunistes et encombrés de rédacteurs médiocres et arrivistes, écrivains ratés le plus souvent. Mon choix n’est donc pas politique, sinon que tout est politique… Mon choix est celui d’une affinité profonde, et il n’y a certes pas d’affinité profonde qui ne soit enracinée dans un terrain politique commun. Mais disons que cela n’a jamais été pensé comme un choix idéologique et encore moins sectaire.
René de Ceccatty l’éditeur d’Adonis
Aymen Hacen : Au Seuil, vous êtes l’éditeur d’Adonis (la trilogie d’Al-Kitâb traduite par Houria Abdelouahed et le volume Adoniada par Bénédicte Letellier). Pouvez-vous nous parler de votre relation avec ce grand poète arabe et universel ? Voilà bientôt trente ans qu’on attend à ce qu’il reçoive le prix Nobel de littérature. Que se passe-t-il entre l’ « Académie » et lui ?
René de Ceccatty : J’ai d’abord lu, en tant que critique littéraire, l’œuvre d’Adonis, que traduisaient alors Anne Wade Minkowski et Vénus Khoury-Ghata, que je connaissais toutes deux, et qui étaient fort différentes. La liberté, la virulence, l’intransigeance, la culture monumentale, l’humour, la simplicité, la modestie presque enfantine, la fantaisie chaleureuse d’Adonis m’ont stupéfait. Houria Abdelouahed, elle-même esprit rebelle, courageux, érudit, insolent, ironique m’a beaucoup aidé à comprendre l’Adonis le plus profond, celui qui lit et interprète la littérature classique arabe, préislamique. Leurs réflexions communes sur la poésie arabe, sur l’histoire politique du monde arabe, sur les liens délétères entre le pouvoir politique et la religion, sur la psychanalyse (Houria est psychanalyste), sur les femmes dans le monde arabe n’ont cessé de se creuser, dans trois entretiens qu’ils ont publiés (j’ai été l’éditeur de deux d’entre eux). Adonis a été victime de rumeurs concernant la Syrie. On lui a attribué une complaisance avec le régime de Bachar, pour une lettre (pourtant critique) qu’il lui a adressée. Le malentendu a été très difficile à lever. Vous savez, je n’aime pas commenter (ni en bien ni en mal) les choix de l’Académie suédoise. Assurément ils se sont portés sur de grands écrivains (comme Kawabata et Ôé, ou Pirandello, ou Derek Walcott, ou Faulkner), mais il y a eu trop d’oublis et trop d’écrivains d’une épouvantable médiocrité (leur choix de poètes est particulièrement affligeant) pour qu’on proteste quand un grand écrivain est négligé et même quand un écrivain banal est placé sur un piédestal. Un prix n’est qu’un prix, choisi par des êtres humains qui ont des goûts subjectifs et qui peuvent être soumis à d’innombrables pressions et qui sont, cela va de soi, loin d’avoir tout lu. L’idée d’un grand écrivain national, représentatif d’une culture, d’une langue, est plus que contestable. Adonis n’est pas politiquement correct, il n’appartient à aucune culture. Même si sa connaissance de l’arabe classique et de la poésie mondiale est exceptionnelle, il ne revendique pas une culture en particulier, et encore moins une nation. Il est né syrien, puis a été naturalisé libanais, puis français. Cela brouille les cartes. C’est trop compliqué pour des académiciens qui deviennent désormais des pions dans des relations politiques internationales complexes et changeantes. Ennemi de nombreux gouvernements confessionnels, régis par leur allégeance à un islam politique, Adonis est perpétuellement dérangeant. Son élection ne pourrait pas, contrairement au système sur lequel est fondée l’institution du Nobel, se transformer en hommage à son pays de naissance. Et il ne revendique pas non plus le statut de poète dissident.
Si vous deviez tout recommencer
Aymen Hacen : Si vous deviez tout recommencer, quels choix feriez-vous ? Si vous deviez incarner ou vous réincarner en un mot, en un arbre, en un animal, lequel seriez-vous à chaque fois ? Enfin, si un seul de vos textes devait être traduit dans d’autres langues, en arabe par exemple, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?
René de Ceccatty : Oh, ce sont des questions multiples. J’ai un regret, c’est de ne pas mieux connaître le langage musical. La création musicale est pour moi un modèle auquel j’aspire à faire ressembler mes livres, et mes traductions, c’est certain. Je l’ai dit, mon grand-père paternel était musicien, mon père aussi, ma grand-mère paternelle aussi (je l’ai appris tardivement, elle avait fait des études musicales au conservatoire de Bordeaux pour être cantatrice), mon frère est très mélomane, mon ami japonais jouait du piano et souvent m’accompagnait dans des lieder que je chantais très mal, aussi mal que Roland Barthes ; mon grand-père tunisien, Hamida, rêvait de créer avec ses filles un ensemble musical. Il jouait de la clarinette. J’ai beaucoup écrit de chansons, de comédies musicales, de livrets d’opéra. Travailler avec des compositeurs, des chanteurs est un réel bonheur pour moi. Si donc je devais me réincarner en un mot cela serait assurément musique. Un arbre, l’arbre de la sagesse. Un animal, il faudrait qu’il ait une conscience humaine, car je n’imagine pas de vie sans conscience. Et donc ce ne serait pas tout à fait un animal. Mais plutôt un monstre à demi animal à demi humain comme une sirène. Si un seul texte de moi devait être traduit en arabe, ce serait L’accompagnement, bref récit que j’ai publié en 1994, sur la mort d’un ami éditeur, écrivain et traducteur, Gilles Barbedette, du sida. C’est une réflexion sur la mort à l’hôpital, la déshumanisation et bien sûr sur une pandémie plus atroce que celle du Covid que nous venons de vivre et qui a eu d’énormes conséquences économiques et quotidiennes, mais sans rapport avec la tragédie révélatrice qu’a été celle du sida et qui a profondément transformé le regard que l’humanité portait sur la sexualité. Ce livre a été traduit en espagnol et en portugais, il est en cours de traduction en italien et en hébreu. Il a fait l’objet de nombreuses études. C’est le livre où j’ai voulu m’effacer pour laisser paraître le malade dont je faisais le portrait. Mais c’est un de ceux où j’exprime le plus clairement, me semble-t-il, ce que j’attends de la littérature. Je crois qu’il n’est pas nécessaire de me connaître, de connaître les différents aspects de ma vie tels qu’ils apparaissent dans cet entretien, pour le comprendre. Alors que mes autres livres, j’en suis conscient, réclament, pour qu’on y adhère, d’avoir à mon égard une curiosité et un parti pris de bienveillance (ce qui est le cas de la plupart des écrivains, quelle que soit leur valeur, du reste).
Aymen Hacen
Lire aussi
Roman
Souffle inédit
Magazine d’art et de culture
Une invitation à vivre l’art







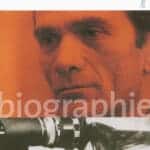


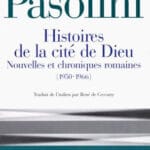










Remarquable entretien. Merci.