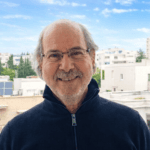Entretien avec Abdelhamid Larguèche sur l’héritage d’Ibn Khaldûn, la pensée critique et la responsabilité intellectuelle face à l’histoire contemporaine.
Abdelhamid Larguèche : l’historien et les leçons d’Ibn Khaldûn
Les jeudis littéraires d’Aymen Hacen
Abdelhamid Larguèche est professeur émérite en histoire et patrimoine à l’Université de La Manouba. Conseiller en patrimoine, il est ancien membre du Comité du Patrimoine Mondial à l’UNESCO. Son domaine de recherche est principalement centré sur l’histoire des minorités et des mouvements sociaux en Tunisie et dans l’espace méditerranéen au cours des XIXe et XXe siècles. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont principalement : Le Maghreb moderne à travers ses sources : études et documents (co-auteur [en arabe], Tunis, Centre de Publication Universitaire, 2006) ; Les Ombres de la Ville : pauvres, marginaux et minoritaires à Tunis aux XVIIIe et XIXe siècles (Tunis, Centre de Publication Universitaire, 1999) ; L’abolition de l’esclavage en Tunisie à travers les archives, 1841-1846 (Tunis, éd. Alif, 1990) ; Marginales en Terre d’Islam (Tunis, Cérès éd., 1992).
Sous sa direction a été organisée une journée scientifique le 25 mai 2024 ayant pour thème : « La Muqaddima d’Ibn Khaldûn, une œuvre universelle », dont les actes viennent de voir le jour.
A.H : Ibn Khaldûn (1332-1406) jouit d’une notoriété universelle. Pourquoi cette nouvelle journée d’études et quels ont été les critères pour choisir les conférenciers intervenants, ainsi que les textes retenus pour la publication ?
Abdelhamid Larguèche : Cette journée d’études ne se contente pas de célébrer un génie du passé, même si les enjeux patrimoniaux intègrent cette dimension. Elle cherche aussi à réactiver sa méthode, pour éclairer les impasses de notre temps. En montrant comment la Muqaddima peut nous aider à penser ; d’ailleurs les penseurs de chaque époque ont interrogé Ibn Khaldûn sur les impasses et les problèmes de leur temps :
- La fin de la croissance infinie ;
- Les nouvelles formes de solidarité sociale ;
- Les métamorphoses de la violence politique ;
- Les défis écologiques.
Cette initiative dépasse le cadre académique pour devenir un acte civilisationnel. Elle rappelle que la pensée arabo-musulmane classique, loin d’être un patrimoine muséal, constitue une ressource vivante pour imaginer des futurs alternatifs.
C’est finalement l’universalité même de la méthode khaldûnienne ― son exigence de causalité, sa vision organique des sociétés, son refus du dogmatisme ― qui justifie cette nouvelle rencontre et en fait toute l’actualité.

A.H : Vous écrivez dans votre introduction : « Le choix conscient d’inventer un champ scientifique nouveau lui a permis de se démarquer des chroniqueurs et des fuqaha (juristes), dont il n’était pas un grand spécialiste. C’est d’ailleurs à ce niveau que nous devons considérer ses déboires avec l’imam Ibn Arafa, qui a fini par le chasser de Tunis vers 1382. »
Pouvons-nous considérer que le lot des esprits tunisiens soit marqué par l’incompréhension, l’exil ou la mort prématurée, à l’instar du poète Abou El Kacem Chebbi ou du réformateur Tahar Haddad ?
Abdelhamid Larguèche : Ce que vous décrivez n’est malheureusement pas une exception, mais presque une règle dans l’histoire intellectuelle de notre région. Déjà, au IXᵉ siècle, le philosophe al-Kindī ― considéré comme le premier des philosophes arabes ― a vu certains de ses livres brûlés sous les Abbassides, accusé de rationalisme excessif. Plus tard, Averroès (Ibn Rochd) a été exilé et ses œuvres interdites pour avoir défendu la compatibilité entre la foi et la raison.
Ibn Khaldûn lui-même, dans La Muqaddima, évoque cette solitude du savant novateur : il parle de son « isolement dans un monde où toute science répondait à un besoin social régi par la tradition ».
Au XXᵉ siècle, Tahar Haddad a été ostracisé pour avoir défendu les droits des femmes et des travailleurs. Cette marginalisation des précurseurs n’est pas un hasard : elle révèle une tension structurelle entre la pensée critique et les pouvoirs ― religieux, politique, ou social. Mais c’est aussi le signe d’une vitalité intellectuelle qui refuse le conformisme. Ces esprits, bien qu’exilés ou censurés, finissent par incarner la postérité.
A.H : L’étude de l’histoire en tant que science humaine ne cesse de passionner les jeunes apprenants. Mais pouvons-nous parler d’une déconnexion entre le monde universitaire et la société ? À quoi bon l’histoire et les historiens ?
Abdelhamid Larguèche : Cette déconnexion est réelle, et elle est tragique. Pourtant, dès le Moyen Âge, des penseurs comme al-Fârâbî ou Ibn Khaldûn ont insisté sur le rôle social du savant. Pour al-Fârâbî, le philosophe doit aussi être un « législateur », un guide pour la Cité.
Ibn Khaldûn, dans La Muqaddima, définit l’histoire comme une science qui « va au-delà des faits pour inscrire les événements dans une logique compréhensive et rationnelle ».
L’historien n’est pas un antiquaire ; il est un vigie. Sa mission est de déceler, derrière l’apparent chaos des événements, les structures profondes, les cycles, les mécanismes du pouvoir ― ce qu’Ibn Khaldûn nomme « ’umrân » : la civilisation comme produit de l’action humaine.
Aujourd’hui, face aux manipulations mémorielles et aux populismes, cette fonction critique est plus nécessaire que jamais.
A.H : Dionys Mascolo, qui était le mari de Marguerite Duras, et l’ami intime de Robert Antelme et d’Edgar Morin, écrit : « Sont également de gauche en effet ― peuvent être dits et sont dits également de gauche des hommes qui n’ont rien en commun : aucun goût, sentiment, idée, exigence, refus, attirance ou répulsion, habitude ou parti pris… Ils ont cependant en commun d’être de gauche, sans doute possible, et sans avoir rien en commun. On se plaint quelquefois que la gauche soit “déchirée”. Il est dans la nature de la gauche d’être déchirée. Cela n’est nullement vrai de la droite, malgré ce qu’une logique trop naïve donnerait à penser. C’est que la droite est faite d’acceptation, et que l’acceptation est toujours l’acceptation de ce qui est, l’état des choses, tandis que la gauche est faite de refus, et que tout refus, par définition, manque de cette assise irremplaçable et merveilleuse (qui peut même apparaître proprement miraculeuse aux yeux d’un certain type d’homme, le penseur, pour peu qu’il soit favorisé de la fatigue) : l’évidence et la fermeté de ce qui est. »
En partant de cette thèse, seriez-vous un homme résolument de gauche ? Si oui, en quoi cela consiste-t-il exactement ?
Abdelhamid Larguèche : Je me reconnais dans cette idée du refus ― refus de l’injustice, de la domination, de la résignation. Mais je la nourris de notre propre héritage philosophique.
« Averroès », par exemple, a défendu l’idée que la vérité ne saurait contredire la vérité ― qu’elle vienne de la Révélation ou de la raison. Cette position lui a valu l’exil.
De même, « Ibn Khaldûn » analyse la violence d’État non comme un accident de l’histoire, mais comme une dimension constitutive du politique ― une violence qui doit être maîtrisée, orientée vers le bien commun.
Être de gauche, dans cet esprit, c’est refuser toute confiscation de la raison et toute instrumentalisation du sacré. C’est croire, comme al-Kindî, que « nous ne devons pas avoir honte d’accepter la vérité, d’où qu’elle vienne ». C’est un universalisme critique, ancré dans une éthique de l’émancipation.
A.H : Le monde, déjà ténébreux, s’est sauvagement obscurci depuis le 7 octobre 2023. Le monde dit « civilisé » a l’air de sombrer dans la barbarie et l’injustice car ceux-là qui soutiennent l’Ukraine contre Vladimir Poutine soutiennent Benjamin Netanyahou contre la Palestine et le Liban. Outre le deux poids deux mesures, il y a un véritable problème politique et éthique. Comment l’historien aborde-t-il cette actualité brûlante ? De quels outils disposons-nous pour y faire face ?
Abdelhamid Larguèche : L’historien ne peut rester silencieux face à l’injustice. Mais sa force est de « désengluer le présent de l’immédiateté ».
Ibn Khaldûn nous offre des clés précieuses : sa théorie des cycles dynastiques, son analyse de la « ’aṣabiyya » (cohésion sociale), sa distinction entre « badawa » (vie rude des campagnes) et « ḥaḍāra » (civilisation urbaine) nous aident à comprendre les dynamiques de pouvoir, de résistance, de déclin.
Quand je vois ce qui se passe en Palestine, je pense à cette phrase d’Ibn Khaldûn : « La violence est consubstantielle à l’État, mais sa finalité inconsciente reste l’épanouissement de la culture. »
Quand le pouvoir nie cette finalité, il devient pure prédation. L’outil de l’historien, c’est donc la « mise en perspective », le refus des récits simplistes, le retour aux sources ― y compris celles que les dominants voudraient oublier.
A.H : Si vous deviez tout recommencer, quels choix feriez-vous ? Si vous deviez incarner ou vous réincarner en un mot, en un arbre, en un animal, lequel seriez-vous à chaque fois ? Enfin, si un seul de vos textes devait être traduit dans d’autres langues, en arabe par exemple, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?
Abdelhamid Larguèche : Si je devais recommencer, je choisirais plus résolument encore la voie de la connaissance engagée ― pas seulement celle des bibliothèques, mais celle qui descend dans la rue à la rencontre des gens ordinaires. Je voudrais allier la rigueur de l’historien à l’engagement du citoyen, à la manière d’un « Ibn Ṭufayl », dont le « Ḥayy ibn Yaqẓān » fut bien plus qu’un conte philosophique : un plaidoyer pour l’autonomie de la raison, mais aussi pour l’expérience directe du monde.
Un mot ? « Ḥikma » ― la sagesse, oui, mais pas seulement. Dans notre tradition, la « ḥikma » est aussi l’art de relier le savoir à l’action, la connaissance à la justice. C’est ce qui manque cruellement aujourd’hui : des savants qui soient aussi des sages.
Un arbre ? Le palmier-dattier ; Ce n’est pas seulement un arbre ― c’est une civilisation. Il incarne la résilience, la générosité, la verticalité. Il prospère dans des terres arides, tout en offrant nourriture, ombre et fraicheur. Comme lui, je voudrais être ancré dans un sol ― celui de l’histoire et de la langue ― tout en portant des fruits qui traversent les frontières.
Un animal ? Le faucon pèlerin ; pas seulement pour sa vue perçante, mais pour sa trajectoire : il plane haut, observe de loin, mais fond sur sa proie avec une précision implacable. C’est une métaphore du travail de l’historien : prendre de la hauteur pour mieux comprendre, puis redescendre pour saisir la vérité.
Et si un seul de mes textes devait être traduit, je maintiens mon choix : Les Ombres de la Ville : pauvres, marginaux et minoritaires à Tunis aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles. Parce qu’il est le plus khaldûnien de mes écrits. Il ne s’agit pas seulement d’histoire sociale ; il s’agit d’une archéologie de la mémoire des vaincus. Comme Ibn Khaldûn l’a fait pour les dynasties, j’ai voulu déceler, derrière le récit officiel, les lois cachées qui régissent la vie ― et la survie ― des anonymes. Ce livre est un hommage à tous ceux que l’histoire a oubliés, mais sans lesquels aucune civilisation ne tiendrait debout.