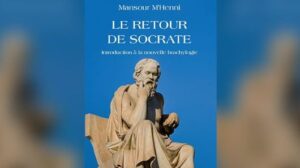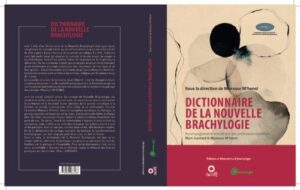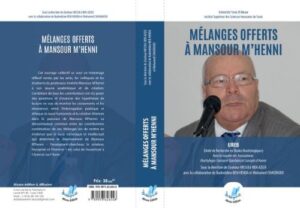Mansour M’henni : « La Tunisie a toujours été une terre du Savoir et de l’Intelligence »
Les jeudis littéraires d’Aymen Hacen
Né à Sayada le 24 mars 1950, Mansour M’henni est Professeur émérite de l’Université Tunis El Manar depuis 2016. Poète, prosateur et essayiste, il est, entre autres, spécialiste de l’œuvre de Kateb Yacine, auquel il a consacré plusieurs écrits et une thèse soutenue à Paris XIII en 1986, La quête du récit (Éditions L’Or du Temps et Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse, 2002).
Son œuvre, aussi inspirée que prolifique, ne cesse de découvrir de nouveaux horizons, à l’instar d’une approche innovée et innovante du concept de « La Méditerranéité » et de celui de la « Nouvelle Brachylogie » qui est mis en pratique dans des textes de création et développé dans des essais dont notamment Le Retour de Socrate, publié à Tunis (2015) et à Paris (2017), ou encore le prestigieux volume publié sous sa direction, Dictionnaire de la Nouvelle Brachylogie, en 2024.
A.H : Nous voudrions commencer par le commencement, par Sayada, votre lieu natal : comment l’enfant du Sahel tunisien est-il devenu l’universitaire, l’intellectuel et le francophile que vous êtes ?
Mansour M’henni : Je pense qu’il faut juger ce cursus comme la juste voie d’une destinée déterminée par les conditions générales d’une nouvelle Tunisie renaissant au milieu du XXe siècle du fruit d’une pensée réformiste politiquement concrétisée par l’image de Bourguiba (sous le pouvoir duquel j’ai été un opposant mais devenu, avec le temps et une mûre réflexion, un de ses adeptes incorruptibles). Dans ce contexte particulier, un homme et une femme n’ayant aucune formation scolaire et un seul fils à élever, se sont dévoués, corps et âme, à le convaincre que le savoir et la science sont les deux jambes qui doivent conduire son chemin de vie. Je crois avoir très tôt intériorisé cette conviction et l’avoir renforcée par des leçons tirées de mon contact avec des personnes de grande inspiration et de brillante lumière.
Quant à la francophilie, je préfère corriger le terme dans votre question par « la francophonie », celle initiée par Bourguiba et Senghor, porteuses de valeurs humaines inaliénables et capable d’extension sur toutes les communautés linguistiques ou ethniques, car fondée sur le respect de l’autre dans la logique de « l’aimance » khatibienne.
A.H : La poésie semble être votre premier amour, mais pas seulement, car il y a la prose, la fiction, l’essai. Comment organisez-vous votre écriture, votre rapport aux genres littéraires, sans oublier vos diverses tâches universitaires, intellectuelles et académiques ?
Mansour M’henni : La poésie et le conte étaient ma première école de la culture populaire, celle conduite par ma mère et sa voix qui, dans d’autres conditions, en aurait fait une vraie Diva de la force douce des chants religieux et des chants des fêtes. Tous nos proches parents l’invitaient à chanter dans leurs fêtes et elle n’hésitait pas à faire don de sa vocation. Mais mon père aussi était sensible aux chants et aux contes populaires, ainsi que ma tante paternelle dont la vie alternait le veuvage et la répudiation et qui, se joignant à nous dans ses moments de séparation conjugale, me comblait de récit toutes les nuits avant mon sommeil.
Mais quand j’ai commencé à écrire, c’est la poésie arabe qui m’a retenu à l’âge de 13 ans, en deuxième année secondaire, cette poésie de l’amour naissant pour des filles de l’entourage. C’était sans doute l’aboutissement logique à la fois de cette formation familiale doublée d’un apprentissage de plusieurs sourates du Coran au Kouteb (école coranique), mais aussi des nombreuses lectures des livres qui nous venaient d’Égypte et du Moyen-Orient : les Kamel Kilani, les Jūrjī Zaydān, Manfalouti, Gibran, Ilya Abu Madhi, etc. À quinze ans, c’est la découverte du romantisme, surtout de Lamartine, qui m’ouvrit la voie à la poésie française, avant ma plongée dans les lectures littéraires à portée philosophique, notamment Camus, Kafka, Sartre.
À cela s’est ajoutée ma passion pour le cinéma depuis mon très jeune âge, d’abord dans les projections ambulantes dans toutes les places de notre village et surtout chez mon père spirituel, un cousin de mon père, instituteur, qui m’a fait entrer à l’école primaire mixte de Lamta-Sayada une année avant l’âge de six ans, feu Ahmed M’henni (Alias Hassen Gacem), un exemple de générosité, de bonté et de conscience citoyenne. L’amitié de si Hassen avec Tahar Chériaa y est certainement pour quelque chose, même si la pratique était généralisée dans le pays. Puis au Lycée, c’est les ciné-clubs qui ont fait le reste.
Donc cette variété des formes d’expression a suscité mon intérêt pour tous les genres et la lecture de récits des Mille et une Nuits m’a familiarisé avec l’entremêlement des genres littéraires. Cependant le phénomène deviendra un des principaux axes de réflexion, d’étude et d’expériences de création littéraire avec l’intérêt que j’ai porté à l’œuvre de Kateb Yacine.
Quant à la pluralité de mes occupations, toutes me semblent émaner d’une énergie inépuisable pour l’action et pour le don, ainsi que de cet amour premier pour la culture, le savoir, la connaissance, la communication et cette conscience très tôt inspirée par des personnes prises pour de bons exemples de citoyenneté et d’humanité.
A.H : Vous ne cessez de créer et la brachylogie semble être votre fer de lance. Pouvez-vous nous présenter ce concept qui, pour certains, a tout d’une weltanschauung ?
Mansour M’henni : Vous ne croyez pas si bien dire. C’est sans doute le mot d’ordre qui doit accompagner tout cheminement dans la pensée néo-brachylogique : « La Nouvelle Brachylogie est une weltanschauung ». C’est un peu le titre de ma dernière communication, « La Brachylogie est une philosophie », dans la Journée d’étude organisée par l’association Brachylogia le 15 février 2025 à la FLSH de l’Université de Sousse autour de la question « Repenser le langage et la brachylogie ».
En effet, en passant par un long travail d’étude, d’enseignement et de réflexion sur les formes brèves du discours et sur les genres brefs en littérature, j’ai été confronté à la figure de rhétorique appelée « Brachylogie » et dépréciée dans ce cadre de façon contrastant avec la place qu’elle occupe dans les Dialogues socratiques de Platon. J’ai donc commencé à creuser, à chercher et à essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de cette marginalisation de la brachylogie. Et à l’issue d’une relecture de la pensée socratique à ce propos, j’ai conclu à un vrai complot scientifique et intellectuel conduit par la rhétorique contre la pensée de Socrate et j’ai fini par ramener la condamnation à mort de Socrate à ce même complot.
Après l’expérience de toute une vie, Socrate en est arrivé au caractère fallacieux de la démocratie athénienne, sa vraie fierté. Il a donc dénigré cette démocratie fondée sur la manipulation par la rhétorique du discours pour convaincre n’importe qui de n’importe quoi, indépendamment du souci de la vérité. Il a donc appelé au dialogos, dans son sens premier de conversation, celle-ci devant être présidée par « l’esprit de conversation » qui exige l’égalité de statut des interlocuteurs (donc des citoyens de la Cité), le respect d’autrui et la relativisation de la vérité de chacun. Dès lors, la conversation ne cherche plus à convaincre à tout prix, elle cherche plutôt à trouver en autrui l’image de soi qui pousse à revoir et à réviser ses propres vérités et à rester toujours en état d’interrogation. De ce fait, la brièveté qu’on a confondue avec la brachylogie ne serait en fait qu’un instrument de la Brachylogie en tant que Philosophie : parler brièvement pour laisser la place à l’autre dans la conversation et pour se donner le temps de l’écouter et de penser à la lumière de ce qui est écouté.
Voilà comment en 2012, j’ai pris l’initiative de lancer officiellement ce nouveau concept, la Nouvelle Brachylogie, qui est actuellement dans des établissements universitaires d’une vingtaine de pays de trois continents (Afrique-Maghreb, Asie et Europe), ainsi que des représentants individuels en Amérique du Nord (Canada).
Donc : oui ! « La Nouvelle Brachylogie est une weltanschauung » parce qu’elle n’est pas simple figure marginale de la rhétorique mais une vraie rivale de celle-ci, et qu’elle est une « vision du monde » et une « philosophie de vie ».
A.H : Vous avez enseigné pendant plusieurs années. Vous ne cessez d’ailleurs de le faire à travers vos différents travaux, académiques et associatifs. Quel serait, à votre avis, l’avenir la langue française en Tunisie et du Savoir, oui avec une majuscule, dans notre pays ?
Mansour M’henni : L’avenir de la langue française en Tunisie peut paraître compromis au vu des campagnes de dénigrement et de certaines oppositions à cette langue au nom d’un passé colonial prolongé par un néo-impérialisme. Il faut d’abord remarquer que ces campagnes tendent à se généraliser dans la région et peut-être même dans plusieurs pays d’Afrique. Ce qui est malheureux, c’est que les gens ne se rendent pas compte qu’en appelant à la suprématie généralisée de la langue anglaise (qui, du point de vue intellectuel et culturel, reste aussi importante que n’importe quelle langue, ni plus ni moins), sans doute par une stratégie manipulatoire bien étudiée, ils ne font que consacrer un impérialisme extrêmement envahissant, plus que tous les autres, autant dans le passé que dans le présent. Il convient plutôt de relire objectivement l’Histoire.
La démarche est donc biaisée, me semble-t-il. N’oublions pas que chaque peuple a été ou a essayé d’être un colonisateur, tout comme il a été ou failli être colonisé. Par ailleurs chaque colonisation a été aussi un contexte d’interactions linguistiques et culturelles. Le mieux est donc d’essayer de tirer profit de ce qui peut rester comme « un butin de guerre », selon la célèbre expression de Kateb Yacine, plutôt de continuer à chercher les raisons du conflit là où il peut y avoir des ponts de coopération et de solidarité entre les peuples et les États. Souvenons-nous du proverbe qui dit : « Un homme vaut autant d’hommes qu’il n’en connaît de langues ». Donc une langue acquise est d’abord un moyen de plus pour acquérir plus de savoir, avec et sans la majuscule. Rappelons-nous également, en tant que Musulmans, le dit du Prophète : « Celui qui apprend la langue d’un peuple sera préservé de son Mal ».
Il y a certes beaucoup de maladresse dans la conduite politique de la question de la francophonie, mais ce n’est pas une raison pour se laisser brimer ou brider par cette politique.
Quant au Savoir en Tunisie, il ne me paraît pas en danger. La Tunisie a toujours été une terre du Savoir et de l’Intelligence, même pendant les périodes où elle paraissait soumise et endormie. On regrette certes un manque d’appui aux intelligences sérieuses et sincères. On regrette également un certain mépris parmi ceux-là même qu’on appelle l’élite, faisant que chacun essaie de dénigrer l’intelligence de l’autre et de minimiser son importance. Mais cela ne reste pas et le temps vient toujours à bout des forces régressives parce que le temps est foncièrement positif, il ne fait qu’avancer : il est d’une modernité toujours renaissante, d’un progrès ininterrompu.
Tout recommencer !
A.H : Si vous deviez tout recommencer, quels choix feriez-vous ? Si vous deviez vous incarner ou vous réincarner en un mot, en un arbre, en un animal, lequel seriez-vous à chaque fois ? Enfin, si un seul de vos textes devait être traduit dans d’autres langues, en arabe par exemple, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?
Mansour M’henni : Si je devais recommencer, je ferais le même chemin pour être toujours moi-même autant dans la fiction que dans la réalité.
Si je devais me (ré-)incarner en :
Un mot : amour
Un arbre : palmier ou olivier
Un animal : l’animal humain que je suis, pour garder mon petit capital d’intelligence.
Quant à la traduction de mes textes, je crois que certains d’entre eux sont bien traduits. En arabe, je pense à la traduction de L’Araignée par feu Mahjoub Ayari, un grand poète, paix à son âme ! La traduction non moins brillante de mon roman La Nuit des mille nuits ou Le Roi des pendus (Prix International Kateb Yacine en Algérie en 2014), par Mohammed Aït Mihoub. La traduction, au Caire, de mon recueil La Deuxième déjà… ou c’est toujours la première, par Atef Abdelmajid.
Mon recueil Mots d’amour est traduit en espagnol et sa publication est prévue en 2025. La traduction arabe du Retour de Socrate est en cours de finalisation. En plus de textes choisis traduits en espagnol, en anglais et en italien et publiés dans des anthologies personnelles ou collectives.
Donc, c’est peut-être le recueil Petits poèmes en dose (publié à Paris en 2018) qui peut constituer une matière intéressante à traduire, tout comme le recueil Créencontres (Tunis, 2003).