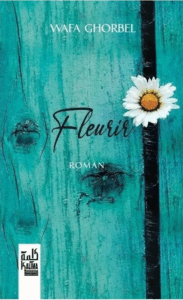Wafa Ghorbel : de la littérature à la scène, le parcours inspiré d’une artiste franco-tunisienne aux multiples voix.
Wafa Ghorbel, l’art au pluriel
Entretien conduit par Monia Boulila
Wafa Ghorbel est une universitaire, écrivaine et chanteuse franco-tunisienne née à Sfax. Docteure en littérature française, elle soutient une thèse sur Georges Bataille en 2004 à la Sorbonne Nouvelle.
Sa carrière littéraire débute avec Le Jasmin noir (2016), suivi de Le Tango de la déesse des dunes (2017) et de Fleurir (2024), trois romans récompensés.
Chanteuse passionnée, elle conçoit des spectacles mêlant jazz, musiques orientales et poésie, comme Rhapsodie turquoise, Oriental Jazz Standards ou Mes tissages.
Membre du Parlement des Écrivaines Francophones, elle incarne une voix artistique singulière, à la croisée des cultures, des langues et des disciplines.

Rencontre
M.B : Dans Le Jasmin noir qui a marqué les esprits dès sa parution, vous abordez des thèmes intimes. Quelle a été l’étincelle initiale de ce roman ?
Wafa Ghorbel : Puisque vous parlez d’intimité, je dirais qu’un besoin intime était effectivement à l’origine de ce premier roman. Il n’est pas né d’un événement précis, mais plutôt d’un glissement intérieur, d’un passage d’une étape à une autre dans ma vie. Je venais d’achever la rédaction de ma thèse, un travail rigoureux, structuré, où la subjectivité n’avait que peu de place. J’ai ressenti le besoin presque organique de revenir à une expression plus libre, plus incarnée qui me permettrait d’explorer des zones plus sensibles, plus souterraines en moi. Le Jasmin noir est né de cette transition, de ce désir d’ouvrir une brèche dans le discours pour y insuffler imagination, tempérament et personnalité dans une parole moins scolaire, plus intuitive, plus habitée.
M.B : Vos romans semblent habités par une quête de liberté féminine. Est-ce un fil rouge volontaire ou une nécessité intérieure ?
Wafa Ghorbel : Je ne crois pas avoir posé consciemment ce fil rouge au départ, mais il s’est imposé de lui-même. Il s’agit peut-être d’une nécessité intérieure de rendre compte de la quête d’une liberté jamais figée, qui ne cesse de se redéfinir. La question de la liberté féminine me traverse profondément, toujours accompagnée de celle de l’identité : comment habiter son corps, sa voix, son histoire, quand on est une femme ? Et comment cette identité, loin d’être statique, se construit, se déconstruit et se reconstruit au fil du temps, au gré des rencontres, des épreuves, des choix ? Mes personnages féminins vivent cette tension, entre l’aspiration à une émancipation et la nécessité de s’inventer en permanence. À travers eux, je poursuis moi aussi cette traversée : celle d’une liberté à conquérir, d’une identité à réinventer.
M.B : Dans Fleurir, on trouve une grande puissance poétique. Comment ce livre s’inscrit-il dans votre trajectoire d’écrivaine ?
Wafa Ghorbel : Fleurir s’inscrit dans ma trajectoire comme un tournant stylistique et existentiel. Ce roman m’a permis d’oser une forme plus libre, plus musicale, presque chorégraphique. J’ai voulu écrire un texte qui chante, qui hurle, qui danse, qui trébuche, qui tape des mains et des pieds, à l’image de ses personnages, de leurs voix, de leurs blessures et de leurs élans. La poésie n’y est pas un ornement, mais une respiration, une nécessité vitale. J’y explore un rapport organique à l’écriture, en m’autorisant des ruptures de ton, des images fulgurantes, des mots ciselés qui battent au rythme intérieur de l’héroïne.
Fleurir, c’est aussi le roman de l’intime et du politique, de la révolte qui passe par le corps, par le verbe, par la mémoire et par l’art. Il me semble que ce livre marque une affirmation plus nette de ma voix d’écrivaine, une voix qui cherche la vérité dans l’éclat du sensible, dans les marges du langage, dans les silences aussi.
Dans Fleurir, il y a un dépassement de mes deux premiers romans, Le Jasmin noir et Le Tango de la déesse des dunes, à plusieurs niveaux : D’abord, par la complexité de la structure narrative, avec ses récits enchâssés et ses voix multiples, chacune portant sa propre temporalité et sa propre perception du monde ; Ensuite, par la diversité et la profondeur des personnages, par leurs traumas et par les thèmes abordés, des plus intimes aux plus universels ; Enfin, par cette promesse de floraison, un motif récurrent dans mes précédents romans également, mais qui, ici, se déploie d’une manière plus poussée. La floraison, comme un floreo en flamenco (image dominante dans le livre) se lie au mouvement fluide et puissant des mains de la danseuse, chaque geste, chaque mouvement étant une expression de résistance, de beauté et de renouveau.
Fleurir est aussi un roman qui, au-delà de son inscription dans ma trajectoire d’écrivaine, résonne avec mon cheminement de femme : il se nourrit de mes propres expériences, de ma propre maturité et porte l’empreinte de cette quête incessante de réinvention. Il représente un tournant, une manière plus affirmée d’aborder l’écriture et la vie, avec une vision plus claire de ce que j’ai à dire, de ce que j’ai vécu et de ce qui m’anime. La floraison dans ce roman n’est pas une simple résilience, mais un cheminement continu, une possibilité d’épanouissement qui dépasse les épreuves pour embrasser l’inconnu, avec toute la beauté et la fragilité qui en découlent.

M.B : Vous avez-vous-même traduit Le Jasmin noir en arabe littéraire. Comment avez-vous vécu ce retour vers la langue maternelle ?
Wafa Ghorbel : L’autotraduction du Jasmin noir a été un véritable défi que je me suis lancé. C’est ainsi que je l’ai vécu. Je voulais d’abord me prouver que j’étais encore capable d’écrire et de m’exprimer en langue arabe. Je voulais aussi donner aux arabophones, notamment à mes parents, la possibilité de me lire pleinement, de découvrir ma plume. Je voulais, par ailleurs, défier mon surmoi dans la langue qui me met le plus à nu : ma langue maternelle-paternelle, même si le dialecte tunisien est, en réalité, ma véritable langue maternelle, et que l’arabe littéraire en est l’écrin le plus proche.
Cet exercice fut difficile, périlleux. Le français représente pour moi une sorte de bouclier, une peau protectrice, qui me permet de m’exprimer sans m’autocensurer. C’est mon épiderme linguistique. L’arabe est, en revanche, ma chair vive, mon derme, la langue qui touche à mon intimité la plus souterraine, celle des tabous, des complexes, des lignes rouges qui ont longtemps façonné mon rapport au monde.
M.B : Comment articulez-vous votre double appartenance culturelle dans votre écriture, entre la France et la Tunisie ?
Wafa Ghorbel : Ma double appartenance culturelle, tunisienne et française, traverse profondément mon écriture. Même si je n’ai vécu en France que huit ans, cette expérience de l’exil et du déracinement a façonné une grande partie de mon rapport au monde et à la culture.
Le français – que j’ai commencé à apprendre à l’école, vers l’âge de neuf ans – est la langue dans laquelle je m’exprime pleinement et en toute liberté, aujourd’hui. Il m’offre un espace pour explorer des formes variées de narration, de réflexion et d’émotions, parfois plus rationnelles, parfois plus poétiques, tout en étant aussi un terrain fertile pour développer ma plume. L’arabe, quant à lui, reste la langue de mes racines, celle qui résonne avec une force particulière en moi, qui m’ancre dans mes souvenirs, mes tabous et mes complexes. Bien qu’aujourd’hui je n’écrive quasiment qu’en français, ma culture tunisienne, nord-africaine et arabo-musulmane imprègne mes romans à travers les sujets traités, le métissage linguistique et culturel par la présence de mots, d’expression, de chansons… Ces éléments viennent enrichir le texte, lui donner une texture particulière, une couleur différente. Ils nourrissent les interactions de mes personnages avec leurs identités.
Dans mes romans, cette interaction entre la langue française et ma culture tunisienne n’est pas une opposition, mais plutôt une complémentarité sereine. Le français, avec sa structure ouverte, me permet de construire des ponts intellectuels, tandis que ma culture d’origine me relie à des émotions plus viscérales, à une sorte d’intimité qui reste toujours présente, même dans les moments les plus universels de l’écriture. Le français devient alors le véhicule de ma pensée et de mes sentiments, tandis que les éléments culturels puisés dans mes racines tunisiennes apportent une couleur unique à mon écriture.
Mes personnages, souvent pris dans un va-et-vient entre les deux rives de la Méditerranée, essentiellement entre la France et la Tunisie, incarnent cette quête identitaire. Ces allers-retours ne sont pas seulement géographiques. Ils sont surtout émotionnels et culturels. En permettant à mes personnages d’évoluer en mouvement, je leur donne l’opportunité de s’interroger, de se réinventer et de confronter leurs identités plurielles. Cela m’offre également la possibilité d’élargir les horizons de ma narration, de toucher des territoires plus vastes et de donner à mes récits la profondeur de ces échanges interculturels.
M.B : Quel a été l’impact de votre recherche sur Georges Bataille dans votre travail de romancière ?
Wafa Ghorbel : La recherche que j’ai menée sur Georges Bataille a profondément influencé ma manière d’envisager la littérature. Elle m’a permis de franchir certaines limites, de m’autoriser une parole plus libre, plus audacieuse. Bataille m’a confrontée à une pensée radicale, celle qui ose explorer des zones obscures de l’expérience humaine : la sexualité, la mort, le sacré, la violence, la transgression. Grâce à lui, j’ai pu aborder des sujets considérés comme tabous, souvent esquivés ou censurés, en particulier dans les contextes arabo-musulmans, (j’ai dit censurés, mais pire encre, autocensurés). Cette liberté qu’il s’octroie, cette façon de mettre en tension l’érotisme et la spiritualité, le corps et le langage, m’a donné la force de creuser mes propres obsessions narratives.
Sur le plan formel aussi, l’influence de Bataille a été sensible. Son usage fragmentaire du texte, sa ponctuation marquée – les points, les points de suspension, les tirets, les parenthèses, les ruptures de rythme – m’ont donné des outils stylistiques pour traduire l’intensité de certaines émotions, l’éclat des silences, « la tempête blanche », le chaos intérieur de mes personnages. J’ai trouvé dans sa manière d’écrire non un modèle, mais une permission, une ouverture, un élan.
Cela dit, je suis pleinement consciente que mon écriture s’inscrit dans une autre filiation. Elle ne cherche ni la même radicalité ni la même brutalité. Lorsque Henri Béhar, mon ancien directeur de recherches, a lu Le Jasmin noir, il m’a confié que mon écriture n’avait pratiquement rien à voir avec celle de Bataille. Et je partage son avis. Ce qui me distingue de lui, c’est d’abord le ton, la forme d’humanité que je cherche à préserver, même dans la douleur. Là où l’univers de Bataille plonge dans une obscurité souvent sans retour, dans un abîme sans fond, je tente d’ouvrir des brèches vers la lumière, vers une forme de réconciliation.
Mon écriture est traversée par le sensible, par une attention à l’intime, parfois nourrie d’ironie, de violence, de poésie, mais souvent nuancée, même si j’avoue qu’il lui arrive d’être extrême. Je ne suis plus fascinée par l’anéantissement (je l’ai été à un moment). Ce qui me subjugue désormais, ce sont les résistances discrètes, les élans de vie dans la chute, les échappées dans l’épreuve. Et si Bataille m’a accompagnée un temps – et m’accompagne encore sur le plan académique – je sens aujourd’hui que je m’en détache, que je trace une voie plus personnelle où l’expérience des limites ne mène pas nécessairement ni au vertige ni au désastre, mais parfois à une forme d’apaisement. Attention : je ne parle pas de béatitude niaise.

M.B : En tant qu’universitaire, comment percevez-vous l’évolution de la place des femmes dans la critique littéraire francophone ?
Wafa Ghorbel : En tant qu’universitaire et romancière d’expression française, j’observe depuis quelques années une visibilité croissante des femmes dans le champ de la critique littéraire francophone. Cette évolution est salutaire, même si elle reste fragile et parfois inégale selon les espaces géographiques. Des auteures longtemps reléguées aux marges, ou cantonnées à des lectures strictement genrées, commencent à être relues, rééditées, revalorisées. On pense aux travaux universitaires récents qui s’intéressent à des figures majeures de la littérature féminine maghrébine ou africaine, ou encore aux prix littéraires qui s’ouvrent de plus en plus aux voix féminines. Mais cette avancée ne peut masquer une autre forme d’invisibilisation, plus structurelle : celle qui touche les écrivains francophones non hexagonaux, qu’ils soient femmes ou hommes.
J’aimerais que la critique littéraire française cesse de penser le monde francophone à partir de son seul centre. La périphérie n’est pas une zone grise ou secondaire. C’est un lieu d’invention, de tension, de création linguistique et formelle. Il n’est pas simplement question d’une affaire de représentativité ou de quotas : il s’agit de transformer les cadres mêmes de la lecture, d’interroger les catégories, les normes, les hiérarchies qui régissent encore la réception des œuvres.
Dans ce contexte, être une femme francophone du Sud, écrivant en français, mais habitée par d’autres langues et d’autres héritages, c’est se situer au croisement de plusieurs lignes de fracture. Cela implique de naviguer entre visibilité et invisibilisation, entre accueil et méfiance, entre inclusion symbolique et marginalisation réelle. En tant que chercheuse, je constate que même dans les universités, certaines voix restent sous-explorées, parfois à cause de préjugés tenaces, parfois simplement parce qu’elles ne s’inscrivent pas dans les circuits habituels de légitimation.
Mon souhait serait donc double : que la critique accueille davantage les écritures féminines dans toute leur diversité, sans les réduire à leur genre, et qu’elle se montre plus attentive à la pluralité des expériences francophones. On ne lit pas de la même manière lorsqu’on vient d’un autre rivage. Et il me semble que ce sont ces lectures plurielles, ces voix croisées qui enrichissent le plus profondément notre rapport à la littérature.
M.B : De Fairouz à Abdel Wahab, en passant par Nina Simone et Édith Piaf, vos spectacles traversent des répertoires aux ancrages culturels et esthétiques très différents. Quelle réflexion ou quel fil conducteur sous-tend ces choix musicaux ?

Wafa Ghorbel : Mon parcours musical s’est construit au fil d’une géographie intérieure et affective, traversée par des voix, des langues et des répertoires qui m’habitent. J’ai commencé par des reprises jazzy de Fairouz dans Rhapsodie turquoise, avant de me tourner, dans Oriental jazz standards, vers les standards américains du jazz que j’ai adaptés en arabe, qu’il soit littéraire ou dialectal. Ce travail de traduction (tradaptation) musicale a été pour moi une manière d’inscrire une tradition étrangère dans un imaginaire familier, de la réinventer à travers ma langue.
Par la suite, j’ai orienté mes choix vers les grandes chansons françaises à textes – Brel, Piaf, Ferré, Barbara, entre autres – que j’ai également adaptées en arabe, dans Mes tissages. Il ne s’agit pas d’une simple traduction, mais d’un véritable travail d’appropriation poétique, d’écoute des résonances communes entre ces répertoires et ma propre sensibilité. Plus récemment, je suis revenue aux classiques de la chanson orientale, en particulier à des compositions de Mohamed Abdel Wahab que j’ai revisitées avec mes partenaires artistiques dans Nuits blues (« سهرت منه الليالي »).
En parallèle, je poursuis un travail plus intimiste autour de la poésie tunisienne, avec la mise en musique de textes de la poétesse Zoubeida B’chir que je présenterai bientôt dans un spectacle intitulé Nostalgie (« حنين »). Il s’agit de mes premières expériences en matière de composition. Ce projet me tient particulièrement à cœur car il prolonge mon désir de faire dialoguer la voix chantée et la mémoire poétique, l’héritage culturel et la réinvention personnelle.
Le fil conducteur de tous ces choix, au-delà de l’éclectisme apparent, est le désir de tisser des liens entre les rives, entre les langues, entre les époques. De Fairouz à Sarah Vaughan à Warda, de Nina Simone à Barbara à Najet, de Billie Holiday à Piaf à Om Kalthoum… je me sens attirée par des voix qui portent une charge émotionnelle forte, une intensité existentielle, parfois une forme de révolte ou de blessure. Ce sont elles qui me guident et qui donnent sens à mon parcours de chanteuse autant qu’à mon écriture. D’ailleurs ces artistes ainsi que tant d’autres sont présents dans mes romans qui réservent tous une place prépondérante à la musique.
M.B : Le spectacle Mes tissages mêle différentes cultures et émotions. En quoi raconte-t-il votre propre histoire ?
Wafa Ghorbel : Mes tissages est sans doute le spectacle qui me ressemble le plus. Il est né d’une rencontre, d’un désir de dialogue et de métissage : dialogue entre les cultures, entre les esthétiques musicales, mais aussi entre les langues et les sensibilités. Ce spectacle raconte mon propre cheminement entre plusieurs mondes : celui de l’Orient et de l’Occident, du savant et du populaire, de l’arabe et du français, du jazz et du charki, de l’intime et de l’universel.
Il met en scène un tissage à la fois musical et identitaire. J’y chante en arabe dialectal, en arabe littéraire, en français, parfois même en espagnol et en anglais. J’y reprends, traduis et réinvente des standards occidentaux que je fais résonner autrement dans ma propre langue, dans ma propre voix. C’est à travers ces adaptations et ces réécritures que je raconte mon histoire : celle d’une femme qui vit entre deux rives, entre deux eaux, entre plusieurs appartenances, mais qui refuse de choisir.
Avec Mehdi Trabelsi, pianiste nourri de musique classique, et Hichem Ktari, oudiste imprégné de tradition orientale, nous avons créé un espace de liberté musicale, une forme de conversation entre nos héritages respectifs. Le spectacle est intimiste, mais il vise l’universel : il part de mon histoire personnelle pour toucher quelque chose de plus large, ce besoin que nous avons toutes et tous, peut-être, de faire dialoguer les mondes qui nous habitent.
Chaque représentation est une traversée, une manière de faire vibrer ensemble des fils a priori dissonants, discordants, hétérogènes, mais qui, une fois tissés, forment une tresse harmonieuse, une texture unique, celle de mon identité plurielle, toujours en mouvement.

M.B : Quelle place occupe la musique dans votre vie d’écrivaine ?
Wafa Ghorbel : Pour moi, musique et écriture sont indissociables. Elles naissent du même élan intérieur, de la même pulsation vitale. Quand j’écris, j’entends une musique intérieure, un souffle, une rythmique qui structure la phrase comme un phrasé musical. Et quand je chante, mon chant est une forme d’écriture corporelle ou vocale, en plus d’être complètement écriture puisqu’il est question de traduction et d’adaptation. Dans mes romans, la musique est plus qu’un simple décor : elle est une présence constante, presque un personnage à part entière qui donne son tempo à la narration. Je le dis souvent : Je chante en écrivant et j’écris en chantant.
Dans Le Jasmin noir, le personnage principal féminin est une chanteuse, et les deux personnages masculins principaux sont musiciens. L’univers musical y structure les relations humaines, les désirs, les ruptures. Dans Le Tango de la déesse des dunes, j’ai glissé de la voix chantée à la voix du corps, en explorant la figure d’une danseuse de tango oriental : une danse de couple, sensuelle, où chaque mouvement dialogue avec l’autre. Enfin, dans Fleurir, le personnage féminin est une danseuse de flamenco, seule face à elle-même, et le personnage masculin est, encore une fois, musicien. J’y explore une danse solo, plus explosive, plus intérieure aussi. Il y a là un parcours, un cheminement : je suis passée du chant à la danse, d’une expression collective ou amoureuse à une expression de plus en plus intime, de la lenteur de la ballade, du jazz ou du tango à la vivacité enflammée du flamenco.
À chaque étape, les arts du rythme – qu’il s’agisse de musique, de danse ou d’écriture – dialoguent, se répondent, s’influencent. Mon écriture est traversée par cette rythmique. Elle est marquée par les silences, les syncopes, les envolées. Et lors de mes lectures publiques, j’aime croiser la voix parlée et chantée comme autant de manières de dire ce qui ne peut pas toujours s’écrire.
Merci infiniment d’avoir ouvert l’espace de Souffle inédit à mon souffle, à ma voix.