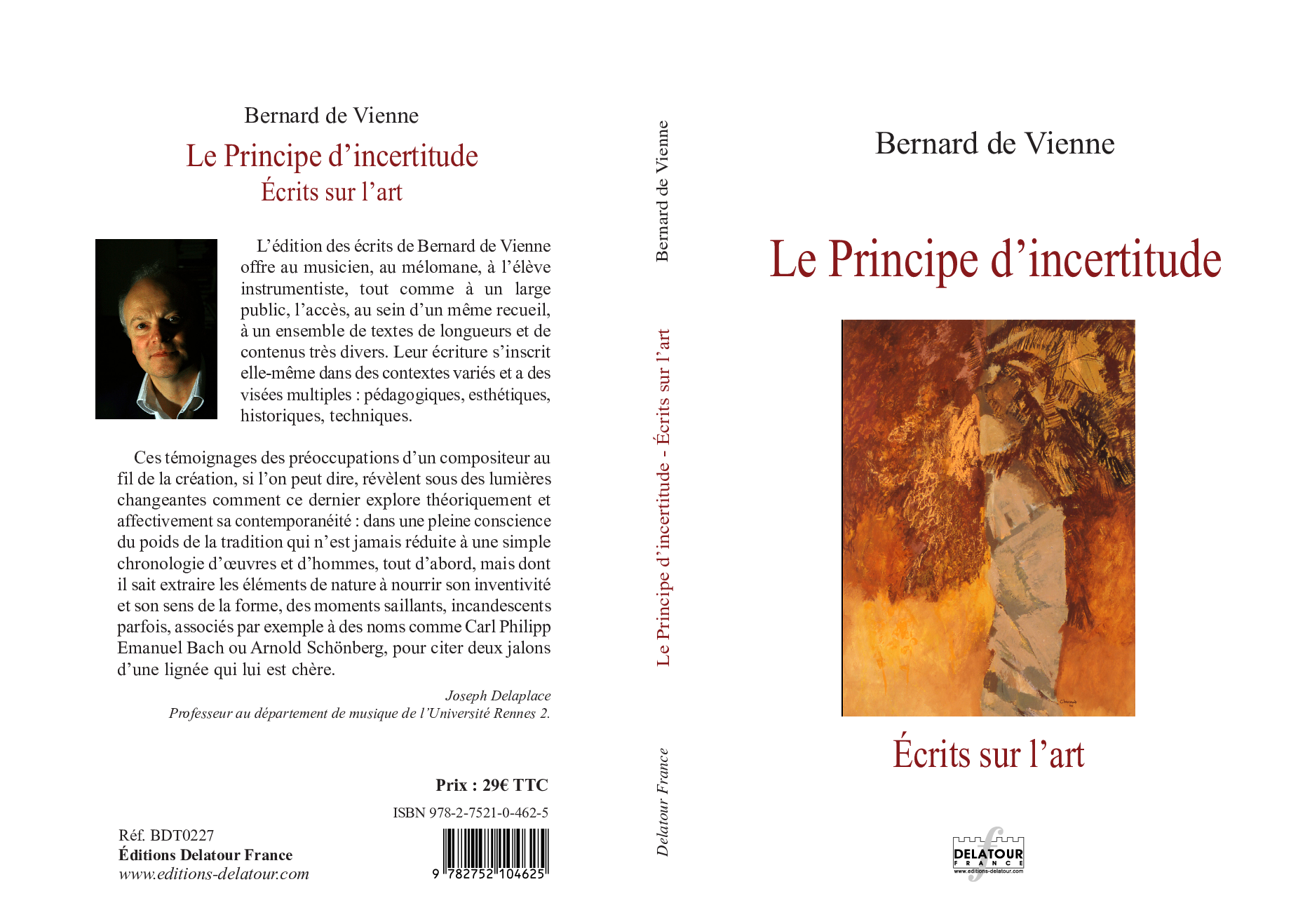Texte et musique 2007 – 2021
Bernard de Vienne compositeur
Extrait de l’ouvrage de Bernard de Vienne, Le Principe d’incertitude – Écrits sur l’art, sortie mars 2023 – Éditions Delatour France – ISBN : ISBN 978-2-7521-0-462-5
La poésie, c’est le réel quand il devient surréel.
Sylvain Tesson
Avant la parole, le souffle.
Avant le souffle, l’inspiration.
Jean Mambrino [I]
Le texte suivant a été écrit pour être prononcé lors d’une rencontre dont la thématique était Le silence en musique. Il introduisait l’écoute de mon œuvre pour soprano seule Les échos du silence. Représentatif de la façon dont j’envisage le rapport texte-musique, il est question ici d’un écrit de Sylvie Germain mais aurait pu concerner les poèmes de Claude-Henry du Bord [1], ceux de Philippe Jaccottet, ou mon Poème lyrique Kim Vân Kiêu [2], et tellement d’autres poètes et écrivains qui n’ont cessé de m’accompagner au long de ma vie.
Les échos du Silence (2005) [II]
Pour soprano solo (ou ténor ou mezzo) jouant aussi 2 crotales (durée : environ 8 minutes 30)
Texte de Sylvie Germain, extrait de Éclats de sel (© Éditions Gallimard, 1996)
Dédiée à Nathalie Pannier
Création le 19 janvier 2006 à la Halle Saint-Pierre (Paris 18e) par la dédicataire
Éditions Symétrie
Il faut envisager cette œuvre comme une scène d’un opéra où le protagoniste se parlerait à lui-même devant son reflet dans un miroir. Ce peut être son propre prénom qu’il scande tout au long de l’œuvre car son double l’interpelle. A défaut je suggère Ludka pour une femme et Ludvík pour un homme.
Cette courte œuvre, de caractère très intérieur, joue sur les divers niveaux de lecture du texte de Sylvie Germain qui peut être interprété selon les quatre sens de l’Écriture : littéral, allégorique, moral et anagogique. Ce dernier sens est particulièrement souligné par la musique.
De nombreuses ressources expressives de la voix sont ici sollicitées : mélodique, parlé / chanté, parlé (déclamé, scandé…), détimbré, souffle…
L’argument
Une femme (ou un homme) se tourne vers la fenêtre du compartiment du train dans lequel elle (il) effectue un voyage sans espoir de retour. Elle (il) croise dans la vitre le regard de son propre reflet. Ce regard est à la fois le sien et celui d’une femme (ou d’un homme) lui ressemblant étrangement, aperçu(e) quelques instants auparavant lors d’un arrêt dans une petite gare.
Dans ce regard, comme dans celui de l’inconnu (e), la même gravité un peu douloureuse, une égale expression d’attente, de patience. Elle (il) ne sait pas s’il s’agit d’elle (lui) ou de l’autre. Elle (il) ne se reconnaît pas dans la flagrance de sa propre image. Elle (il) avance la main vers la vitre et effleure du bout des doigts les lèvres closes de son reflet. Alors la bouche s’entrouvre et se met à lui parler d’une voix assourdie et ténue :
Prénom de l’interprète 2 fois (ou Ludka ou Ludvík) […] Regarde-moi, écoute-moi… […] Depuis l’instant de ta naissance je me suis attaché à ton souffle, à ton cœur. Je suis le cri de ta naissance, et ta mémoire d’avant ce cri. J’ai pris part à chacun de tes jours, je t’ai suivi pas à pas, geste à geste, et je me suis couché dans chacune de tes nuits. Souvent, sur ton épaule, j’ai posé la main, mais tu n’as su alors que hausser le dos avec désinvolture et repousser ma main, ainsi qu’on époussette de disgracieux grains de poussière. J’ai porté le poids de tes peines, de tes chagrins, et celui, plus lourd, de tes doutes. Mais le plus écrasant fut celui de ton indifférence, de ton désabusement. Je serrais pour toi dans ma paume un infime bris de lumière, un éclat de silence, mais tu étais toujours la proie de tant de faux mouvements du cœur et de l’esprit que je ne parvenais jamais à déposer ce grain en toi… (prénom 1 fois), à force d’être absent à toi – même et écœuré de tout, tu t’es perdu de vue, tu t’es perdu de cœur, et tu m’as à ce point méconnu, et tu t’es à ce point mal aimé que tu as fini par me détacher de toi, par te délier de toi, te détourner des autres… (prénom 1 fois), depuis si longtemps je te recherche et je t’implore comme un chien répudié par son maître, je te recherche et je m’afflige comme un maître qui a perdu son chien, je te recherche et je t’adjure comme un frère en quête de son frère prodigue et oublieux… (prénom 1 fois), il fait si froid dans ton oubli, il fait si sombre dans ton ennui, il fait si faim, et soif, dans ton inattention au mystère de ce monde… [3]
Analyse
Pourquoi choisir de mettre en musique un texte Sylvie Germain ? En quoi la musicalité de son écriture trouve-t-elle un prolongement dans ma musique ? En quoi son écriture est-elle liée au silence et à l’écoute [4] ? En quoi peut-on en déduire une conception de l’écriture et de la création ?
Pour l’athée que je suis depuis maintenant bien longtemps [5], le questionnement humaniste de Sylvie Germain pose une question singulière due à son attirance envers les mystiques – objet de défiance et de rejet dans le christianisme – pour lesquels croire est un engagement personnel absolu, relevant d’un comportement à la marge des religions et, socialement, à la limite de l’acceptable et du compréhensible.
On peut donc interroger la nature de sa croyance et le doute qui l’habite. Dans ce contexte spirituel, son attirance pour l’Humain (et ses contradictions, ses douleurs et ses fragilités), les parias, les rejetés, les réprouvés de la société (tels ceux de Freaks, le film de Tom Browning), et donc aussi les mystiques, est significatif de son regard sur l’humanité. De plus, la tendresse manifeste qu’elle leur voue n’est pas pour me déplaire : il y a une bonne dose d’angoisse derrière tout cela et, la concernant, un apaisement trouvé dans l’amour de la « simplicité » de la nature (ce qui n’empêche nullement sa complexité). Son constant dialogue « avec soi-même », et avec ce qu’elle appelle « le mystère », pose la question de savoir de quelle croyance il s’agit. Ce n’est pas l’objet de mon propos présent sauf en ce qui concerne le parallèle que je vois entre la création artistique (l’acte créateur authentique) et la croyance extrême des mystiques qui implique un engagement total que je ressens être du même ordre. Depuis le XIXe siècle – mais est-ce simplement depuis ce siècle ? – le sens populaire le dit : les « véritables » artistes partagent avec les mystiques d’être « asociaux » et « habités de l’intérieur ». Cette disposition d’esprit et cet engagement – qui n’habitent pas tous les compositeurs, loin s’en faut – induisent dans les actes une conduite personnelle et, artistiquement, des thématiques et une pensée formelle singulière.
Cet extrait de texte est un dialogue avec soi-même dû à une extrême souffrance – une rupture – qui impose un changement radical de vie. Le narrateur – l’autrice elle-même, Ludvík dans le texte – sait que plus rien ne peut être comme auparavant. Dans ce moment d’hypersensibilité et réceptivité à tout, le regard d’un homme aperçu sur le quai d’une gare se révèle un signe qui l’interpelle et dans lequel elle lit le reflet de ses propres tourments. Expérience banale s’il en fut, mais pas vraiment quotidienne, où l’on est réceptif au « plus profond de soi-même » tant psychologiquement que physiquement. Certains événements du passé redeviennent présents, « remontent » selon le sens commun. Ces « couches de passés » dont parle le philosophe Gilles Deleuze [6] concourent à l’idée que l’on se fait de soi, de sa propre continuité, de son identité et interroge le sens que l’on donne à sa vie.
La thématique du double – si ce n’est celle des multiples hétéronymes [7] – a probablement son origine et sa source dans cet état d’hyper sensibilité et réceptivité. Hors du contexte psychiatrique, et de façon plus prosaïque, on se « distancie » alors de soi-même pour moins souffrir et « on fait le point, on réorganise les pièces de son puzzle intérieur » en fonction de son nouvel « environnement » pour « se retrouver et se raccrocher » à l’essentiel. Les différentes couches du passé, virtuelles mais réelles, deviennent alors actuelles et se brassent de telle sorte qu’elles ne sont plus perçues comme passées mais comme toutes en relation dans ce moment présent.
Jusque-là, rien que de très ordinaire d’un point de vue psychique – même si ce n’est pas si simple à envisager, et encore moins à vivre – mais surtout bien mieux dit poétiquement par d’autres que moi depuis des siècles par la sagesse populaire, la philosophie, la littérature, la poésie et, à leur suite la psychologie.
Le rapport avec l’écriture
Mettre en musique un texte – mais ce type de questionnement est peu ou prou le même dès que l’on travaille avec un autre art (danse, théâtre, image…) –, consiste en se poser des questions dont les réponses sont essentiellement techniques : la musique comme redondance ou opposée de ce qui est dit ? La musique évoquant autre chose que ce que disent les mots (remord, désir, anticipation, souvenir, sentiment contraire, etc.) ? La musique envisagée comme l’amplification et / ou le prolongement des accents, des intonations et des affects propres à la langue ?
En effet, bien que la langue et la musique aient leurs propres règles, elles ont en commun, dans certaines limites, des couleurs, des registres, des rythmes et, par l’écriture, des règles de structuration de la forme assez proches (narration).
Dans l’œuvre qui nous intéresse ici, j’ai fait le choix de ne pas avoir d’accompagnement instrumental si ce ne sont deux crotales tibétaines, écho antique de Sappho chantant ses désirs. Sylvie Germain est-elle si éloignée de cela ? Cette simple ponctuation de cloches aiguës renvoie sans cesse au silence et à la rupture. En revanche, souvent, un même enchaînement mélodique ou un même rythme pour des paroles différentes. Là, même si le procédé est connu, pour employer un vocabulaire psychanalytique – Nietzschéen à l’origine – ça dit quelque chose, ça crée du sens, ça met en relation ce qui a priori ne l’est pas et, à tout le moins, révèle ma lecture et mon interprétation du texte. Ce procédé est en acte la possibilité qu’ont les différents moments du passé à coexister.
Dans mon œuvre présente, l’écriture suit ici pas à pas le texte « quasi psychologiquement », et met en relation des moments éloignés dans le temps formel de l’œuvre, mais proches en pensées et en affects.
Le rapport de la matière et de la forme
D’un point de vue général, la forme d’un texte n’est pas la forme de la musique, et réciproquement, même s’il y a beaucoup de points communs purement rhétoriques : combien de compositeurs étaient jusqu’à la fin du XVIIIe siècle professeurs de grec, latin et rhétorique ! Combien d’opéras, même au-delà du XVIIIe siècle ont vu leur musique écrite en partie avant les paroles ?
La logique plastique de la musique implique un déploiement dans le temps qui est le prolongement de ce qu’on appelle la musique des mots (idée triviale mais vraie). Mais ce temps musical n’est pas le même car le ressenti des mots – et du sens de ceux-ci sur le corps et la conscience – n’est pas le ressenti des sons. Un orchestre jouant fortissimo impressionne et stupéfie tellement qu’il faut du temps à l’auditeur pour s’en remettre, ce que sait tout compositeur [8]. Par contre, si un comédien hurle un texte – ce qui est moins courant qu’un orchestre jouant fortissimo, et trop souvent le signe d’une mauvaise direction d’acteur – l’impact purement kinésique sera malgré tout moins violent (mais parfaitement désagréable…), et le temps « pour s’en remettre » plus court. Même si l’imprégnation du sens dure, cela n’empêche pas de continuer à écouter, à moins d’être violemment choqué par le sens de ce qui est dit.
De plus, certaines expressions textuelles ouvrent sur ce qui est commun aux deux arts. L’injonction première « regarde-moi, écoute-moi » [9] évoque d’emblée le positionnement face à une création artistique : pour entendre et s’entendre, il faut regarder et écouter activement, s’écouter et être attentif à soi-même, faire acte de volonté. Souvenez-vous de Picasso disant : « l’œuvre doit déranger, nous transformer » mais, pour cela, il faut que nous le désirions car être réceptif est un acte délibéré de « faire silence ». Mais à quoi est-on réceptif ? Au fait que notre vie aurait pu être autre si nous étions restés attentifs au « mystère » de ce monde ? A ce qui me fait être ici et maintenant ? A ce que je pense être réellement sans faux-fuyants ? Au constat que lorsque j’écoute vraiment (écoute active proche de la méditation), je suis « effaré » car renvoyé à mon manque de mémoire, mon indifférence, mon désabusement ? Sans écoute de soi (ou de l’œuvre) on se méconnaît, on se détache de soi et des autres, on passe à côté d’une expérience qui peut nous transformer ou, à tout le moins, on se prive de la possibilité de se découvrir comme un être de pensée et de sensibilité.
Quelle est la conséquence en musique ? Un rapport à la forme bien particulier qui fait de la répétition et du retour le fondement de l’écriture, ce que je nomme la forme en spirale et en expansion, sorte de reprise variée, à ne pas confondre avec le répétitif à l’identique.
En quoi cela fonde une esthétique et une « théorie » formelle ?
Les musiques « profondes » sont celles qui recèlent plusieurs niveaux d’écriture et, nous recentrant sur nous-même, nous font ressentir les « mystères de ce monde », notre propre complexité d’affects et, non sans humour, nous font aimer les autres et la vie (version optimisme) ou définitivement désespérer d’eux et du monde (version pessimiste). Cette « inattention aux mystères de ce monde » est donc l’opposé de la véritable écoute. Celle-ci ouvre sur une esthétique artistique car écouter « activement » convoque la sensibilité de l’auditeur et, au préalable celle de l’interprète dont le jeu ne peut être uniquement basé sur la technique (non qu’il faille la récuser car elle est un préalable incontournable). Au niveau de la forme, le sensible (« regarde, écoute ») peut être provoqué de deux façons principales : soit on frappe de stupeur puis on « développe », soit on amène l’auditeur progressivement jusqu’à une sorte de catharsis, l’un n’excluant pas l’autre.
Dans Les échos du silence, nous sommes dans une forme libre, ouverte : il n’était pas question pour moi de remplir une forme préétablie. Raison pour laquelle j’aime cette fin de texte en forme de reproche et d’inachèvement : « Il fait si froid dans ton oubli, il fait si sombre dans ton ennui, il fait si faim, et soif, dans ton inattention au mystère de ce monde… » Le plus profond de soi-même est à découvert, et nous renvoie à nous-même.
Cette forme musicale ouverte est d’autant plus une esthétique, si ce n’est une éthique, qu’elle pose question et, à l’image de la vie provoque un sentiment d’inachèvement. Elle interpelle et propose à l’auditeur de refaire le parcours du compositeur pour être appréhendée en ressentant le réseau de correspondances qui sous-tend l’œuvre. En effet, nous faisons avec n’importe quelle œuvre entrée au répertoire ce lent et patient travail de mémoire, mais moins avec l’art actuel dont le temps n’est pas encore celui du retour sur soi.
Comme bien des artistes, la mémoire, mère de toutes les muses, hante Sylvie Germain, et pour cause ! La mémoire historique est une chose, la mémoire personnelle une autre, et la mémoire des autres mémoires encore autre chose. Cette « convocation » de la mémoire se traduit dans mon écriture par une forme circulaire, faite de plis, tours, détours et retours, reprises, ritournelles ou fragments répétitifs, départs et re-départs, etc. Ce prolongement contemporain de la forme musicale appelée rondo (ABACAD) est non linéaire, et se caractérise par un retour et / ou re-départ à n’importe quel moment du temps passé, et par le fait que tout motif, ou fragment de motif, peut devenir signifiant et infléchir la forme [10]. Mais pour cela, il faut aussi considérer le temps musical comme circulaire et pas seulement linéaire : deux temps musicaux sont imbriqués, c’est le paradoxe de la musique. D’une part le temps linéaire du jeu, et d’autre part le temps circulaire de la forme elle-même. De plus, après écoute, ce qui nous reste en mémoire en un mélange de simultané et de successif [11]. C’est précisément toutes ces impressions entre-mêlées qui sont l’état premier de ce qu’un compositeur a en tête avant d’écrire une œuvre pensée comme une architecture de sons. La composition consiste alors à rendre successif ce qui est en fait simultané dans son esprit.
Voilà le lien avec ce texte : la notion de double réside dans ce rapport des deux temps pensés « à égalité ». Le présent (ce que j’écoute à un moment x) est toujours en relation avec les passés et les futurs (l’ensemble des moments de l’œuvre). Les « doubles » (les différentes variantes et motifs) sont toujours déjà là et resurgissent dans le travail de mémoire qu’est l’écoute musicale « active » comme à l’instar de la vie humaine, dans certaines circonstances, l’ensemble des passés coexistent dans le temps présent.
La forme circulaire s’apparente à une philosophie de l’existence qui peut trouver une application et justification religieuse et/ou répondre à une nécessité artistique et esthétique comme dans mon cas. Nous oscillons tous entre une course à l’abîme, sorte de fuite en avant qui se traduit très bien musicalement, et un travail de retour et de nouveaux départs : le fantasme de tout effacer et repartir à zéro qui nous apaiserait dans une sorte d’apologie de la vie (joie pure, fraîcheur, reconnaissance, etc.).
Le tragique à l’œuvre chez Sylvie Germain est que, tout en sachant cela – le temps passe et tous les passés coexistent dans mon présent – mon présent passe inexorablement : la musique comme oubli [12], comme mémoire, ou « comme consolation » m’a-t-elle dit un jour.
Le rapport avec le silence
Pourquoi avoir choisi comme titre Les échos du silence [13] et non Éclat de sel ?
Cette réponse de Sylvie Germain montre que mon intuition était correcte indépendamment du fait que Les échos du silence est à mon sens un meilleur titre musical. La musique naît du silence et y retourne, l’écoute et le recueillement sont liés au silence.
Je ne serais pas étonné que le rapport de Sylvie Germain à la création artistique soit un certain constat d’impuissance face au réel, et que sa croyance ne soit pas vraiment d’un grand réconfort. Dans ses divers livres, le philosophe Clément Rosset [14] a très bien montré que les personnes habitées de cette désespérance lucide (la déshérence chez Sylvie Germain) peuvent en même temps éprouver les plus grandes joies. Le constat que « seul le réel est » peut conduire au sentiment de l’inanité de l’existence [15]. Il est à mon sens ancré définitivement au plus profond de nous dès notre naissance et, pour reprendre les expressions de l’écrivain Stig Dagerman [16] : « les ruses du croyant, l’optimisme, l’aveuglement, la raison, etc. » sont des pis-aller masquant mal cette angoisse et l’impossibilité de répondre de façon satisfaisante aux questions existentielles : le réel tel qu’il est.
L’attitude des mystiques et les « mystères de ce monde » sont probablement la limite de ce que l’on peut comprendre et admettre du « pourquoi » de l’existence dont on ne sait rien, et du réel n’étant rien d’autre que lui-même. De là naît ce discours d’harmonie avec la nature : nous sommes avec elle sur un seul et même plan, une seule et même manifestation du vivant. Mystère car on sent bien quelque chose nous échapper et, laissant « ouvert » cet état de fait en ne donnant pas de réponses, à ce moment je me sens exister [17].
Poétiquement, l’intérêt de la création artistique est non pas « qu’elle nous venge de la vie », ou qu’elle serait une image de la vie [18], ou à l’image de la vie… mais, en rêvant et en proposant une vie idéale, elle nous console de notre lucidité, apaise nos angoisses, et nous rappelle que « l’art consiste à libérer la vie que l’homme a emprisonnée » [19].
L’art fait naître un espoir : nous survivre à nous-même.
[I] Jean Mambrino, Le mot de passe, Troyes, Andas, p. 143.
[II] En écoute sur : https://www.bernarddevienne.com/les-echos-du-silence
[1] Claude-Henry du Bord, Éloge du vivant, œuvres poétiques, 1980-2010, Bourg-la-Reine, ZurfluH.éditeur, 2010.
J’ai mis en musique plusieurs de ses poésies. Ami de longue date, ses écrits me parlent intimement. Nous avons des centres d’intérêts communs et un même sens de la forme envisagée comme un réseau de correspondances. Ses images et sa langue particulièrement musicale sont en proximité poétique avec l’aura poétique de ma musique.
- D’un seuil à l’autre pour chœur mixte
- Chants nus pour voix de soprano et piano
- Ton corps à tout jamais pour baryton-basse et piano
- 137 pour 3 voix solistes, chœur amateur, 2 pianos et 2 percussionnistes
- L’oiseau du paradis perdu, un conte musical
[2] Kim Vân Kiêu, Poème lyrique en quatre chants et un épilogue pour cinq voix et piano (et récitant ad lib.), sur un texte de Huynh Quôc Tê, librement adapté du Kim Vân Kiêu de Nguyên Du : https://www.bernarddevienne.com/k
[3] Sylvie Germain, Éclat de sel, Paris, Gallimard folio, 1996, p. 178-176.
[4] Robert Bresson, Notes sur le cinématographe, op. cit., p. 113 : « Dans le rire catholique-grec : « soyez attentifs ! »
[5] Bien qu’ayant reçu une éducation catholique, je préfère laisser les questions existentielles ouvertes estimant que personne n’aura jamais de réponses en termes de vérité absolue. Les préceptes et conduites édictées par quelques religions que ce soit ne peuvent en aucun cas s’ériger en certitudes. Par contre, la volonté d’un cheminement personnel pour agir sur soi-même me semble incontournable dans le rapport aux autres et au monde, ce que l’on nomme l’humanisme. Celui-ci transparait dans les titres de mes œuvres et dans les projets poétiques de celles-ci. Pour toutes ces raisons, je m’intéresse aux sciences qui étudient le comment et non le pourquoi, les vérités scientifiques étant réfutables et non absolues. Ce concept de réfutabilité a été théorisé par le philosophe Karl Popper dans son ouvrage La logique de la découverte scientifique (1934), Paris, Payot, 1973.
Bibliographie
[6] Réflexion développée dans ses deux livres sur le cinéma L’image-mouvement et plus particulièrement L’image-temps, Paris, Les Éditions de Minuit, 1983 et 1985.
[7] Au moins soixante-douze hétéronymes pour l’écrivain portugais Fernando Pessoa et vingt-quatre pour William Standley Milligan dont l’écrivain américain Daniel Keyne a raconté la vie dans Les mille et une vies de Billy Mulligan, Paris, Le livre de poche, 2009.
[8] C’est la raison pour laquelle une œuvre totalement fortissimo, ou le prolongement fortissimo d’un moment d’une œuvre, visent à mettre l’auditeur dans un état proche de la transe. Photoptosis, prélude pour grand orchestre (1968) de Bernd Alois Zimmermann ou Thrène à la mémoire des victimes d’Hiroshima pour 52 instruments à cordes (1959) de Krzysztof Penderecki, sont de parfaits exemples parmi tant d’autres.
[9] Cette injonction n’est pas sans rappeler celle du poème de Philippe Jaccottet, Nuages de novembre, extrait de son recueil A la lumière d’hiver, Gallimard, 1977, p. 90.
(…) Écoute, écoute mieux, derrière / tous les murs, à travers le vacarme croissant/qui est en toi et hors de toi / écoute… (…)
Poème que j’ai mis en musique dans ma Première symphonie de chambre pour voix de mezzo-soprano et ensemble intitulée L’envie de partir : https://www.bernarddevienne.com/l-envie-de-partir
[10] Considérant une œuvre comme un organisme vivant, je parle alors de notion d’accident, de mutation, de contamination, etc.
[11] Cela n’exclue pas que vous puissiez connaître par cœur une œuvre et vous la remémorer « dans le temps linéaire ».
[12] Oublier « le malheur naturel de notre condition faible et mortelle. » Blaise Pascal, « 139, Divertissement », Pensées, 1670.
[13] Titre d’un autre livre de Sylvie Germain, Les échos du silence, Paris, Desclée de Brouwer, 1996.
[14] Par exemple, Clément Rosset, Principes de sagesse et de folie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1991, p. 44 : « Le sentiment jubilatoire de l’existence est curieusement très proche de la nausée de l’existence et tend même à s’y confondre jusqu’à un certain point, le fait que l’existence existe étant éprouvée dans les deux cas avec une égale et exceptionnelle intensité. »
[15] Le fameux livre du philosophe roumain Emil Cioran, De l’inconvénient d’être né, Paris, Gallimard, 1973, décline sous forme d’aphorismes fragmentés l’absurdité de la condition humaine.
[16] Stig Dagerman, Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, Paris, Acte Sud, 1952, p. 11.
[17] « En présence du même spectacle énigmatique, l’artiste descend en lui-même (…) il parle à notre capacité de joie et d’admiration, il s’adresse au sentiment de mystère qui entoure nos vies, à notre sens de la pitié, de la beauté et de la souffrance, au sentiment latent de solidarité avec toute la création… » Joseph Conrad, Le nègre du Narcisse (1913), Paris, Gallimard L’imaginaire, 1984 pour la traduction française, p. 12.
[18] Ce n’est pas directement le propos de cette conférence mais, au sujet de l’image, problématique extrêmement intéressante dans les religions du Livre, ce qui se détache est justement le fait que l’image a une vie propre. Au sujet des figures, dans les icônes, les orthodoxes disent : « Les icônes ne montrent pas notre monde mais le monde d’après la parousie [le retour glorieux du Christ à la fin des temps], le monde d’après le huitième jour, le monde à venir. » « Si elles sont construites sur la base de ce que l’on appelle une « perspective inversée », c’est parce que le point de fuite est non pas l’horizon, comme dans la perspective réaliste, mais le cœur du spectateur ; ce n’est pas le spectateur qui regarde l’icône, c’est l’icône qui regarde le spectateur. » Jonathan Littell, Triptyque, op. cit., p. 102. Bien des artistes disent de même, particulièrement depuis le XXe siècle et l’abandon de la perspective réaliste : « l’image pense, dit, vit, est organique, etc. » comme en une sorte de sécularisation d’une problématique jusque-là religieuse. Cela pourrait sembler contradictoire avec le fait de dire, à l’instar de Peter Brook, que « la vie n’est jamais dans l’œuvre elle-même ». Mais on parle de deux choses différentes : dans un cas est évoqué le fonctionnement et la logique interne de l’œuvre, dans l’autre cas, ce que projette dans celle-ci l’auditeur, c’est-à-dire la capacité qu’a une œuvre d’éveiller en nous des affects.
[19] R comme Résistance / L’Abécédaire de Gilles Deleuze et Claire Parnet / Produit par Alain Boutang, vendredi 9 août 2013.
Crédit photo de couverture ©Gabriel de Vienne – ADAGP
Musique