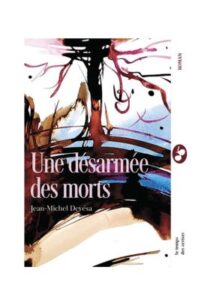Entretien avec Jean-Michel Devésa : «Écrire pour conjurer l’amer »
Les jeudis littéraires d’Aymen Hacen

Né à Alger le 14 juillet 1956, Jean-Michel Devésa est professeur émérite. Spécialiste de littérature française des XXe et XXIe siècles, il a enseigné en France, en Europe, en Afrique et aux États-Unis.
À ses yeux, la forme aboutie de la critique réside dans l’écriture. C’est pour cela qu’il s’est attelé progressivement à la construction d’une œuvre romanesque : Bordeaux, la mémoire des pierres (2015), Une fille d’Alger (2018), Scènes de la guerre sociale (2020), Garonne in absentia (2021).
Jean-Michel Devésa, président de l’Association Jacques Abeille, et aussi membre du jury du prix Sade et du prix Les Afriques, est chroniqueur régulier à Collatéral et à Quinzaine(s).
Demain, vendredi 7 février 2025 paraît, aux éditions Le Temps des Cerises, Une désarmée de morts, roman.
A.H : Ce nouveau-né, qualifié de roman, et il l’est à bien des égards, l’est-il vraiment ? Comment le qualifier, non seulement d’un point de vue générique, mais du point de vue de l’écriture et surtout de la création littéraire ?
Jean-Michel Devésa : Vaste question que la vôtre, elle alimente la critique et la théorie littéraire depuis des lunes et elle est à l’origine d’une production énorme d’ouvrages, decatégorisations génériques, et aussi de pas mal d’arguties et d’assertions péremptoires. Je vous répondrai par conséquent avec prudence et sans dissimuler mes incertitudes et mes doutes.
Tout d’abord, je ne prétends pas que mon livre rende compte sur le mode documentaire ou sur celui du témoignage d’une histoire que j’aurais vécue ou qu’une personne autour de moi, ou bien encore que j’aurais croisée, aurait vécue. Je ne cherche pas à raconter une histoire, je m’échine à écrire des histoires. Ce qui se fonde sur le fait que je ne doute pas que la langue – toutes les langues humaines – soit (en partie) défaillante pour restituer la réalité et le vrai. Nos langues en effet ne sont pas transparentes à ce qu’elles désignent. Elles expriment au mieux un mi-dit, pour reprendre un mot de Jacques Lacan. Et si je voulais m’abriter derrière l’autorité de ce dernier, j’ajouterais (à condition que vous m’autorisiez à le paraphraser) que la vérité, certes, je voudrais l’énoncer or je ne peux qu’échouer dans cette entreprise car, pour la dire, toute, la vérité, les mots me manquent… Il en découle que, dans la vie quotidienne, et a fortiori en littérature, restituer un événement, un fait, une situation, c’est nécessairement recourir à la fiction. Et, en matière d’écriture littéraire, ce facteur est amplifié par le fait que l’usage que les écrivains font de la langue est principalement poétique alors que les sujets que nous sommes, dans les relations utilitaires qui sont les nôtres, nous mettons l’accent sur la fonction de communication du langage.
Je poursuivrai en vous confiant que mes livres ont tous un ancrage dans la réalité, et assez souvent dans ce qui m’est arrivé, ou dans ce à quoi j’ai assisté. Cela étant, je me garde d’affirmer que je verse dans une écriture autobiographique. Non par pudeur. Ni par autocensure. Là encore, les « outils » à notre disposition ne nous permettent pas de représenter « fidèlement » ce que l’on a vu, senti, ressenti. Il y a toujours un écart entre l’expérience et sa représentation. Voilà pourquoi je suis plus à l’aise avec la notion d’autofiction : j’écris une histoire que je nourris d’éléments empruntés à ma vie ou à celle de proches (ou à celle d’individus rencontrés) en sachant que je ne parviendrai pas parfaitement à mes fins, mais je m’y applique, je m’entête à parachever cette tentative, sans ignorer que je ne réussirai pas totalement, il n’empêche que je m’y emploie…
Cette manière d’autofiction a, chez moi, nécessairement une ou plusieurs attaches avec l’Histoire, le collectif, le politique. Je serais malheureux si mes livres participaient de son seul « moi », de mon seul « ego ». Quelle arrogance ce serait ! Quelle vanité ! Et quel peu d’intérêt ces ouvrages nombrilistes auraient-ils ! Je trouve qu’il convient, en permanence, de se demander comment écrire une histoire singulière qui soit de nature à « parler » au plus grand nombre, à une multitude de lectrices et de lecteurs qui, a priori, sont pour moi des inconnus. Un écrivain n’écrit pas pour les siens, ni pour ses pairs, il écrit pour des centaines, des milliers d’anonymes.
Je terminerai en soulignant que ces « principes » ont pour conséquence d’avoir la volonté d’élaborer pour ces récits, pour ces histoires écrites, des formes contemporaines, faisant écho à ce que nous savons du monde aujourd’hui et de la façon dont nous l’appréhendons : à moins de lui rendre hommage, ou de le pasticher, ce qui peut se concevoir, j’estime inutile et vain d’essayer d’écrire des livres à la manière de Marcel Proust… Ou de Marguerite Duras… Il vaut mieux travailler à l’exploration de nouvelles voies, et donc donner à entendre de nouvelles voix.
Toutes ces remarques me conduisent à revendiquer, avec mes livres, l’élaboration d’un roman contemporain, non pas avec l’ambition de faire école et d’avoir demain des imitatrices et des imitateurs, mais avec la détermination de forger une langue romanesque, une langue littéraire qui ne soit qu’à moi. J’ai l’impression que, dans mes romans, ma phrase et ma page (en tant que « segments » de la narration) sont reconnaissables entre toutes, parce que distinctes de toutes les autres langues des femmes et des hommes qui, à cette heure, écrivent de la littérature en français.
A.H : Dédicace [à Arlette] et épigraphes [Decimus Magnus Ausone et Michel Schneider] s’entremêlent dans la même page. Est-ce un choix délibéré ?
Jean-Michel Devésa : Oui, évidemment, ces épigraphes visent à fournir aux lectrices et aux lecteurs des indications pour une possible interprétation du roman. Ce sont des « panneaux de signalisation »… Quelle est donc l’interprétation que je souhaite induire ?Même si je sais bien que chaque lectrice et chaque lecteur s’empareront de mon livre comme ils le pourront et comme ils le voudront (en disciple de Roland Barthes, je ne crois pas à « la vérité du texte », les auteurs ont des intentions, évidemment, mais l’œuvre, ce sont les lecteurs qui la « terminent », qui la « réalisent » en l’interprétant, à partir de leur « bibliothèque », de leur culture, de leur expérience, de leur sensibilité, etc.). Allez, j’abats mon jeu : j’entretiens un rapport singulier, particulier à la mère. Je vous prie de tendre l’oreille : écoutez bien. Je dis « la mère ». En ce qui me concerne, j’entends aussi : « la mer » et encore « l’amer ». Non, non, je ne plaisante pas. Je ne fais pas mon intéressant. J’essaie de faire sentir que mon geste créatif, ici, mon écriture, me conduit « du côté du maternel, de la mère ». Dans ma vie, cela résonne d’une certaine façon, douloureuse. J’ai été élevé par ma grand-mère, et non pas par ma mère. Ma grand-mère, jusqu’à sa mort, en 2005, elle avait quatre-vingt-dix-sept ans, je l’ai appelée « maman ». Ma mère, qui avait vingt ans de plus que moi, elle m’a chapitré pour que, « devant le monde », je l’appelle par son prénom, et que, si j’étais interrogé à son sujet, je soutienne qu’elle était ma grande sœur… Bon, vous m’avez suivi : vous avez par conséquent saisi le lien entre « Arlette » et la phrase de Schneider (« Tu sais bien que tu as écrit pour séduire maman. »). Reste la citation d’Ausone, le poète. Elle concerne la Gironde, cette « rivière », immense, née de la réunion de deux fleuves, la Garonne et la Dordogne, qui au Bec d’Ambès ne font plus qu’un, jusqu’à l’océan, jusqu’à l’Atlantique, jusqu’à la… mer. Et on retrouve le féminin, sous les auspices du maternel (quoique je sois de celles et de ceux qui ne confondent pas le féminin et le maternel, et qui aussi ne considèrent pas que le féminin s’épanouisse dans le maternel – je suis freudien et lecteur de Simone de Beauvoir). Alors ? La mère, la mer, l’amer : le fil associatif est en partie déroulé. Aux lectrices et aux lecteurs de le prendre en main, si c’est leur souhait, et de continuer de le désenchevêtrer. Que puis-je ajouter ? N’y a-t-il pas dans le rapport à la mère, dans la conduite de sa vie en vue d’en faire une existence, toujours, quelque chose de difficile à assumer, à « avaler » ? « Boire la tasse » n’est jamais très agréable, n’est-ce pas ?
A.H : Une désarmée de morts, composé de cinq chapitres, qui se déroulent d’une manière extrêmement spéciale, inquiétante, avec la mort aux trousses, qu’est-ce qui justifie cette atmosphère, ce monde noir, dangereux ? Qu’est-ce qui ne va pas à vos yeux dans le monde le nôtre pour écrire comme vous le faites ?
Jean-Michel Devésa : Le titre de mon roman, Une désarmée des morts, constitue en lui-même une indication… Mon héroïne, Véronique, est celle-ci, cette femme désarmée, cette femme enrôlée dans les armées des morts… Pour quelles raisons ? Mais enfin ! Vous en rencontrez souvent, vous, des armées de vivants ? Partout, autour de nous, c’est la mort qui l’emporte… C’est très frappant, si j’ose dire. Ne serions-nous au seuil d’une fin ? Que faisons-nous avec la planète et la nature ? Que faisons-nous avec la guerre ? Ne serions-nous pas sous l’emprise d’une irrépressible pulsion de mort ? Souvenons-nous de la Guerre civile espagnole : les forces nationalistes et fascistes de Franco montaient à l’assaut des Républicains en criant « Viva la Muerte »… Que faisons-nous d’autre que creuser nos propres tombes ?Qu’est-ce qui, en ce monde, va ? Qu’est-ce qui en ce monde va à peu près bien ? J’ai plutôt le sentiment que ce monde est détraqué. Qu’il se complaît dans le suicidaire. Il en est ainsi des rapports entre les hommes et les femmes, lesquels sont pris dans une guerre des sexes. Mon roman (d)écrit un épisode de cette guerre des sexes : Maurice tente d’assassiner son épouse, Véronique ; il l’agresse sauvagement mais ne parvient pas à l’achever ; les médecins la sauvent, certes, mais elle sort du coma, hémiplégique et ayant perdu l’usage de la parole, sans aucune autonomie, littéralement à la merci des autres, ce qui la contraint à vivre dix ans dans l’humiliation et les vexations de Maurice et de sa maîtresse… Jusqu’à ce qu’elle s’éteigne, comme un oiseau, en silence… Mon livre est une dénonciation du sort réservé aux femmes par et dans le patriarcat. Et, de surcroît, mon personnage, celui de Véronique, est une allégorie de ce que nous faisons à notre humanité… Mon livre est-il noir, sombre ? Il l’est, bien sûr. Pourquoi ? Mais parce que la littérature, cela nécessairement dérange ! La littérature à l’eau de rose, la littérature rose, ce n’est pas pour moi. Ce n’est pas pour les écrivaines et les écrivains. D’ailleurs ce n’est pas de la littérature. En son temps Mongo Beti l’a avancé et démontré, avec brio. Je m’inscris dans cette lignée de pensée.
A.H : Dionys Mascolo, qui était si proche de Marguerite Duras, de Robert Antelme et d’Edgar Morin, écrit : « Sont également de gauche en effet ― peuvent être dits et sont dits également de gauche des hommes qui n’ont rien en commun : aucun goût, sentiment, idée, exigence, refus, attirance ou répulsion, habitude ou parti pris… Ils ont cependant en commun d’être de gauche, sans doute possible, et sans avoir rien en commun. On se plaint quelquefois que la gauche soit “déchirée”.Il est dans la nature de la gauche d’être déchirée. Cela n’est nullement vrai de la droite, malgré ce qu’une logique trop naïve donnerait à penser. C’est que la droite est faite d’acceptation, et que l’acceptation est toujours l’acceptation de ce qui est, l’état des choses, tandis que la gauche est faite de refus, et que tout refus, par définition, manque de cette assise irremplaçable et merveilleuse (qui peut même apparaître proprement miraculeuse aux yeux d’un certain type d’homme, le penseur, pour peu qu’il soit favorisé de la fatigue): l’évidence et la fermeté de ce qui est. »
En partant de cette thèse, seriez-vous un homme résolument de gauche ? Si oui, et le nom de votre éditeur le révèle bien, en quoi cela consiste-t-il exactement ?
Jean-Michel Devésa : J’aime énormément votre question et son recours à ces remarques de Dionys Mascolo. Celles-ci d’ailleurs mériteraient d’être commentées longuement. Le cadre et le limites de cet entretien ne le permettent pas, j’irai donc à l’essentiel. Il me semble en effet que « l’acceptation », cette attitude, est caractéristique de tous les conservatismes, donc de la « droite » et de la réaction, lesquelles s’accommodent du monde tel qu’il est, de son ordre, de ses déséquilibres, de ses injustices, de ses scandales, de ses oppressions et de ses exploitations. De la dévastation. À l’inverse, s’opposer à cet ordre du monde, à cette marche insensée vers la mort, à la réduction des autres au seul intérêt des puissants, à leur assujettissement au pouvoir de l’argent, ce refus fondamental, il nous classe « à gauche ». Être de gauche, définitivement, c’est ruer contre ce monde et contre ce qui fait que ce monde est humainement insupportable. C’est refuser de se soumettre à cet ordre et à ses exigences. On ne peut pas être réellement de gauche sans être insoumis. La gauche suppose la révolte contre l’ordre du monde, contre la condition faite aux humains et contre la façon dont on maltraite la nature. Je suis donc de gauche, résolument. Et puis, être de gauche, c’est être « jeune » ! Jeune, indéfiniment. Car, comment, à dix-sept ans, peut-on accepter le monde tel qu’il est ? Comment peut-on regarder le monde tel qu’il est sans en être révolté ?Comment, à dix-sept ans, peut-on accepter l’humaine condition et sa finitude sans ruer, chanter, danser, sauter, trépigner, protester contre l’inéluctable ? Sans se lever et partir par les routes ! Si, à dix-sept ans, on ne le fait pas, c’est qu’on est, déjà, vieux. Les assis sont des vieux, ils l’ont toujours été. Relisons Arthur Rimbaud ! Il me semble qu’à bientôt soixante-neuf ans je demeure jeune. Que voulez-vous, la jeunesse, c’est comme l’avenir, cela dure longtemps !
A.H : Le monde, déjà ténébreux, s’est sauvagement obscurci depuis le 7 octobre 2023. Le monde dit « civilisé » a l’air de sombrer dans la barbarie et l’injustice car ceux-là qui soutiennent l’Ukraine contre Vladimir Poutine soutiennent Benjamin Netanyahou contre la Palestine et le Liban. Outre le deux poids deux mesures, il y a un véritable problème politique et éthique. Comment le romancier et avant lui l’enseignant aborde-t-il cette actualité brûlante ? De quels outils disposons-nous pour y faire face ?
Jean-Michel Devésa : L’écrivain que je suis est bien évidemment un citoyen, et pour des raisons de génération politique (j’ai eu vingt ans dans les années 1970), je suis un de ces « enfants de Marx et de Coca-cola » dont parlait à l’époque Jean-Luc Godard, je veux dire, par l’emploi de cette expression, un de ces garçons et filles de l’Occident privilégié, dominateur, héritier de cinq siècles de domination de la planète, qui ont refusé d’avaliser la vie et le quotidien, et donc les privilèges de papa-maman, et ont rêvé d’une révolution politique, sociale, économique, sociétale permettant l’établissement d’une société plus juste, plus égale, plus libre, plus humaine, plus respectueuse des minorités, des ressources de la planète, mettant fin à l’échange inégal avec le reste du monde… La terre était alors divisée en « camps », le capitaliste, et le communiste, et l’ensemble des peuples et des pays qui émergeaient, dont beaucoup sortaient de la nuit coloniale, et qui cherchaient dans le non-alignement une voie progressiste, démocratique, souveraine pour un développement échappant à la quête du profit, de l’argent, de l’exploitation de l’homme par l’homme… L’année 1968 avait été marquée par l’insurrection mondiale de la jeunesse instruite, dans de nombreux cas celle-ci s’efforçait de « faire jonction » avec le prolétariat, la classe ouvrière. Et puis… Cette aspiration s’est brisée. Et s’est enrayée. Elle s’est brisée sur l’atroce réalité des révolutions trahies, de la bureaucratisation des révolutions populaires, de leur enlisement dans l’autoritarisme et la dictature. Elle s’est enrayée avec le processus de globalisation et de mondialisation. 1989 exprime un tournant. L’effondrement du Mur de Berlin, puis en 1991 l’implosion de l’Union soviétique traduisent, non pas la fin de l’Histoire, mais la victoire mondiale du capitalisme et de l’impérialisme (au sens marxiste du terme). Ces traits se sont, depuis, accentués. Que dire ? La planète souffre d’une crise écologique sans précédent qui met en danger l’espèce humaine. La globalisation et la mondialisation n’ont pas « calmé » les appétits de puissance des forces du capitalisme et de l’impérialisme financiers, au contraire, nous sommes entrés dans une phase nouvelle, celle d’une économie capitaliste distributive, relevant d’une société de l’information et de l’image dupliquée (en France, ces dernières années, la regrettée Annie Le Brun a été de cette poignée d’esprits réellement insoumis qui ont eu à cœur de dénoncer ce nouvel état du monde). Les contradictions entre pays et peuples, les contradictions au sein des peuples, partout elles se sont exacerbées, autorisant notamment un renforcement des nationalismes et des intégrismes religieux. Et la glaciation des espérances, les anciennes (celles que j’évoquais il y a un instant et qui sont « filles » de la révolution industrielle européenne du XIXe siècle) et les contemporaines (comme « les printemps arabes » qui ont eu comme conséquence « paradoxale » de favoriser le salafisme et un islamisme radical qui, de façon spéculaire, est le pendant du suprématisme « blanc » et occidental)… Je simplifie, je schématisme, j’en ai bien conscience, mais comment en quelques mots peindre et dépeindre cet état du monde ? Un monde et une nature dévastés, une humanité en proie à la dévastation. Il s’ensuit une multiplication des conflits armés, une prolifération des guerres, un accroissement vertigineux des douleurs des peuples et des humains.
Vous avez, dans votre question, évoqué deux foyers de tensions susceptibles de provoquer une déflagration mondiale.
J’en dirai quelques mots.
Je ne suis pas un admirateur de Poutine, je ne me raconte pas d’histoire sur son régime, je ne suis pas candide devant le sentiment nationaliste russe ; mais comment ne pas discerner la volonté hégémonique des États-Unis et de l’OTAN qui, depuis 1991, « poussent » vers l’Est européen leur zone d’influence, et de vassalisation, des anciens pays du Pacte de Varsovie ?En Ukraine, la guerre n’a pas commencé avec l’agression russe, elle remonte à plus loin, au moins à 2014, et il conviendrait d’examiner de près ce qui s’est produit à Kiev dans les années qui ont précédé. De même faudrait-il analyser avec plus de sérieux comment l’Union européenne tend à se placer à la remorque de l’OTAN, sous l’influence de pays (anciennement « socialistes », anciennement « communistes ») qui en reviennent à une tradition « atlantiste » et à un « tropisme » qui les fait pencher vers le monde anglo-saxon, dont on peut relever l’empreinte depuis la seconde moitié du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle.
Et puis la Palestine… Vous savez, j’appartiens à une génération pour laquelle le soutien à « la Révolution palestinienne » était fondamental. J’observe que nous sommes passés de « la Révolution palestinienne » à « la cause palestinienne », et maintenant à « la question palestinienne ». Je remarque aussi que la revendication d’un État palestinien « démocratique, laïc et progressiste » a reculé, voire disparu ; ce qu’on a appelé « la rue arabe » demeure muette devant les massacres qui endeuillent le peuple palestinien. Et l’aspiration légitime de celui-ci à un État s’exprime, en grande partie, par le truchement du religieux et de l’islamisme… Là où je suis, le pauvre petit intellectuel que je suis, il en est fort triste. Il m’est impossible d’approuver les attentats contre les civils, les viols, les mutilations. Je ne soutiens pas ces actes. Je reconnais le droit du peuple palestinien à résister contre Israël et son armée ; je suis et demeure partisan d’une solution politique et diplomatique sur la base de deux États, ce qui implique la reconnaissance d’un État palestinien et l’existence dans la sécurité d’Israël. Je n’ai pas exulté à l’annonce de ce qui s’est produit le 7 octobre, je le réaffirme, je suis opposé à ce qu’on s’en prenne aux civils. Mais qu’a donc été la « réplique » d’Israël ? Le gouvernement d’extrême-droite israélien a transformé Gaza en une enclave à la fois « otage » et martyrisée. Combien de dizaines de milliers de morts ? Combien d’enfants et de femmes tués, sous les bombes ?Et le monde entier regarde sur les écrans des téléviseurs et des ordinateurs cette tuerie sans véritablement réagir… C’est honteux, nauséeux. Et le même gouvernement d’extrême-droite d’Israël « exporte » la guerre au Liban… Et des puissances régionales et d’autres de stature mondiale en profitent, « mobilisant » leurs affidés, regardez ce qu’il est advenu de la Syrie et du régime autoritaire d’Assad ? Croyez-vous qu’une armée puisse « sortir » du désert, spontanément ? Nous avons eu « droit » à la même fable avec le sinistre épisode de l’État Islamique, il y a quelques années…Qui donc tire les ficellesdes forces militaires qui ont renversé le régime d’Assad ? Et par conséquent : qui a organisé, armé et préparé leur offensive ? À quelle(s) puissance(s) régionale(s) profite la fin de ce régime peu sympathique (je suis gentil en usant de cet euphémisme) ?
Voyez, le citoyen, le citoyen du monde s’exprime. Et son désarroi est immense. C’est le citoyen qui a parlé. Qui a critiqué, qui a dénoncé. Ce rapport à l’Histoire, mon rapport à l’Histoire et au politique, je ne l’investis pas sous cette forme dans mes livres. Parce que je ne pratique pas une littérature de type « littérature prolétarienne », de type « littérature politique » exprimant un point de vue, une ligne politique, à la façon d’un éditorial d’un organe de presse. Je ne suis pas pour autant un partisan de « l’art pour l’art », simplement je ne confonds pas une œuvre littéraire avec un tract ou un bulletin de vote ! J’ai l’ambition de produire une littérature qui accède à une dimension humaine plus générale, moins circonstancielle. Pour paraphraser et pour gauchir une tournure de Louis Althusser (il l’a employée à propos du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau), je soutiens que, lorsque les humains se heurtent à une impossibilité théorique, politique, pratique de dégager une « solution » aux contradictions auxquelles ils sont confrontés, il leur reste une issue, celle d’un transfert de cette impossibilité à l’Autre de la théorie, du politique, de la pratique, et cet Autre, c’est précisément la littérature, et les arts…
A.H : Si vous deviez tout recommencer, quels choix feriez-vous ? Si vous deviez vous incarner ou vous réincarner en un mot, en un arbre, en un animal, lequel seriez-vous à chaque fois ? Enfin, si un seul de vos textes devait être traduit dans d’autres langues, en arabe par exemple, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?
Jean-Michel Devésa : Recommencer ? Pourquoi « recommencer » ? Ma névrose m’incite à désirer plutôt, follement, de ne pas finir. Je ne vous cache pas que la finitude de notre condition humaine me taraude. Cette année, je vais fêter mes soixante-neuf ans : à bien des égards, j’ai l’impression que mon esprit n’a pas pris une ride. Je ris, plaisante, me mets en colère, aime et déteste, pense aussi, comme lorsque j’avais vingt ans. Pourtant mon corps, ma carcasse ont changé. Les saisons et les années sont passées et mes facultés et capacités physiques ont diminué. Les temps de récupération ont augmenté. Pour lire, il me faut des lunettes, je dois ménager mes forces, je ne peux plus courir une heure par jour, comme je l’ai fait, par exemple, entre 2005 et 2012. Cette réduction physique de ma personne me désespère. Ah, savoir ce que j’ai appris en soixante-neuf ans et rester vivant, dans un présent « étiré », s’étirant à l’infini, vers l’infini, dans un corps encore jeune, disons un corps d’un individu de trente à quarante ans… Je vous avais prévenu : ma névrose…
Et me réincarner ?
Je ne vais pas faire mon mariole. Je joue le jeu avec vous : j’aimerais me réincarner, j’aimerais revenir en chat. Pourquoi en chat ? Parce que dans les croyances populaires les chats ont sept vies ! Ce serait formidable, non, sept vies d’un présent étiré et s’étirant à l’infini…
La traduction d’un de mes livres en arabe ? J’adorerais. Vous me demandez quel est celui de mes livres que je souhaiterais voir traduit en arabe. Voulez-vous bien m’accorder d’en espérer non pas un mais deux ? Pour des raisons politiques, et personnelles, je dirais : Une fille d’Alger car mon héroïne, Hélène Samia, je l’ai imaginée comme l’allégorie de ce que j’appelle, avec d’autres, « le peuple algérien qui manque », c’est-à-dire le peuple algérien auquel bien des combattants et des combattantes de la révolution algérienne ont rêvé, un peuple rassemblant toutes celles et tous ceux, indépendamment de leur religion et de leur origine culturelle, avaient opté pour une Algérie indépendante, laïque et socialiste, ce qui impliquait la fin de la colonisation française et son démantèlement. Donc, oui, Une fille d’Alger. Mais aussi le « petit » dernier, cette Une désarmée des morts ! Pourquoi ce dernier ? Je suis franc et sincère : parce qu’à mes yeux il est le plus abouti, le plus réussi de tous… Si un éditeur arabe veut que nous en discutions, n’hésitez pas à lui communiquer mes coordonnées, je lui ferai bon accueil, et puis rassurez-le : je suis d’accord pour que la traduction de ces deux livres soit échelonnée… Je plaisante, bien sûr. Enfin, non, je ne plaisante pas. Ce serait une joie que d’être traduit en arabe. Et un honneur.